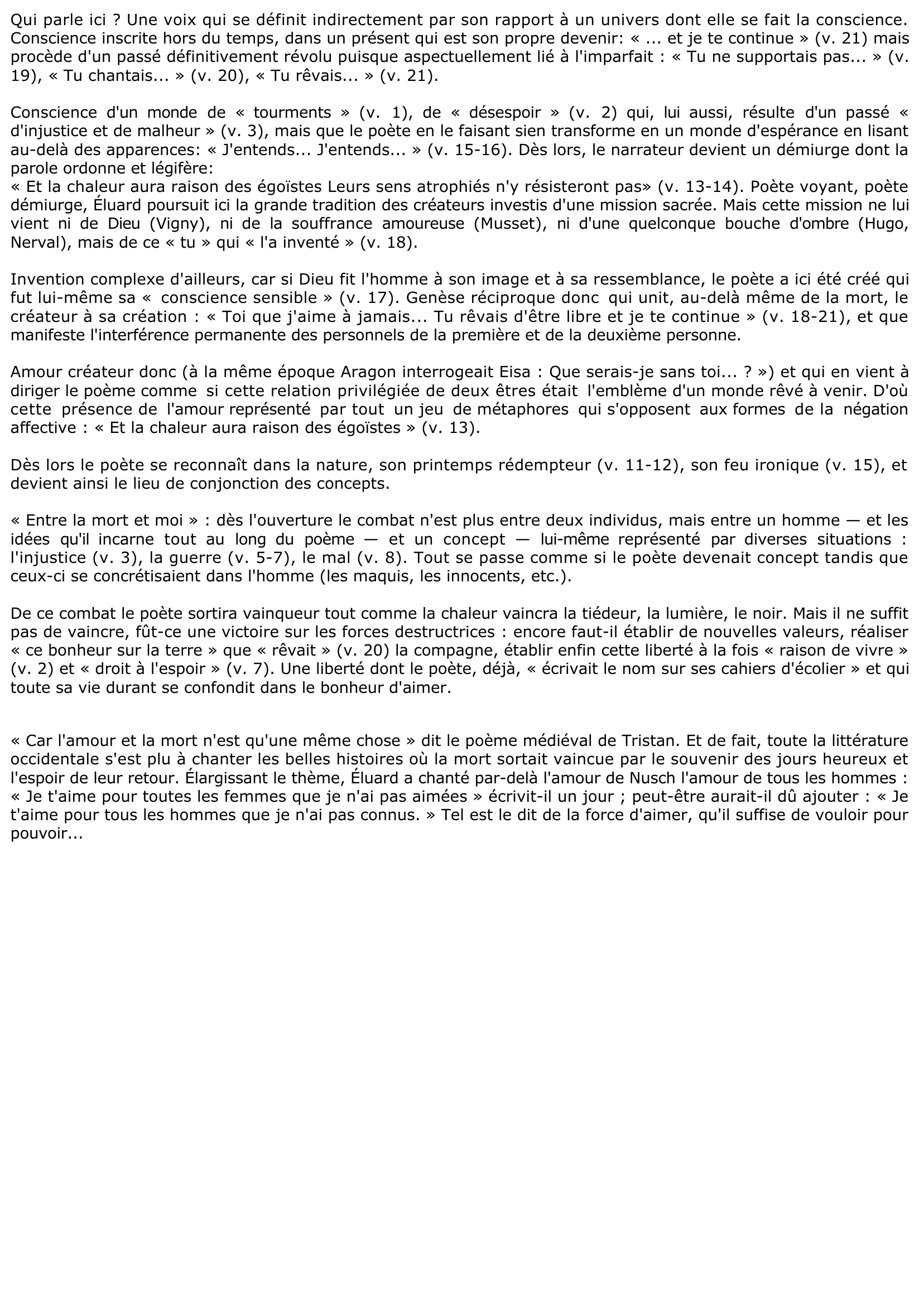DIT DE LA FORCE DE L'AMOUR - Paul Éluard
Publié le 08/03/2011
Extrait du document

Entre tous mes tourments entre la mort et moi Entre mon désespoir et la raison de vivre Il y a l'injustice et ce malheur des hommes Que je ne peux admettre il y a ma colère Il y a les maquis couleur de sang d'Espagne Il y a les maquis couleur du ciel de Grèce Le pain le sang le ciel et le droit à l'espoir Pour tous les innocents qui haïssent le mal La lumière toujours est tout près de s'éteindre La vie toujours s'apprête à devenir fumier Mais le printemps renaît qui n'en a pas fini Un bourgeon sort du noir et la chaleur s'installe Et la chaleur aura raison des égoïstes Leurs sens atrophiés n'y résisteront pas J'entends le feu parler en riant de tiédeur J'entends un homme dire qu'il n'a pas souffert Toi qui fus de ma chair la conscience sensible Toi que j'aime à jamais toi qui m'as inventé Tu ne supportais pas l'oppression ni l'injure Tu chantais en rêvant le bonheur sur la terre Tu rêvais d'être libre et je te continue. Paul Éluard.
1. Allusion à la guerre civile d'Espagne. 2. Allusion aux luttes qui ont déchiré la Grèce après la Libération.
Vous ferez un commentaire composé de ce poème de Paul Éluard écrit quelques mois après la mort de sa femme Nusch. Vous pourrez, par exemple, vous demander comment par différents moyens stylistiques le poète exprime les nouvelles raisons de vivre qu'il trouve dans un engagement qui est fidélité à Nusch, réalisation de leur amour.
A moins que le texte n'y invite explicitement vous ne devez jamais aborder un poème: — sans tenir compte du titre (s'il en a un); — en cherchant à tout prix à retrouver dans ce texte précis des idées générales que vous pouvez avoir apprises dans les histoires littéraires (en l'occurrence ici, faire de ce poème une œuvre de militantisme communiste ou d'inspiration surréaliste);

«
Qui parle ici ? Une voix qui se définit indirectement par son rapport à un univers dont elle se fait la conscience.Conscience inscrite hors du temps, dans un présent qui est son propre devenir: « ...
et je te continue » (v.
21) maisprocède d'un passé définitivement révolu puisque aspectuellement lié à l'imparfait : « Tu ne supportais pas...
» (v.19), « Tu chantais...
» (v.
20), « Tu rêvais...
» (v.
21).
Conscience d'un monde de « tourments » (v.
1), de « désespoir » (v.
2) qui, lui aussi, résulte d'un passé «d'injustice et de malheur » (v.
3), mais que le poète en le faisant sien transforme en un monde d'espérance en lisantau-delà des apparences: « J'entends...
J'entends...
» (v.
15-16).
Dès lors, le narrateur devient un démiurge dont laparole ordonne et légifère:« Et la chaleur aura raison des égoïstes Leurs sens atrophiés n'y résisteront pas» (v.
13-14).
Poète voyant, poètedémiurge, Éluard poursuit ici la grande tradition des créateurs investis d'une mission sacrée.
Mais cette mission ne luivient ni de Dieu (Vigny), ni de la souffrance amoureuse (Musset), ni d'une quelconque bouche d'ombre (Hugo,Nerval), mais de ce « tu » qui « l'a inventé » (v.
18).
Invention complexe d'ailleurs, car si Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance, le poète a ici été créé quifut lui-même sa « conscience sensible » (v.
17).
Genèse réciproque donc qui unit, au-delà même de la mort, lecréateur à sa création : « Toi que j'aime à jamais...
Tu rêvais d'être libre et je te continue » (v.
18-21), et quemanifeste l'interférence permanente des personnels de la première et de la deuxième personne.
Amour créateur donc (à la même époque Aragon interrogeait Eisa : Que serais-je sans toi...
? ») et qui en vient àdiriger le poème comme si cette relation privilégiée de deux êtres était l'emblème d'un monde rêvé à venir.
D'oùcette présence de l'amour représenté par tout un jeu de métaphores qui s'opposent aux formes de la négationaffective : « Et la chaleur aura raison des égoïstes » (v.
13).
Dès lors le poète se reconnaît dans la nature, son printemps rédempteur (v.
11-12), son feu ironique (v.
15), etdevient ainsi le lieu de conjonction des concepts.
« Entre la mort et moi » : dès l'ouverture le combat n'est plus entre deux individus, mais entre un homme — et lesidées qu'il incarne tout au long du poème — et un concept — lui-même représenté par diverses situations :l'injustice (v.
3), la guerre (v.
5-7), le mal (v.
8).
Tout se passe comme si le poète devenait concept tandis queceux-ci se concrétisaient dans l'homme (les maquis, les innocents, etc.).
De ce combat le poète sortira vainqueur tout comme la chaleur vaincra la tiédeur, la lumière, le noir.
Mais il ne suffitpas de vaincre, fût-ce une victoire sur les forces destructrices : encore faut-il établir de nouvelles valeurs, réaliser« ce bonheur sur la terre » que « rêvait » (v.
20) la compagne, établir enfin cette liberté à la fois « raison de vivre »(v.
2) et « droit à l'espoir » (v.
7).
Une liberté dont le poète, déjà, « écrivait le nom sur ses cahiers d'écolier » et quitoute sa vie durant se confondit dans le bonheur d'aimer.
« Car l'amour et la mort n'est qu'une même chose » dit le poème médiéval de Tristan.
Et de fait, toute la littératureoccidentale s'est plu à chanter les belles histoires où la mort sortait vaincue par le souvenir des jours heureux etl'espoir de leur retour.
Élargissant le thème, Éluard a chanté par-delà l'amour de Nusch l'amour de tous les hommes :« Je t'aime pour toutes les femmes que je n'ai pas aimées » écrivit-il un jour ; peut-être aurait-il dû ajouter : « Jet'aime pour tous les hommes que je n'ai pas connus.
» Tel est le dit de la force d'aimer, qu'il suffise de vouloir pourpouvoir....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Amour LA POÉSIE (L') de Paul Éluard (fiche de lecture)
- AMOUR LA POÉSIE (L) de Paul ÉLuARD (résumé et analyse)
- L’Amour la poésie de Paul Éluard (analyse détaillée)
- Derniers Poèmes d'amour de Paul Éluard (analyse détaillée)
- DIT DE LA FORCE DE L'AMOUR. Paul ÉLUARD