Diderot : réfutation d'Helvétius
Publié le 24/03/2011
Extrait du document
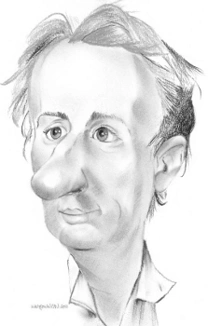
Le texte s'ouvre sur une formule lapidaire : « toujours mauvais «. La formule semble paradoxale. Comment ces vertus (« juste et éclairé «) peuvent-elles conduire à un mauvais gouvernement ? Parce qu'il est « arbitraire « : multiplier les questions aux élèves pour qu'ils voient que ce qui caractérise un mauvais gouvernement c'est précisément l'arbitraire ; c'est un signe qui ne doit pas nous tromper, malgré des vertus apparentes. * Thème. Comment cela se fait-il qu'être juste et éclairé ne suffise pas à faire un bon gouvernement ? * Explication du texte et argumentation. A. Commencer par se demander ce qu'est un prince juste et un prince éclairé. Partant, ce qu'est l'arbitraire. « Prince juste « : il s'agit de comprendre ce mot dans le texte et non hors du texte. Ce qu'on appelle en France des Miroirs : il s'agit d'être vertueux en devenant l'image respectueuse de Dieu sur Terre, et le peuple à son tour pourra prendre cette image du prince comme modèle. Le prince imite Dieu et le peuple imite le prince. Le prince doit être bon, soucieux de son peuple.
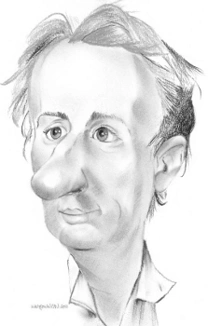
«
Ø 2ème raison.Il enlève au peuple le droit de délibérer.On lui retire sa liberté et, plus encore, sa liberté naturelle : la liberté qui fait partie de son essence d'homme.
Car laliberté politique est première en l'homme.
Délibérer, c'est faire la loi, choisir ses représentants…Toutes chosesque le peuple ne peut pas faire dans un Etat despotique et s'il le fait, s'il s'oppose à la volonté du prince, il devientcriminel.« Lorsqu'il ordonne le bien » est une formule paradoxale.
Car si le prince fait le bien, pourquoi s'y opposer ?Finalement, ne vaut-il pas mieux retirer au peuple sa liberté s'il n'est pas capable d'en faire bon usage ? Ne vaut-ilpas mieux avoir confiance en la sagesse du prince ? D'ailleurs, Diderot reconnaît que le droit est insensé même s'ilest aussi sacré.
Pourquoi ? « Sans quoi les sujets ressemblent à un troupeau… ».
Sacré signifie inviolable.Quel est ce droit ? Le droit naturel à être libre.
L'homme est par nature un être raisonnable capable de se fixer lui-même ses propres fins.
C'est une « personne » et non un instrument.
Il naît libre et non esclave.Ce droit est sacré quand bien même il est utilisé de façon insensée.
Cela s'oppose à la conception classique héritéede Platon pour qui seuls ceux qui savent peuvent délibérer.Si on supprime aux individus ce droit, on les réduit à un troupeau, c'est à dire un agrégat informe qui ne constituepas une société mais un groupe d'individualités.
Si les hommes sont des animaux, il y aurait entre les commandés etcelui qui commande une différence de nature, comme entre le père et le fils.
Dans ce cas, il y aurait un droit naturelà ce que le fils obéisse et à ce que le père commande au fils.
Le fils (les enfants ne savent pas ce qui est bon poureux) chétif est incapable de subsister par lui-même, tandis que le père en est capable.
Donc, le père a un droitnaturel (en vertu de ce que la nature nous donne comme moyens) de commander son fils.
Cette structure paternelleva servir de modèle à l'organisation de la société.
D'où il s'ensuit que l'autorité royale est naturelle pour Bossuet.
Leshommes sont faits par nature pour obéir à un seul homme.
Mais, comme le souligne Rousseau, cette faiblesse du filsest limitée dans le temps et la nature fait aussi bien en sorte que le fils devienne autonome à son tour en devenantadulte.Pourquoi l'analogie ne tient-elle pas ? Parce que le peuple est un peuple d'adultes et non d'enfants.
Essayons depenser alors une inégalité naturelle.
Il y a des forts et des faibles, certains sont dotés de ce qu'il faut pourcommander et les autres pour obéir.
Les chefs sont au peuple ce que les dieux sont aux hommes, de la mêmemanière que les hommes gouvernent aux animaux.
Le caractère arbitraire du gouvernement serait justifié par la fin poursuivie (les « gras pâturages ») : la fin justifieles moyens.
Le monarque échappe à tout contrôle dès lors que son pouvoir est arbitraire.
On tombe alors dans ledespotisme, le paternalisme teinté de justifications naturalistes.
Ce texte affronte ici la conception de l'État deHobbes.
C.
Définition du despotisme « éclairé ».
Qu'est-ce qui caractérise le despote ? « Bonté ou méchanceté » (renvoient aux vertus du début) ? Ce ne sont pasles qualités morales qui qualifient le despote, c'est l'étendue de l'autorité qu'il s'arroge.
Et cette étendue estdémesurée (sans mesure, c'est à dire illimitée).La suite du texte revient sur l'idée d'accoutumance (« ce serait deux ou trois règnes… ») : le peuple conduitpar le bonheur (mélange de paix civile et de prospérité économique).
A partir du moment où le prince conduit sonpeuple à ce type de bonheur immédiat, il enferme les hommes dans l'immédiateté de leur existence (leur travail, leurenrichissement) et tout ce qui contesterait cette prospérité serait vécu comme une agression (« ombrage»,méfiance).
On n'est plus méfiant quant à sa liberté, la tranquillité endort la méfiance.« Malheur aux sujets… » : c'est une mise en garde qui concerne tous les peuples.« Étranger » : aliéné.
Je donne ma liberté à un autre.Cette critique se porte aussi sur le peuple lui-même : attention de ne pas vous endormir !C'est la lâcheté et la tranquillité qui conduisent au despotisme.« Sommeil » : abandon de la réflexion.« Sentiment patriotique » : prendre patrie au sens de communauté politique et civique.
Attachement aux affaires dela cité.* Conclusion.L'objectif de Diderot dans ce texte est de définir le despotisme et de faire apparaître que le despotisme est unemonstruosité politique.Qu'est-ce que le despotisme en fin de compte ? Tout pouvoir par lequel un seul décide pour tous les autres, quelleque soit la fin qu'il poursuive.Ce texte nous engage à réfléchir et à regarder autour de nous pour voir dans quelle société nous vivons.
Sujet désiré en échange :
pour exister, un personnage de roman doit-il nécessairement réussir.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- RÉFUTATION SUIVIE DE L’OUVRAGE D’HELVÉTIUS INTITULÉ L’HOMME Denis Diderot
- Synthèse : extrait 5 "Supplément au voyage de Bougainville" de Diderot
- Diderot : Supplément au Voyage de Bougainville (présentation de l'oeuvre)
- DIDEROT ET D'ALEMBERT : ENCYCLOPEDIE : ARTICLE REFUGIES
- Diderot et l'Encyclopédie (cours)

































