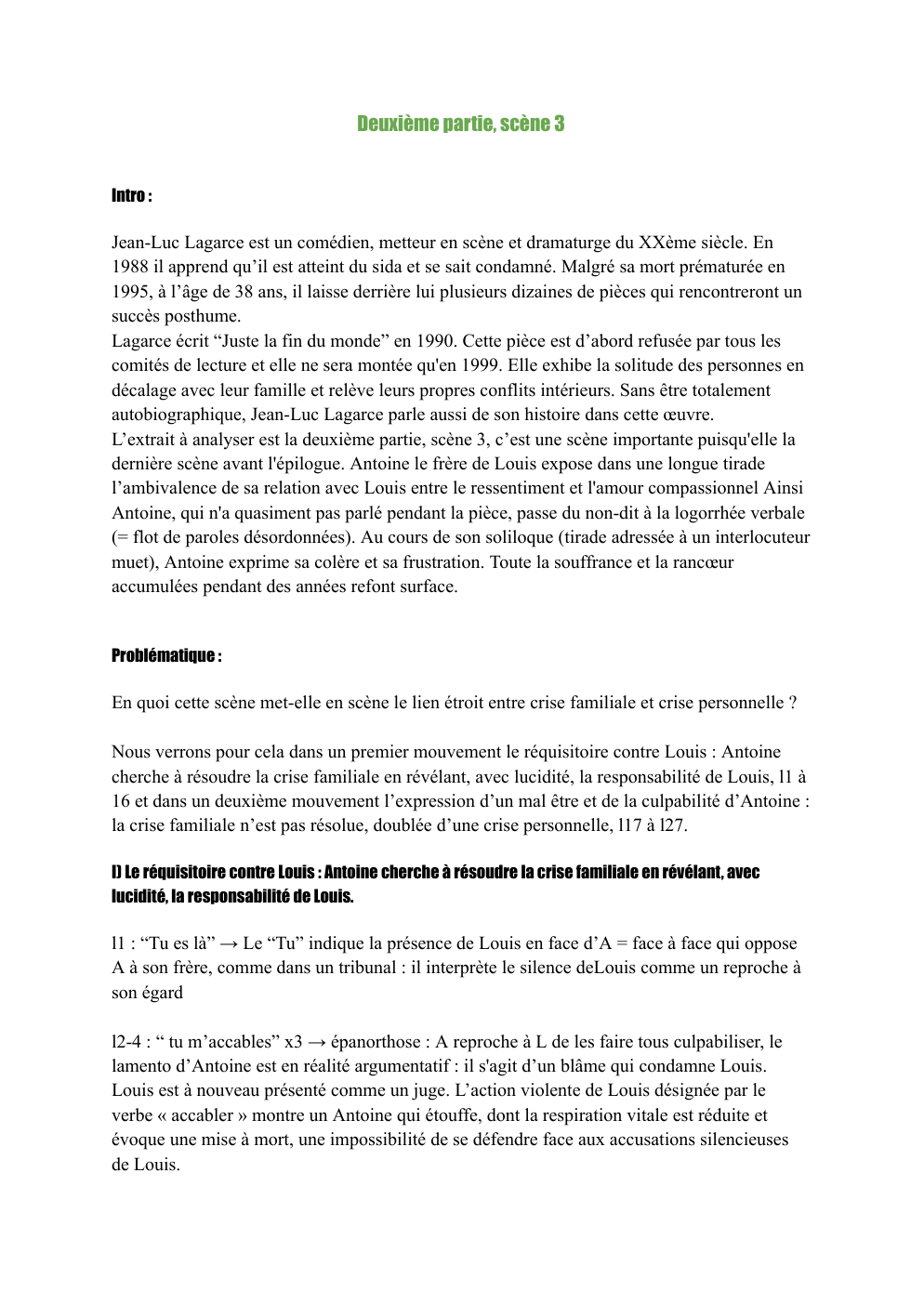deuxième partie scène 3 juste la fin du monde
Publié le 06/11/2023
Extrait du document
«
Deuxième partie, scène 3
Intro :
Jean-Luc Lagarce est un comédien, metteur en scène et dramaturge du XXème siècle.
En
1988 il apprend qu’il est atteint du sida et se sait condamné.
Malgré sa mort prématurée en
1995, à l’âge de 38 ans, il laisse derrière lui plusieurs dizaines de pièces qui rencontreront un
succès posthume.
Lagarce écrit “Juste la fin du monde” en 1990.
Cette pièce est d’abord refusée par tous les
comités de lecture et elle ne sera montée qu'en 1999.
Elle exhibe la solitude des personnes en
décalage avec leur famille et relève leurs propres conflits intérieurs.
Sans être totalement
autobiographique, Jean-Luc Lagarce parle aussi de son histoire dans cette œuvre.
L’extrait à analyser est la deuxième partie, scène 3, c’est une scène importante puisqu'elle la
dernière scène avant l'épilogue.
Antoine le frère de Louis expose dans une longue tirade
l’ambivalence de sa relation avec Louis entre le ressentiment et l'amour compassionnel Ainsi
Antoine, qui n'a quasiment pas parlé pendant la pièce, passe du non-dit à la logorrhée verbale
(= flot de paroles désordonnées).
Au cours de son soliloque (tirade adressée à un interlocuteur
muet), Antoine exprime sa colère et sa frustration.
Toute la souffrance et la rancœur
accumulées pendant des années refont surface.
Problématique :
En quoi cette scène met-elle en scène le lien étroit entre crise familiale et crise personnelle ?
Nous verrons pour cela dans un premier mouvement le réquisitoire contre Louis : Antoine
cherche à résoudre la crise familiale en révélant, avec lucidité, la responsabilité de Louis, l1 à
16 et dans un deuxième mouvement l’expression d’un mal être et de la culpabilité d’Antoine :
la crise familiale n’est pas résolue, doublée d’une crise personnelle, l17 à l27.
I) Le réquisitoire contre Louis : Antoine cherche à résoudre la crise familiale en révélant, avec
lucidité, la responsabilité de Louis.
l1 : “Tu es là” → Le “Tu” indique la présence de Louis en face d’A = face à face qui oppose
A à son frère, comme dans un tribunal : il interprète le silence deLouis comme un reproche à
son égard
l2-4 : “ tu m’accables” x3 → épanorthose : A reproche à L de les faire tous culpabiliser, le
lamento d’Antoine est en réalité argumentatif : il s'agit d’un blâme qui condamne Louis.
Louis est à nouveau présenté comme un juge.
L’action violente de Louis désignée par le
verbe « accabler » montre un Antoine qui étouffe, dont la respiration vitale est réduite et
évoque une mise à mort, une impossibilité de se défendre face aux accusations silencieuses
de Louis.
l4 : “ tu nous accables “ → passage de la 1re pers.
du singulier à celle du pluriel « nous » =
action de Louis sur Antoine élargie au cercle familial, La violence de Louis atteint toute la
famille.
Antoine exprime sa douleur mais prend aussi en charge d’exprimer celle de la
famille.
l5-6 : “je te vois, j’ai encore plus peur pour toi que lorsque j’étais enfant” → Emploi du
verbe de perception «vois» = double sens, propre la vue et figuré(la clairvoyance + tournure
comparative «encore plus que» soulignant le degré d’intensité du sentiment que provoque
Louis dans son entourage + subordonnée temporelle «lorsque j’étais enfant»= plongée dans le
passé familial.
La violence de Louis est en relation avec la peur qu’il génère chez ses proches depuis
l’enfance, en se positionnant en être souffrant qui inquiète son entourage.
Antoine, par sa
relecture subjective du passé familial montre implicitement qu eLouis pratique le chantage
affectif, en suscitant la peine, la peur
l7 et 10 : “ je ne peux rien reprocher” et “imbécile qui se reproche” → répétition = champ
lexical de la culpabilité = Témoigne de la difficulté d’A à trouver les mots et renforce le
sentiment de culpabilité, la conséquence du chantage affectif de Louis, c’est qu'Antoine se
sent coupable.
l9-10 : “qu’elle est paisible et douce et que je suis un mauvais imbécile” → -Adjectifs
mélioratifs «paisible et douce», lexique du bonheur et en opposition au vocabulaire péjoratif
GN «mauvais imbécile», verbe «se lamenter» = Il se reproche tout et son contraire : d'être
heureux, alors qu’il a lui aussi droit au bonheur ; mais aussi d'être malheureux.
l11: “ d’avoir failli se lamenter” → A se reproche d’avoir eu la faiblesse de s’exprimer, il n’y
a pas d’issue à la culpabilité.
Louis l'a piégé.
Antoine est un être blessé, empêché de vivre par
la posture adoptée par son frère.
l12 : “alors que toi” → conjonction de sub = montre qu'À compare sa vie à L et montre que
leurs vies sont opposées
l10-12 : “et que je suis…..qui se reproche … alors que toi” → Début d’une longue
proposition subordonnée conjonctive circonstancielle d’opposition qui oppose la douleur des
2 frères = Il confronte les douleurs, dans une compétition malsaine.
Sa douleur est minimisée
et mise en balance avec celle de son frère qui semble plus légitime.
l13 : “ silencieux, ô tellement silencieux” → interjection + hyperbole = dresse un portrait
amer de L comme silencieux
l14 : “bon, plein de....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Juste la fin du monde De Jean- Luc Lagarce Etude linéaire Première partie, scène 10 (de «Plus tard encore..» à «Nous pourrions les séduire.»)
- Bac de Français - Explication linéaire - Juste la fin du monde (Partie 2 - Scène 2) - La colère d'Antoine
- Dissertation : En quoi Juste la fin du monde met en scène une crise personnelle et familiale ?
- Jean Luc Lagarce né en 1957 et mort en 1995 est un auteur dramatique contemporain et metteur en scène du XX ème siècle, il publie en 1990 « Juste avant la fin du monde » une pièce de théâtre.
- la representation du monde exterieur dans fin de partie