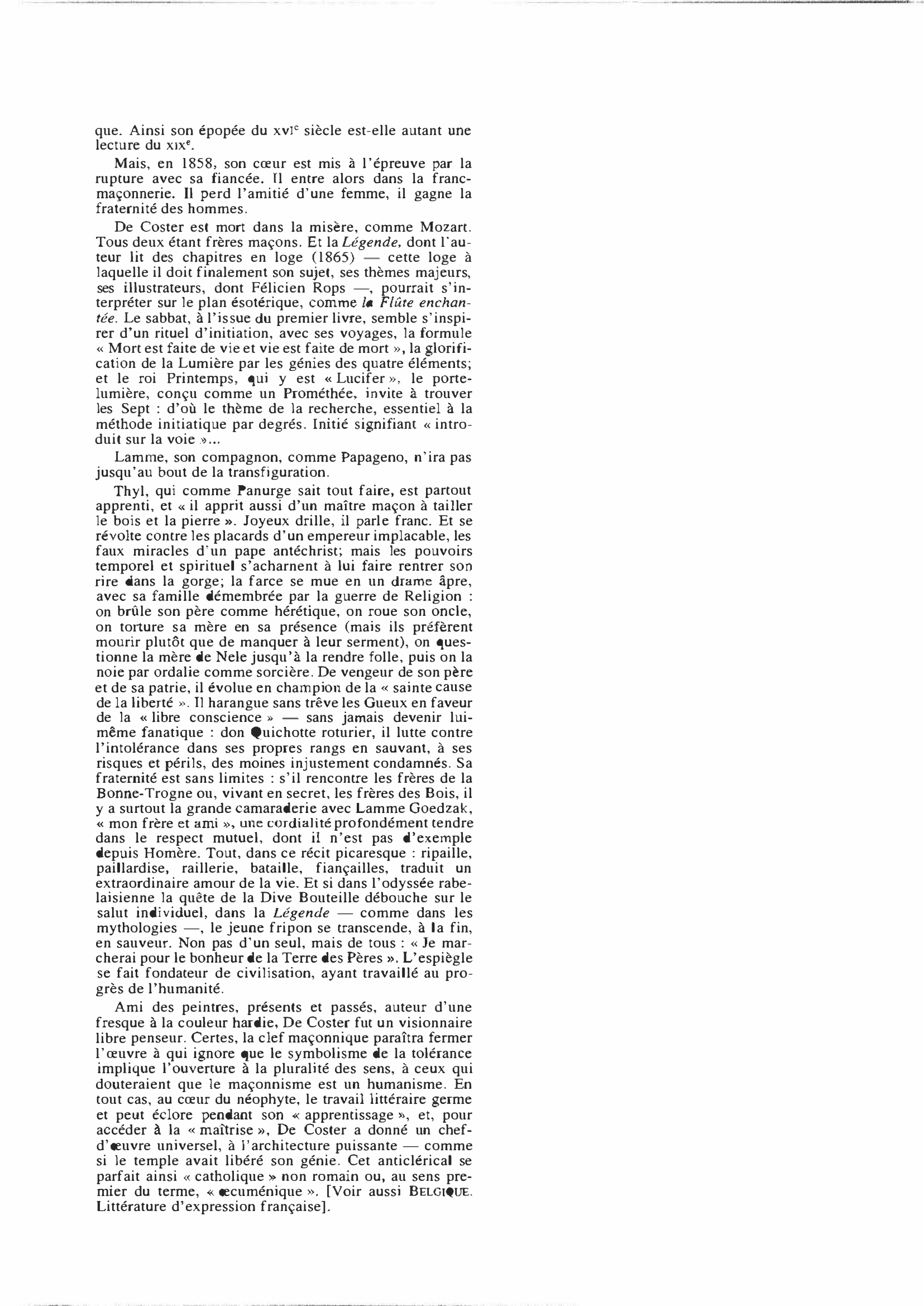DE COSTER Charles : sa vie et son oeuvre
Publié le 22/11/2018
Extrait du document
DE COSTER Charles (1827-1879). Depuis 1830, la Belgique, qui avait retrouvé son autodétermination par la Révolution, était, comme tout État ayant obtenu son indépendance, à la recherche de son authenticité, par la culture. Il faudra attendre 1867, où se publie le premier chef-d’œuvre belge, considéré en outre comme « une des grandes œuvres du xixe siècle ». En effet, décolonisé par rapport à la Hollande, le nouveau royaume se sentait encore trop inféodé à l’idéologie de la France; aussi crut-il se découvrir une âme en Allemagne. Mais De Coster, après une production en vers assez médiocre, s’affirme avec les Légendes flamandes (1857) et surtout, dix ans plus tard, avec la Légende et les Aventures héroïques, joyeuses et glorieuses de Uylenspiegel et de Lamme Goedzak au pays de Flandres et ailleurs, qui est l’acte de naissance de la littérature belge.
Cet écrivain d’expression française, qui chante la Flandre à travers un héros d’origine allemande, apparaîtra comme le père nourricier des lettres — et même des arts — belges, francophones ou néerlandophones. Et si la Légende n’a, du vivant de son auteur, qu’une édition pleine de coquilles, et qui se vend très mal, elle inspire par la suite d'innombrables traductions et adaptations. Pour tous les peuples opprimés, son œuvre symbolise l'espérance par l’affranchissement. Grand romancero des Flandres sous la domination espagnole, elle figure la condition humaine. C’est une « Bible nationale » : l'histoire occidentale, comme celle du tiers monde, avec la montée des nations, y reconnaît son prototype.
La forme en est pourtant singulière. Quand les Contes drolatiques de Balzac pastichent une orthographe prétendument médiévale, la Légende use d’une langue qu’on croit calquée sur l’ancienne mais qui est une création personnelle de Charles De Coster : il a travaillé le langage en pleine pâte, archaïsant sa phrase d’expressions et de tours enfouis depuis plusieurs siècles, de manière à conférer la patine à cette écriture savamment populaire; son style, original, a régénéré la langue française.
«
que.
Ainsi son épopée du xvie siècle est-elle autant une
lectu re du x1x•.
Mais, en 1858, son cœur est mis à l'ép re uve par la
rupture avec sa fiancée.
Tl entre alors dans la franc
maçonnerie.
Il perd l'amitié d'une femme, il gagne la
fraternité des hommes.
De Coster est mort dans la misère, comme Mozart.
Tous deux étant frères maçons.
Et la Légende, dont 1' au
teur lit des chapitres en loge (1865) -cette loge à
laquelle il doit finalement son sujet, ses thèmes majeu rs,
ses illustrateurs, dont Félicien Rops -, pourrait s'in
terpréter sur le plan ésotérique, comme la Flûte enchan
tée.
Le sabbat, à l'is sue du premier livre, semble s'inspi
rer d'un rituel d'initiation, avec ses voyages, la formule
« Mort est faite de vie et vie est faite de mort », la glorifi
cation de la Lumière par les génies des quatre éléments;
et le roi Printemps, qui y est « Lucifer», le porte
lumière, conçu comme un Prométhée, invite à trouver
les Sept : d'où le thème de la recherche, essentiel à la
méthode initiatique par degrés.
Initié signifiant « intro
duit sur la vo ie » ...
Lamme, son compagnon, comme Papageno, n'ira pas
jusqu'au bout de la transfîguration.
Thyl, qui comme Panurge sait tout faire, est partout
apprenti, et « il apprit aussi d'un maître maçon à taill er
Je bois et la pierre».
Joyeux drille, il parl e franc.
Et se
révolte contre les placards d'un empereur implacable, les
faux miracles d'un pape antéchrist; mais les pouvoirs
temporel et spirituel s'acharnent à lui faire rentrer son
rire dans la gorge; la farce se mue en un drame âpre,
avec sa famille démembrée par la guerre de Religion :
on brûle son père comme hérétique, on roue son oncle,
on torture sa mère en sa présence (mais ils préfèrent
mourir plutôt que de manqu er à le u r serment), on ques
tionne la mè re de Nele jusqu 'à la rendre folle, puis on la
n o ie par ordalie comme sorcière.
De vengeur de son père
et de sa patrie, il évolue en cha mpion de la« sainte cause
de la liberté >>.Il harangue sans trêve les Gueux en faveur
de la «libre conscience >> - sans jamais devenir lui
même fanatique : don Quichotte roturier, il lutte contre
l'intolérance dans ses propres rangs en sauvant, à ses
ris qu es et périls, des moines injustement condamnés.
Sa
fraternité est sans limites : s'il rencontre les frères de la
Bonne- Trogne ou, vivant en secret, les frères des Bois, il
y a surtout la grande camaraderie avec Lamme Goedzak,
« mon frère et am i », une cordialité profondément tendre
dans le respect mutuel, dont il n'est pas d'exemple
depuis Homère.
Tout, dans ce récit picaresque : ripaille,
paillardise, raillerie, bataille, fiançailles, traduit un
extraordinaire amour de la vie.
Et si dans 1' odyssée rabe
laisienne la quête de la Dive Bouteille débouche sur le
salut individuel, dans la Légende -comme dans les
mythologies -, le jeune fripon se transcende, à la fin,
en sauveur.
Non pas d'un seul, mais de tous : «Je mar
cherai pour le bonheur de la Terre des Pères ».
L'espi ègle
se fait fondateur de civilisation, ayant travaillé au pro
grès de l'humanité.
Ami des peintres, présents et passés, auteur d'une
fresque à la cou leu r hardie, De Coster fut un visionnaire
libre penseur.
Certes, la cle f maçonnique par aîtr a fermer
1' œuvre à qui ignore que le symbolisme de la tolérance
implique l'ouverture à la pluralité des sens, à ceux qui
douteraient que le maçonnisme est un humanisme.
En
tout cas, au cœur du néophyte, le travail littéraire germe
et peut éclore pendant son « apprentissage>), et, pour
a c cé d er à la « maît rise », De Coster a donné un chef
d'œuvre universel, à l'architecture puissante-comme
si le temple avait libéré son génie.
Cet anticlérical se
parfait ainsi « catholique » non romain ou, au sens pre
mier du terme, «œcuménique>> .
[Voir aussi BELGIQUE.
Littérature d'expression française].
···-
...........
----------------.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- BERNSTEIN Henry Léon Gustave Charles : sa vie et son oeuvre
- SAINT-PIERRE, Charles Irénée Castel, abbé de (vie et oeuvre)
- BONNET Charles : sa vie et son oeuvre
- SAINT-ÉVREMOND, Charles de Marguetel de Saint Denis, seigneur de (vie et oeuvre)
- Le Brun, Charles - vie et oeuvre du peintre.