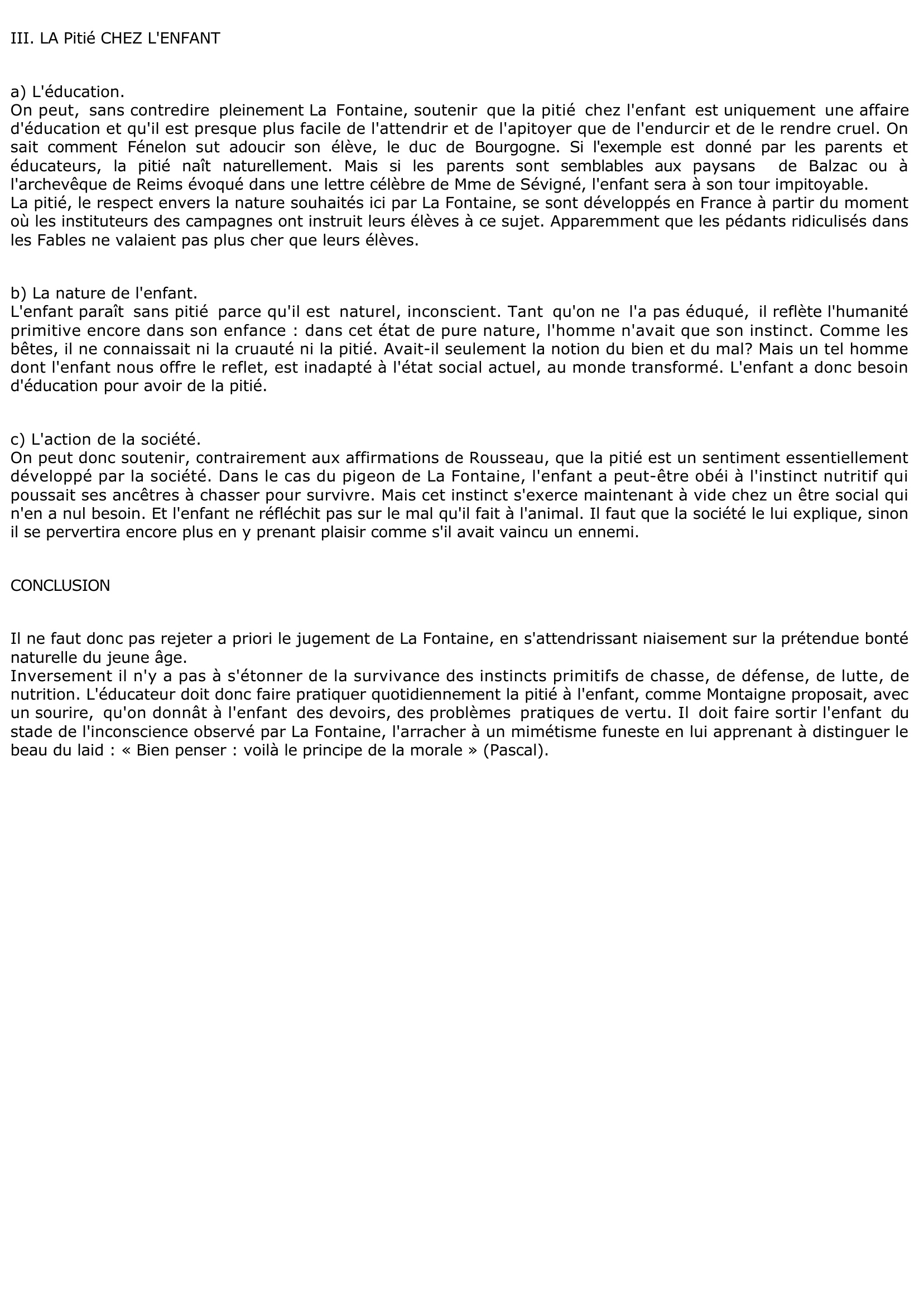Dans sa fable intitulée Les Deux Pigeons (IX, 2, v.54), La Fontaine écrit : « un fripon d'enfant (cet âge est sans pitié) » Après avoir recherché les causes qui ont pu amener La Fontaine à formuler ce jugement sévère, vous direz quelles réflexions il vous suggère.
Publié le 18/02/2011

Extrait du document

Depuis La Fontaine jusqu'au début du XXe siècle, la critique a désapprouvé la sévérité avec laquelle le fabuliste jugeait les enfants, On ne croyait pas que cet âge fût « sans pitié «. En 1968 l'actualité nous force à reconsidérer le problème. Et l'on est tenté de se demander si en définitive le « bonhomme « n'avait pas raison.

«
III.
LA Pitié CHEZ L'ENFANT
a) L'éducation.On peut, sans contredire pleinement La Fontaine, soutenir que la pitié chez l'enfant est uniquement une affaired'éducation et qu'il est presque plus facile de l'attendrir et de l'apitoyer que de l'endurcir et de le rendre cruel.
Onsait comment Fénelon sut adoucir son élève, le duc de Bourgogne.
Si l'exemple est donné par les parents etéducateurs, la pitié naît naturellement.
Mais si les parents sont semblables aux paysans de Balzac ou àl'archevêque de Reims évoqué dans une lettre célèbre de Mme de Sévigné, l'enfant sera à son tour impitoyable.La pitié, le respect envers la nature souhaités ici par La Fontaine, se sont développés en France à partir du momentoù les instituteurs des campagnes ont instruit leurs élèves à ce sujet.
Apparemment que les pédants ridiculisés dansles Fables ne valaient pas plus cher que leurs élèves.
b) La nature de l'enfant.L'enfant paraît sans pitié parce qu'il est naturel, inconscient.
Tant qu'on ne l'a pas éduqué, il reflète l'humanitéprimitive encore dans son enfance : dans cet état de pure nature, l'homme n'avait que son instinct.
Comme lesbêtes, il ne connaissait ni la cruauté ni la pitié.
Avait-il seulement la notion du bien et du mal? Mais un tel hommedont l'enfant nous offre le reflet, est inadapté à l'état social actuel, au monde transformé.
L'enfant a donc besoind'éducation pour avoir de la pitié.
c) L'action de la société.On peut donc soutenir, contrairement aux affirmations de Rousseau, que la pitié est un sentiment essentiellementdéveloppé par la société.
Dans le cas du pigeon de La Fontaine, l'enfant a peut-être obéi à l'instinct nutritif quipoussait ses ancêtres à chasser pour survivre.
Mais cet instinct s'exerce maintenant à vide chez un être social quin'en a nul besoin.
Et l'enfant ne réfléchit pas sur le mal qu'il fait à l'animal.
Il faut que la société le lui explique, sinonil se pervertira encore plus en y prenant plaisir comme s'il avait vaincu un ennemi.
CONCLUSION
Il ne faut donc pas rejeter a priori le jugement de La Fontaine, en s'attendrissant niaisement sur la prétendue bonténaturelle du jeune âge.Inversement il n'y a pas à s'étonner de la survivance des instincts primitifs de chasse, de défense, de lutte, denutrition.
L'éducateur doit donc faire pratiquer quotidiennement la pitié à l'enfant, comme Montaigne proposait, avecun sourire, qu'on donnât à l'enfant des devoirs, des problèmes pratiques de vertu.
Il doit faire sortir l'enfant dustade de l'inconscience observé par La Fontaine, l'arracher à un mimétisme funeste en lui apprenant à distinguer lebeau du laid : « Bien penser : voilà le principe de la morale » (Pascal)..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- « La fable pour La Fontaine n'a été le plus souvent qu'un prétexte au récit, au conte, à la rêverie; la moralité s'y ajuste à la fin comme elle peut,», écrit le critique Sainte-Beuve (Lundis, VII). A la lumière des fables que vous avez étudiées, vous direz si vous partagez ce jugement. ?
- « Une fable de La Fontaine est toujours un monde en raccourci », écrit Léon-Paul Fargue (Tableau de la littérature française, 1939). Vous apprécierez ce jugement à la lumière des fables que vous avez étudiées. ?
- « Les Fables de La Fontaine sont plutôt la philosophie dure, froide et égoïste du vieillard, que la philosophie aimante, généreuse, naïve et bonne d'un enfant », écrit, en 1849, Lamartine dans la préface à la réédition de ses Premières méditations. Vous commenterez ce jugement en vous appuyant sur les fables que vous avez étudiées. ?
- Lamartine écrit dans la Préface de ses Méditations (1849) : « Les fables de La Fontaine sont plutôt la philosophie dure, froide et égoïste d'un vieillard, que la philosophie aimante, généreuse, naïve et bonne d'un enfant : c'est du fiel, ce n'est pas du lait pour les lèvres et pour les coeurs de cet âge. »
- « Les longs ouvrages me font peur», écrit La Fontaine dans l'Épilogue du Livre VI. A la lumière des fables contenues dans les Livres VII à XII, vous direz en quoi cette confidence du fabuliste éclaire son art poétique. ?