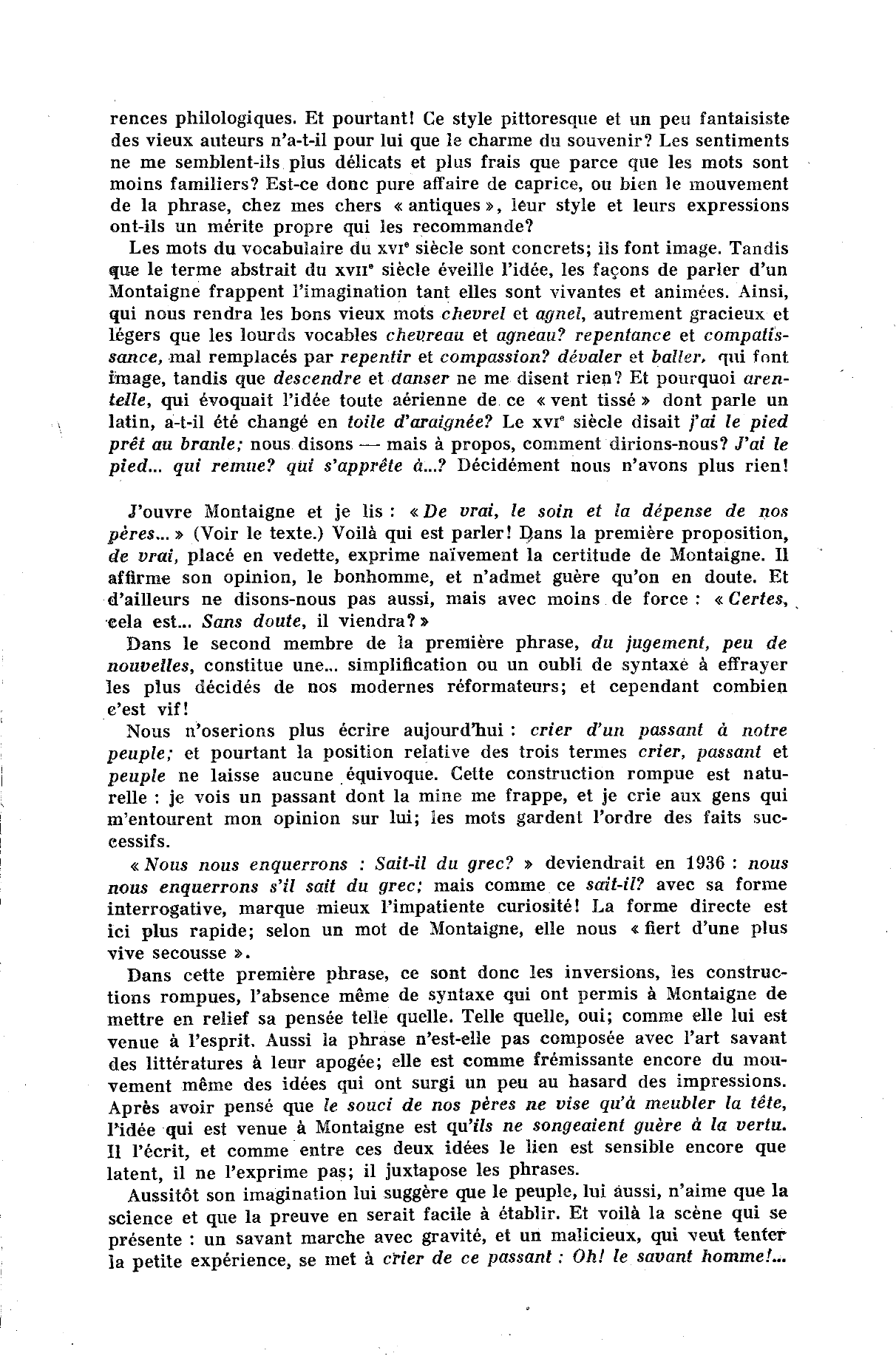Comparaison de textes: Montaigne, Descartes
Publié le 13/02/2012
Extrait du document

Comparer les deux textes suivants, l'un de Montaigne, l'autre de Descartes, et rechercher, en y étudiant la structure de la phrase et le mouvement général du style, dans quelle mesure La Bruyère et Fénelon ont eu raison de regretter le vieux langage.
1. - « De vrai le soin et la dépense de nos pères ne visent qu'à meubler la tête de sciences; du jugement et de la vertu, peu de nouvelles. Crier d'un passant à notre peuple : « Oh! le savant homme! « et d'un autre : « Oh ! le bon homme ! «, il ne faudra pas (manquera pas) à détourner les yeux et son respect sur le premier.
Il y faudrait (serait besoin) d'un tiers criant : « Oh les lourdes têtes!« - Nous nous enquerrons volontiers : « Sait-il du grec et du latin? « et non s'il est devenu meilleur et plus avisé. C'était le principal et c'est ce qui demeure derrière.« (Montaigne. - Essais.)
II. - « Le monde n'est quasi composé que de deux sortes d'esprits, auxquels il ne convient pas de se défaire des opinions qu'on a cru auparavant, à savoir : de ceux qui, se croyant plus habiles qu'ils ne sont, ne se peuvent empêcher de précipiter leurs jugements ni avoir assez de patience pour conduire par ordre toutes leurs pensées, d'où vient que s'ils avaient une fois pris la liberté de douter des principes qu'ils ont reçus et de s'écarter du commun chemin, jamais ils ne pourraient tenir le chemin qu'il faut prendre pour aller plus droit, et demeureraient égarés toute leur vie; puis de ceux qui, ayant assez de raison et de modestie pour juger qu'ils sont moins capables de distinguer le vrai d'avec le faux que quelques autres par lesquels il doivent être instruits, doivent bien plutôt se contenter de suivre les opinions de ces autres qu'en chercher eux-mêmes de meilleures. « (Descartes - Discours de la Méthode.)

«
rences philologiques.
Et pourtant! Ce style pittoresque et un peu fantaisiste
des vieux auteurs n'a-t-il pour lui que le charme du souvenir? Les sentiments
ne me semblent -ils, plus delicats et plus frais que parce que les mots sont
moins familiers? Est-ce donc pure affaire de caprice, ou bien le mouvement
de la phrase, chez mes chers « antiques v, leur style et leurs expressions
ont-ils un merite propre qui les recommande?
Les mots du vocabulaire du xvie siècle sent concrets; ils font image.
Tandis
que le terme abstrait du xvire siècle evade l'idee, les fawns de parler d'un
Montaigne frappent l'imagination tant elles sont vivantes et animees.
Ainsi,
qui nous rendra les bons vieux mots chevrel et agnel, autrement gracieux et
legers que les lourds vocables chevreau et agneau? repentance et compatis-
sance, mal remplaces par repentir et compassion? devaler et bailer, qui font
image, tandis que descendre et danser ne me disent rien? Et pourquoi aren-
telle, qui evoquait l'idee toute aerienne de ce « vent tisse v dont paHe un
latin, a-t-il ete change en toile d'araignee? Le xvi' siècle disait j'ai le pied
pret au branle; nous disons - mais a propos, comment dirions-nous? rat le
pied...
qui remue? qui s'apprete a...? Decidement nous n'avons plus rien!
J'ouvre Montaigne et je lis : «De vrai, le soin et la depense de nos
peres...» (Voir le texte.) Voila qui est parler! Dans la premiere proposition,
de vrai, place en vedette, exprime naivement la certitude de Montaigne.
Il
affirme son opinion, le bonhomme, et n'admet guere qu'on en doute.
Et
d'ailleurs ne disons-nous pas aussi, mais avec moins de force : « Certes,
vela est...
Sans doute, it viendra? Dans le second membre de la premiere phrase, du jugement, pea de
nouvelles, constitue une...
simplification ou un oubli de syntaxe a effrayer
les plus decides de nos modernes reformateurs; et cependant combien
e'est vif! Nous n'oserions plus ecrire aujourd'hui : crier d'un passant a notre
peuple; et pourtant la position relative des trois termes crier, passant et peuple ne laisse aucune equivoque.
Cette construction rompue est natu-
relle : je vois un passant dont la mine me frappe, et je crie aux gens qui
m'entourent mon opinion sur lui; les mots gardent l'ordre des faits suc-
eessifs.
«Nous nous enquerrons : Sait-il du grec? > deviendrait en 1936: nous
nous enquerrons s'il sait du grec; mais comme ce sait-il? avec sa forme
interrogative, marque mieux l'impatiente curiosite! La forme directe est
ici plus rapide; selon un mot de Montaigne, elle nous « fiert d'une plus
vive secousse Dans cette premiere phrase, ce sont done les inversions, les construc-
tions rompues, l'absence meme de syntaxe qui ont permis a Montaigne de
mettre en relief sa pensee telle quelle.
Telle quelle, oui; comme elle lui est
venue a l'esprit.
Aussi la phrase n'est-elle pas composee avec l'art savant
des litteratures a leur apogee; elle est comme fremissante encore du mou-
vement meme des idees qui ont surgi un peu au hasard des impressions.
Apres avoir pense que le souci de nos peres ne vise qu'a nimbler la tete,
l'idee qui est venue a Montaigne est qu'ils ne songeaient guere a la vertu.
Il l'ecrit, et comme entre ces deux idees le lien est sensible encore que
latent, it ne l'exprime pas; it juxtapose les phrases.
Aussitot son imagination lui suggere que le peuple, lui aussi, n'aime que la
science et que la preuve en serait facile a etablir.
Et voila la scene qui se
presente : un savant marche avec gravite, et un malicieux, qui Neut tenter
la petite experience, se met a crier de ce passant : Oh! le savant homme!...
'
renees philologiques.
Et pourtant! Ce style pittoresque et un peu fantaisiste
des vieux auteurs n'a-t-il pour lui que le charme du souvenir? Les sentiments
ne me semblent-ils.
plus délicats et plus frais que parce que les mots sont
moins familiers? Est-ce donc pure affaire de caprice, ou bien le mouvement
de la phrase, chez mes chers « antiques », léur style et leurs expressions
ont-ils un mérite propre qui les recommande?
Les
mots du vocabulaire du XVI" siècle sont concrets; ils font image.
Tandis
flue le terme abstrait du xvu• siècle éveille l'idée, les façons de parler d'un
Montaigne frappent l'imagination tant elles sont vivantes et animées.
Ainsi,
qui nous rendra les bons vieux mots chevre[ et agnel, ·autrement gracieux et
lêgers que les lourds vocables cheureau et agneau? repentance et compatis
sance,
mal remplacés par repentir et compassion? dévaler et baller, rtni font
image, tandis que descendre et danser ne me disent rien? Et pourquoi aren
telle,
qui évoquait l'idée toute aérienne de.
ce « vent tissé » dont parle un
latin, a-t-il été changé en toile d'araignée? Le xvi" siècle disait j'ai le pied
prêt au branle; nous disons- mais à propos, comment dirions-nous? J'ai le
pied ...
qui remue? qui s'apprête à ...
? Décidément nous n'avons plus rien!
J'ouvre Montaigne et je lis : «De vrai, le soin et la dépense de 1!-0S
pères ...
» (Voir le texte.) Voilà qui est parler! I}ans la première proposition,
de vrai, placé en vedette, exprime naïvement la certitude de Montaigne.
Il
affirme son opinion, le bonhomme, et n'admet guère qu'on en doute.
Et
d'ailleurs ne disons-nous pas aussi, mais avec moins de force : «Certes,
·eela est...
Sans doute, il viendra? » ·
Dans le second membre de la première phrase, du jugement, peu de
nouvelles,
constitue une ...
simplification ou un oubli de syntaxe à effrayer
les plus décidés de nos modernes réformateurs; et cependant combien
e'est vif!
Nous
n'oserions plus écrire aujourd'hui : crier d'un passant à notre
peuple;
et pourtant la position relative des trois termes crier, passant et
peuple ne laisse aucune .
équivoque.
Cette construction rompue est natu
relle : je vois un passant dont la mine me frappe, et je crie aux gens qui
m'entourent mon opinion sur lui; les mots gardent l'ordre des faits suc
cessifs.
«Nous nous enquerrons : Sait-il du grec? » deviendrait en 1936 : nous
nous enquerrons s'il sait du grec;
mais comme.
ce sait-il? avec sa forme
interrogative, marque mieux l'impatiente curiosité! La forme directe est
ici plus rapide; selon un mot de Montaigne, elle nous « fiert d'une plus
vive secousse ».
Dans cette première phrase, ce sont donc les inversions, les construc
tions rompues, l'absence même de syntaxe qui ont permis à Montaigne de
mettre en relief sa pensée telle quelle.
Telle quelle, oui; comme elle lui est
venue à l'esprit.
Aussi la phrase n'est-elle pas composée avec l'art savant
des littératures à leur apogée; elle est comme frémissante encore du mou
vement même des idées qui ont surgi un peu au hasard des impressions.
Après
avoir pensé que le souci de nos pères ne vise qu'à meubler la tête,
l'idée qui est venue à Montaigne est qu'ils ne songeaient guère à la vertu.
Il l'écrit, et comme· entre ces deux idées le lien est sensible encore que
latent, il ne l'exprime pas; il juxtapose les phrases.
Aussitôt son imagination
lui suggère que le peuple, lui aussi, n'aime que la
science et que la preuve en serait facile à établir.
Et voilà la scène qui se
présente : un savant marche avec gravité, et un malicieux, qui veut tenter
la petite expérience, se met à crier de ce passant : Oh! le savant homme! •••.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Descartes: textes pour le bac
- Comparaison littéraire : Appréciation : Les points communs entre ces trois textes sont : .
- PASCAL CONTRE DESCARTES ET MONTAIGNE
- BLAISE PASCAL: LA SOLUTION DES PHILOSOPHES FACE A LA MISERE DE L'HOMME: Epictète, Montaigne et Descartes
- Descartes: Comparaison de l'imagination et de l'intellect