COMMYNES Philippe de : sa vie et son oeuvre
Publié le 22/11/2018

Extrait du document
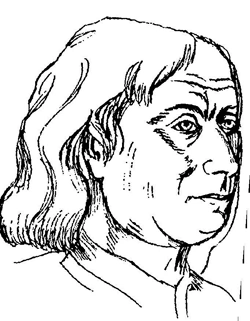
L'art d'un moraliste réaliste et habile
Cette œuvre frappe d’abord par le réalisme et le goût de la précision, des nuances, que l’on retrouve partout : dans sa politique et sa sociologie, qui se fondent sur la méchanceté, la cupidité et la déloyauté des hommes; dans sa psychologie, que ne dupent pas les apparences mensongères; mais surtout dans son style, éloquent à l’occasion, mais le plus souvent dense et nerveux, débarrassé des fioritures inutiles, refusant les jugements abrupts, les formules définitives, riche en réserves et limitations. Ce style procède à la fois d’un goût profond de l’exactitude, condition de la réussite, et de la volonté de persuader en donnant l’impression de ne rechercher que la vérité. De là, le refus d’un style luxuriant à la Froissait, des comparaisons et des assimilations prodiguées par Chastelain et Molinet, pour ôter aux princes une auréole de grandeur qu’ils ne possèdent pas et pour respecter la vérité : proche de Montaigne, Commynes est très sensible à l’originalité irréductible de chaque être et de chaque situation. Au plus, des images rares et discrètes, souvent ironiques, des termes précis et des détails concrets, de nature à entraîner l’adhésion. Cette volonté d’aller au plus près de la vérité, ce refus de tous les artifices, par ce souci de respecter la vérité à l’égard de tous, en toute liberté d’esprit, font que Commynes ne donne jamais l’impression de démontrer. De surcroît, il a senti que, pour donner l’illusion du vrai, en restant fidèle à la vérité, il fallait respecter l’ambiguïté du monde. Aussi l’œuvre demeure-t-elle souvent ambivalente, et l’art de l’auteur n’y est pas étranger : il reproduit les jugements d’autrui sans indiquer sa propre pensée, il s’en tient à des pronoms indéfinis, il renvoie dos à dos deux adversaires, tel ou tel passage est susceptible d’une double interprétation, en sorte que nous ne pouvons plus deviner quels sont ses sentiments à l’égard des personnages évoqués.
COMMYNES Philippe de (1447-1511). Dès que l’on s’interroge sur la vie, la pensée politique et l’art de Com-mynes, on est frappé par l’étonnante complexité de l'homme, du penseur et de l’écrivain. Aussi s’explique-t-on qu’il ait suscité une vive attention et des jugements contradictoires depuis la première édition de ses Mémoires en avril 1524. Hanté, selon Ronsard, par le souci de la vérité, il fut un traître répugnant aux yeux de Voltaire, hésitant à dire ce qu'il savait même après la mort de Louis XI. Montaigne le jugea modeste, Walter Scott, vaniteux. Anti-Machiavel pour Innocent Gentillet, un des classiques de la pensée politique au xvic siècle, « notre Machiavel en douceur » selon Sainte-Beuve, intellectuel pur d’après Marcel Arland mais paysan pour Henri Pourrat, on l'a comparé à Polybe, à Thucydide, à Plutarque, à Tacite, à Holbein, à Talleyrand, à Paul-Louis Courier.
Né dans une famille de hauts fonctionnaires bourguignons, il perd tout jeune son père; de graves difficultés financières limitent son éducation. Au service du duc de Bourgogne, il participe à la bataille de Montlhéry (1465), aux négociations qui la suivent et aux expéditions punitives contre les villes belges révoltées. Conseiller et chambellan de Charles le Téméraire, il aide, lors de l’entrevue de Péronne (1468), à tirer Louis XI des griffes de son vassal. Il continue à accomplir pour le duc des missions à l’étranger : à Calais (1470), en Angleterre (1471), en Bretagne, puis en Espagne (été 1471). Au cours de ce dernier voyage, il passe par la cour de France et accepte de changer de camp. Il le fait dans la nuit du 7 au 8 août 1472. Louis XI ne lésina pas sur le prix, lui accordant une substantielle pension, des biens considérables, le mariage avec une riche héritière, des titres; surtout il fit de lui un ministre tout-puissant.
Mais cette situation exceptionnelle dura moins de cinq ans; peu après la mort du Téméraire (janvier 1477), Com-mynes, supplanté par d’autres favoris, tomba dans une sorte de demi-disgrâce, et il fut envoyé tour à tour à Dijon, à Florence, en Piémont. Revenu à la cour, mais sans avoir retrouvé sa puissance, il défendit les intérêts italiens et assista au vieillissement, puis à la mort de Louis XI (août 1483).
S’il joua un rôle aux États généraux de 1484, il dut restituer sa principauté de Talmont aux La Trémoille qui en avaient été injustement dépossédés. Il complota avec Louis d'Orléans contre les Beaujeu, les régents, mais il échoua complètement : chassé de la cour, emprisonné de janvier 1487 à mars 1489, condamné le 24 mars 1489 à l’exil dans une de ses propriétés et à la confiscation du quart de ses biens, il se retira à Dreux.
Gracié, il demeura suspect. Pendant l’expédition d’Italie (1494-1495), il représenta Charles VIII à Venise; il ne put empêcher la formation contre le roi de la Sainte Ligue. Il assista à la bataille de Fornoue, conclut le traité de Verceil. Il échoua dans de nouvelles missions diplomatiques à Venise et à Milan; aussi, revenu en France, fut-il rejeté au second plan.
La montée sur le trône, en 1498, de Louis XII, jusqu’alors duc d'Orléans, n’apporta aucun changement pour lui : éloigné des affaires publiques, occupé à plaider contre des vassaux ou des voisins, il termina ses jours le 18 octobre 1511.
La chronologie des Mémoires
Commynes rédigea les cinq premiers livres des Mémoires en 1489-1490, au sortir de prison; il leur ajouta, en 1492-1493, le sixième. Quant aux livres VII et VIII, consacrés à l’expédition de Charles VIII en Italie, ils datent, le premier, de la fin de 1495 et du début de 1496, le second, de la fin de 1497 et de 1498. Commynes commença de rassembler et de rédiger ses souvenirs sur Louis XI à la demande d’Angelo Cato, archevêque de Vienne, Napolitain entré au service de Louis XI vers 1476 comme médecin et astrologue. Il n'est donc pas étonnant qu’à l’occasion il flatte Cato et ménage ses amis. Mais, au fur et à mesure qu’il avançait, ou peut-être même dès le début — soit que l’œuvre ne fût destinée qu’à procurer des documents à Cato, soit qu’elle acquît très vite son autonomie —, Commynes eut conscience de la possibilité qui lui était offerte d’exalter son rôle, voire de se venger. Il pouvait à tout le moins orienter ou déformer quelque peu l’histoire. En fait, il poursuivit ses Mémoires après la mort de Cato et, de temps à autre, il s’adressa directement aux princes. Il semble aussi qu’il ait pris goût à l’écriture.
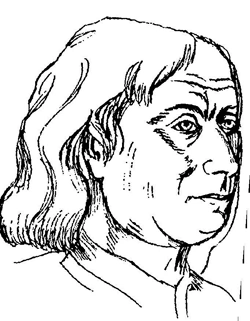
«
Le
poids de la trahison
L'abandon de Charles le Téméraire fut pour Commy
nes le fait capital de sa vie, d'autant plus important qu'il
fut un traître à ses yeux et aux yeux des autres, et qu'il
ne cessa de se le reprocher, plus ou moins consciemment.
Il s'efforça de prouver qu'il avait eu raison de changer
de camp, n'étant pas certain d'avoir le droit pour lui.
Il
ne cessa de Je reprocher au Téméraire et à Louis XI, qui
l'avaient amené à trahir, le premier par son emportement,
son entêtement et sa parcimonie, le second en l'alléchant
par des promesses et de l'argent, puis en le contraignant
à franchir le pas décisif.
La défection eut dans la vie et
les réflexions du mémorialiste un grand retentissement,
comme le montrent plusieurs faits.
Des digressions lui
permettent d'élimjner Je mois d'août 1471, au cours
duquel il promü sans doute à Louis Xl de le rejoindre.
Il
signale sa venue à la cour de France par une seule phrase,
qui est précédée de pages où il présente les défauts et
les crimes du Téméraire et suivie de l'étude d'un cas
semblable, celui de Lescun, qu'il invite à juger plus
grave.
Quant à ceux qui ont joué un rôle dans sa défec
tion ou dans le"> actes qui en ont découlé, il ne les cite
que pour les critiquer, afin sans doute d'éloigner de
l'esprit du lecteur tout soupçon de collusion entre ces
gens et lui.
ou leur reproche d'avoir facilité la conclusion
d'un accord qu'il considère maintenant comme une faute
et comme une erreur.
Car, en changeant de camp, il
croyait faire une bonne affaire au double point de vue
politique et financier, c'est-à-dire se créer un fief dans
l'ouest de la France (Talmont.
Argenton) et inspirer le
comportement de Louis XI.
Or, après cinq années heu
reuses de toute-puissance (1472-1477), ses espoirs com
mencèrent à être déçus.
Pour se fondre dans la masse, Commynes persuade
peu à peu son lecteur que la trahison est un fait universel
dont ses Mémoires constituent une véritable anthologie.
Il s'acharne à découvrir, puis à suggérer dans la vie de
chacun le signe d'une traîtrise, jetant le doute sur des
gens qui passaient pour des modèles de loyauté (Pierre
de Brézé) ou des ennemjs de Louis Xl (Hastings), ou qui
étaient morts sans avoir eu le temps de changer de camp
(Humbercourt et Hugonet).
Il démontre en douceur que
certaines défections ont été plus graves que la sienne
(Lescun, Crèvecœur), que grands et petits, hommes et
femmes, clercs et laïcs, Français et étrangers, individus
et collectivités, familiers et ambassadeurs des princes
ont trahi, trahi>sent ou trahiront.
Il n'y a pas dans son
univers de héros fidèle jusqu'à la mort.
Tl semble aussi que l'abandon du pays natal et de son
duc soit resté comme une plaie saignante au cœur de cet
homme qui se couvrit le visage d'un masque d'impassi
bilité, au point de tromper nombre de commentateurs.
Après avoir wmpu ces premiers liens, il demeura un
déraciné et un >olitaire.
Sa défection a donc déterminé, pour une bonne part,
son attitude à l'égard du duc de Bourgogne qu'il avait
abandonné.
Peu à peu, il parvient à nous convaincre qu'il
a eu raison de quitter ce premier maître.
Si l'on considère
la réussite militaire ou politique, le Téméraire a désolé
sa maison, ruiné les efforts de ses prédécesseurs, étant
constamment inférieur à Louis Xl dans la conduite de la
guerre et la négociation.
La bataille de Montlhéry (1465)
et le siège de Beauvais (1472) témoignent qu'il ne fut
pas un grand capitaine, et ses fautes sont énumérées.
Peu
importe le succès, dira-t-on, s'il a été le «patron de
chevalerie » (Molinet).
Commynes démontre que le duc,
héros exemplaire de ce monde sournois et dur, a été
orgueilleux, impitoyable et cruel, déloyal et parjure.
Son
comportement criminel lui valut d'être abandonné, puis
châtié par Dieu, qui lui ôta l'intelligence.
N'est-ce pas suggérer
que Commynes avait eu raison de fuir celui que
le ciel allait frapper?
Son attitude en face de Louis XI est plus complexe.
11
veut que l'on voie en lui un homme reconnaissant pour
les bienfaits reçus, et tout autant un esprit libre.
D'autre
part, comme il a préféré Louis XI au Téméraire, le pre
mier doit apparaître supérieur au second; mais il ressent
de la rancœur envers le roi, qui ne lui a pas conservé
jusqu'au bout une faveur entière, en sorte qu'il ne mas
que pas certaines fautes ou faiblesses.
De surcroît, il lui
faut passer pour un bon serviteur de l'État jouant un
grand rôle dans l'élaboration des succès royaux.
Enfin,
il illustre une idée qui lui est chère : les princes ne
sont pas des images de Dieu, ils n'échappent pas aux
vicissitudes de la condition humaine, ne connaissant ni
perfection, ni bonheur, ni grandeur.
Aussi trace-t-il un
portrait assez véridique de Louis Xl, encore que sa criti
que s'exerce surtout sur les périodes qui vont d.e 1464 à
1472 et de 1477 à 1483, quand il n'a pas ou n'a plus
d'influence sur la politique royale.
Enfin, Commynes essuya aussi des échecs.
Il com
mença à dicter ses Mémoires juste après avoir connu
la prison pour avoir participé, pendant la minorité de
Charles VUI, aux complots des orléanistes contre les
Beaujeu.
Traçant son propre portraü, il voulut faire
oublier ses insuccès et effacer la méfiance.
Aussi tend-il
à montrer qu'on a intérêt à l'employer- n'est-il pa
habile, prudent, bien informé, supérieur à ses contempo
rains? -et qu'on peut l'employer sans crainte, car il
est fidèle, dévoué jusque dans les plus petites choses,
soignant Louis Xl comme un humble valet de chambre.
Mais il faut éviter de simplifier un auteur aussi intelli
gent que Commynes qui a un sens aigu de l'ambiguïté et
de la complexité d'un réel difficile à saisir dans sa tota
lité, dont la connaissance précise est nécessaire à la réus
site politique.
Aussi est-il nuancé et prudent, au point de
nous laisser souvent le choix entre deux interprétations.
Un portrait lucide des princes
Sa lucidité s'est exercée sur l'uillvers et le comporte
ment des princes, hommes comme nous, écartant tous les
masques du faste princier, tournois, ordres de chevalerie,
comparaisons élogieuses, pour montrer les rapports
réels.
Les fils haïssent leurs pères, les trompent, les
emprisonnent, le,s tuent; les exemples ne manquent pas
en France, en Ecosse, au duché de Gueldre.
Partout
règnent la déloyauté, l'envie, la cupidité, la méfiance, la
haine, comme le montrent des thèmes privilégiés : les
princes accordent à contrecœur l'hospitalité à des alliés
malheureux qui ne se sentent pas en sécurité chez eux;
beaucoup ont usurpé leur trône; les mariages font l'objet
de tractations misérables ou sont imposés par les circons
tances; des engagements solennels ne sont pas tenus; les
rencontres entre princes sont dangereuses et n'apportent
qu'inimitié et méfiance.
Il en est de même dans les rap
ports avec les sujets : pas de confiance ni d'affection.
mais chacun s'efforce d'affaiblir l'autre.
Égoïstes et
déloyaux, les maîtres font fi du bonheur de leurs sujets,
ou à la fin de leur vie, et trop tard, quand ils redoutent la
mort.
Ils ne connaissent le bonheur ni dans la jeunesse ni au
sommet de leur puissance, dévorés par des soucis sou
vent injustifiés ou bien contraints à l'exil, ou terrorisés
par le succès de leurs ennemis, ou humiliés, emp rison
nés, exécutés.
Ils souffrent par leurs enfants.
Que dire de
la fin de leur vie? Commynes suit pas à pas les effets du
vieillissement chez Louis XI, et décrit les horreurs de la
mort qui est toujours la plus cruelle possible.
Dieu ne les
épargne pas : il rend coup pour coup et châtie durement
les coupables..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Champaigne, Philippe de - vie et oeuvre du peintre.
- JACCOTTET Philippe : sa vie et son oeuvre
- HÉRIAT Philippe : sa vie et son oeuvre
- QUINAULT Philippe : sa vie et son oeuvre
- DANGEAU, Philippe de Courcillon : sa vie et son oeuvre

































