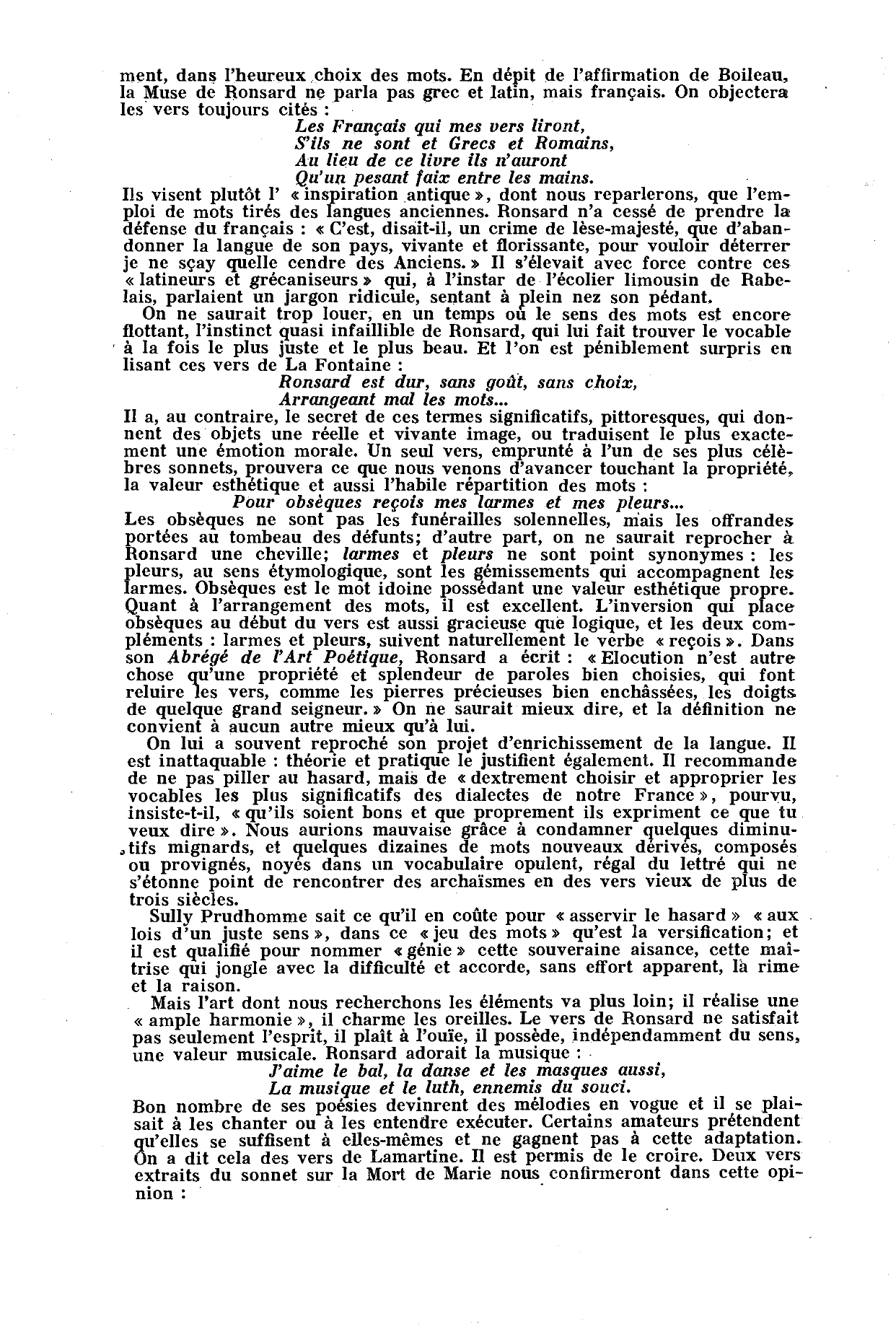Commenter ce sonnet de Sully Prudhomme : A Ronsard
Publié le 15/02/2012
Extrait du document
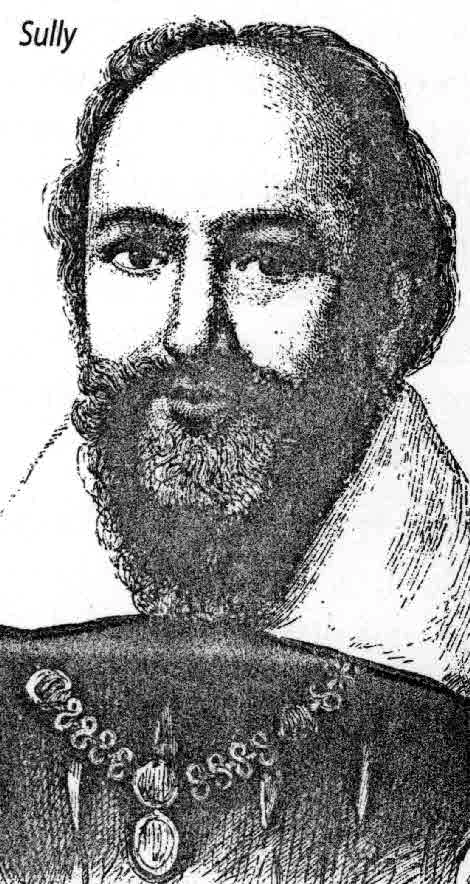
Sainte Beuve, en 1828, dédia à Ronsard un « sonnet expiatoire «. Le Romantisme tenait à prouver qu'il adorait ce qu'avait brûle l'auteur de l'Art poétique. Réhabilitation assez timide; tout au moins assez peu explicite.
Le Parnasse, à son tour, apporte son tribut d'hommage au vieux maitre, en qui il admire surtout l'artiste, l'helléniste. Glatigny et Th. de Banville lui consacrent des "odelettes"; Heredia, Coppèe, Sully, Prudhomme, Pierre de Nolhac, Paul Bourget lui riment des sonnets. Celui que nous avons à commenter nous paraît à la fois plus enthousiaste, plus précis que ....
le sonnet du grand critique et plus ample que celui d'es auteurs précités.
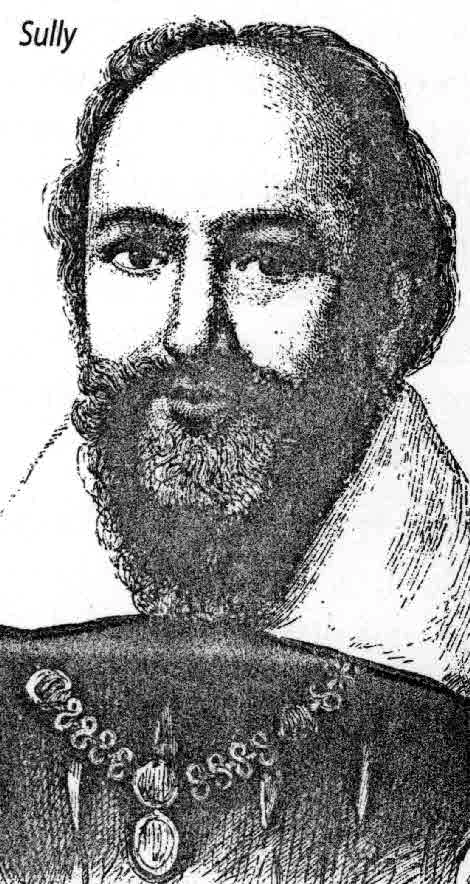
«
ment, dans l'heureux choix des mots.
En depit de ('affirmation de Boileau,
la Muse de Ronsard ne parla pas grec et latin, mais francais.
On objectera
les vers toujours cites : Les Francais qui mes vers liront,
S'ils ne sont et Grecs et Romains,
Au lieu de ce livre ils n'auront
Qu'un pesant faix entre les mains.
Its visent pint& « inspiration antique », dont nous reparlerons, que l'em-
ploi de mots tires des langues anciennes.
Ronsard n'a cesse de prendre in
defense du francais : « C'est, disait-il, un crime de lese-majeste, que d'aban-
donner la langue de son pays, vivante et florissante, pour vouloir deterrer
je ne scay quelle cendre des Anciens.
» II s'elevait avec force contre ces
« latineurs et grecaniseurs » qui, a l'instar de l' &oiler limousin de Rabe-
lais, parlaient un jargon ridicule, sentant a plein nez son pedant.
On ne saurait trop louer, en un temps ou le sens des mots est encore
flottant, l'instinct quasi infaillible de Ronsard, qui lui fait trouver le vocable
a la fois le plus juste et le plus beau.
Et l'on est peniblement surpris en
lisant ces vers de La Fontaine : Ronsard est dur, sans gout, sans choix,
Arrangeant mal les mots...
Il a, au contraire, le secret de ces termes significatifs, pittoresques, qui don-
nent des objets une reelle et vivante image, ou traduisent le plus exacte-
ment une emotion morale.
Un seul vers, emprunte a l'un de ses plus cele-
bres sonnets, prouvera ce que nous venons d'avancer touchant la propriete,
la valeur esthetique et aussi l'habile repartition des mots : Pour obseques recois mes larmes et mes pleurs...
Les obseques ne sont pas les funerailles solennelles, mais les offrandes
portees au tombeau des defunts; d'autre part, on ne saurait reprocher
Ronsard une cheville; larmes et pleurs ne sont point synonymes : les
pleurs, au sens etymologique, sont les gemissements qui accompagnent les
larmes.
Obseques est le mot idoine possedant une valeur esthetique propre.
Quanta l'arrangement des mots, il est excellent.
L'inversion qui place
obseques au debut du vers est aussi gracieuse que logique, et les deux com-
plements : larmes et pleurs, suivent naturellement le verbe « recois ».
Dans
son Abrege de l'Art Fatigue, Ronsard a emit : « Elocution n'est autre
chose qu'une propriete et splendeur de paroles bien choisies, qui font
reluire les vers, comme les pierres precieuses bien enchassees, les doigts
de quelque grand seigneur.
» On ne saurait mieux dire, et la definition ne
convient it aucun autre mieux qu'a lui.
On lui a souvent reproehe son projet d'enrichissement de la langue.
II
est inattaquable : theorie et pratique le justiflent egalement.
Il recommande
de ne pas piller au hasard, mais de « dextrement choisir et approprier les
vocables les plus significatifs des dialectes de notre France », pourvu,
insiste-t-il, « qu'ils soient bons et que proprement ils expriment ce que to veux dire ».
Nous aurions mauvaise grace a condamner quelques diminu-
,tifs mignards, et quelques dizaines de mots nouveaux derives, composes ou provignes, noyes dans un vocabulaire opulent, regal du lettre qui ne
s'efonne point de rencontrer des archaismes en des vers vieux de plus de
trois siecles.
Sully Prudhomme sait ce qu'il en conte pour « asservir le hasard » « aux
lois d'un juste sens », dans ce « jeu des mots » qu'est la versification; et
il est qualifie pour nommer « genie » cette souveraine aisance, cette mai-
trise qui jongle avec la difficulte et accorde, sans effort apparent, la rime
et la raison.
Mais l'art dont nous recherchons les elements va plus loin; il realise une
« ample harmonie », it charme les oreilles.
Le vers de Ronsard ne satisfait
pas seulement l'esprit, il plait it l'ouIe, it possede, independamment du sens,
une valeur musicale.
Ronsard adorait la musique : J'aime le bal, la danse et les masques aussi,
La musique et le luth, ennemis du souci.
Bon nombre de ses poesies devinrent des melodies en vogue et il se plai-
sait a les chanter ou a les entendre executer.
Certains amateurs pretendent
qu'elles se suffisent a elles-memes et ne gagnent pas it cette adaptation.
On a dit cela des vers de Lamartine.
Il est permis de le croire.
Deux vers extraits du sonnet sur la Mort de Marie noun confirmeront dans cette opi-
nion :
ment, dan~ l'heureux choix des mots.
En dépit de l'affirmation de Boileau, la Muse de Ronsard ne parla pas grec et latm, mais français.
On objectera les vers toujours cités : Les Français qui mes vers liront,
S'ils ne sont et Grecs et Romains, Au lieu de ce livre ils n'auront
Qu'un pesant faix entre les mains.
Ils visent plutôt l' « inspiration antique », dont nous reparlerons, que l'em ploi de mots tirés des langues anciennes.
Ronsard n'a cessé de prendre la défense du français : « C'est, disait-il, un crime de lèse-majesté,.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La Grande Chartreuse. Expliquez ce sonnet de Sully Prudhomme.
- Commentaire: Comment à travers ce sonnet, Ronsard exprime-t-il sa passion à sa Dame ?
- STANCES ET POÈMES de Sully-Prudhomme.
- SOLITUDES (Les) de Sully- Prudhomme (Résumé et analyse)
- Le reveil, de Sully de Prudhomme