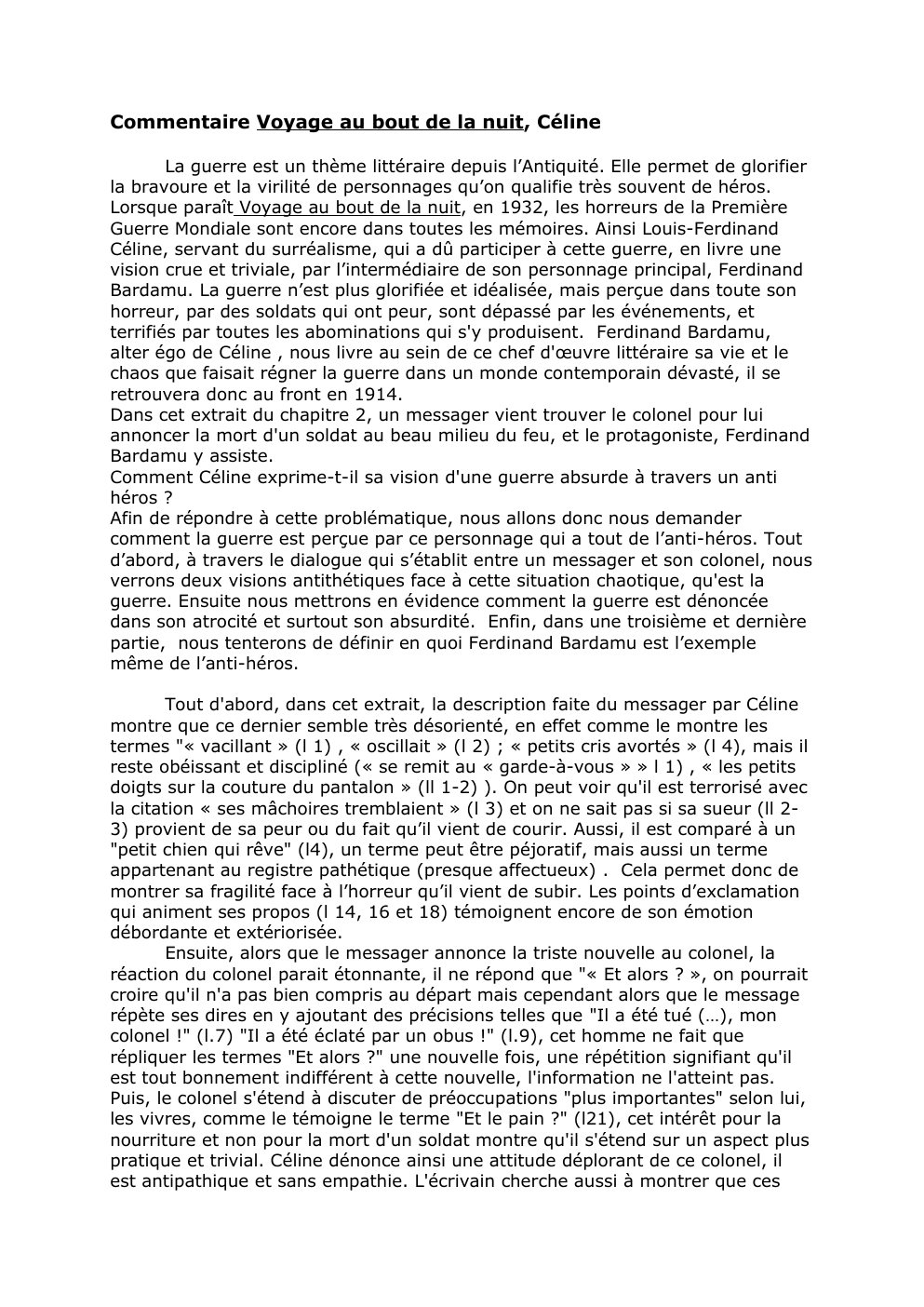commentaire voyage au bout de la nuit, céline
Publié le 05/12/2022
Extrait du document
«
Commentaire Voyage au bout de la nuit, Céline
La guerre est un thème littéraire depuis l’Antiquité.
Elle permet de glorifier
la bravoure et la virilité de personnages qu’on qualifie très souvent de héros.
Lorsque paraît Voyage au bout de la nuit, en 1932, les horreurs de la Première
Guerre Mondiale sont encore dans toutes les mémoires.
Ainsi Louis-Ferdinand
Céline, servant du surréalisme, qui a dû participer à cette guerre, en livre une
vision crue et triviale, par l’intermédiaire de son personnage principal, Ferdinand
Bardamu.
La guerre n’est plus glorifiée et idéalisée, mais perçue dans toute son
horreur, par des soldats qui ont peur, sont dépassé par les événements, et
terrifiés par toutes les abominations qui s'y produisent.
Ferdinand Bardamu,
alter égo de Céline , nous livre au sein de ce chef d'œuvre littéraire sa vie et le
chaos que faisait régner la guerre dans un monde contemporain dévasté, il se
retrouvera donc au front en 1914.
Dans cet extrait du chapitre 2, un messager vient trouver le colonel pour lui
annoncer la mort d'un soldat au beau milieu du feu, et le protagoniste, Ferdinand
Bardamu y assiste.
Comment Céline exprime-t-il sa vision d'une guerre absurde à travers un anti
héros ?
Afin de répondre à cette problématique, nous allons donc nous demander
comment la guerre est perçue par ce personnage qui a tout de l’anti-héros.
Tout
d’abord, à travers le dialogue qui s’établit entre un messager et son colonel, nous
verrons deux visions antithétiques face à cette situation chaotique, qu'est la
guerre.
Ensuite nous mettrons en évidence comment la guerre est dénoncée
dans son atrocité et surtout son absurdité.
Enfin, dans une troisième et dernière
partie, nous tenterons de définir en quoi Ferdinand Bardamu est l’exemple
même de l’anti-héros.
Tout d'abord, dans cet extrait, la description faite du messager par Céline
montre que ce dernier semble très désorienté, en effet comme le montre les
termes "« vacillant » (l 1) , « oscillait » (l 2) ; « petits cris avortés » (l 4), mais il
reste obéissant et discipliné (« se remit au « garde-à-vous » » l 1) , « les petits
doigts sur la couture du pantalon » (ll 1-2) ).
On peut voir qu'il est terrorisé avec
la citation « ses mâchoires tremblaient » (l 3) et on ne sait pas si sa sueur (ll 23) provient de sa peur ou du fait qu’il vient de courir.
Aussi, il est comparé à un
"petit chien qui rêve" (l4), un terme peut être péjoratif, mais aussi un terme
appartenant au registre pathétique (presque affectueux) .
Cela permet donc de
montrer sa fragilité face à l’horreur qu’il vient de subir.
Les points d’exclamation
qui animent ses propos (l 14, 16 et 18) témoignent encore de son émotion
débordante et extériorisée.
Ensuite, alors que le messager annonce la triste nouvelle au colonel, la
réaction du colonel parait étonnante, il ne répond que "« Et alors ? », on pourrait
croire qu'il n'a pas bien compris au départ mais cependant alors que le message
répète ses dires en y ajoutant des précisions telles que "Il a été tué (…), mon
colonel !" (l.7) "Il a été éclaté par un obus !" (l.9), cet homme ne fait que
répliquer les termes "Et alors ?" une nouvelle fois, une répétition signifiant qu'il
est tout bonnement indifférent à cette nouvelle, l'information ne l'atteint pas.
Puis, le colonel s'étend à discuter de préoccupations "plus importantes" selon lui,
les vivres, comme le témoigne le terme "Et le pain ?" (l21), cet intérêt pour la
nourriture et non pour la mort d'un soldat montre qu'il s'étend sur un aspect plus
pratique et trivial.
Céline dénonce ainsi une attitude déplorant de ce colonel, il
est antipathique et sans empathie.
L'écrivain cherche aussi à montrer que ces
réactions peuvent être expliquées par la situation actuelle.
En effet, la mort d'un
militaire est un évènement se produisant à maintes reprises au front, les chefs
militaires sont donc censés s'occuper de leurs militaires toujours en vie.
Un
contraste est alors fort présent entre les émotions exprimées par un jeune soldat
innocent et ignorant qui n'a jamais vécu de temps de guerre face à un homme de
guerre.
Au sein de ce discours entre le messager et le colonel, le lecteur peut être
témoin d'une incommunicabilité importante.
En effet, les deux interlocuteurs sont
trop différents pour se comprendre : on peut éprouver une certaine pitié pour le
messager, et réprouver l’attitude innommable du colonel.
Le soldat est paralysé
par la peur.
Dès que les hommes essaient de se parler, de se retrouver, ils
meurent, à l'image de Barousse.
Dans le dernier paragraphe, on remarque
l'ironie : les hommes se rencontrent dans la mort, quand ils ne sont plus qu'un
tas de chair.
A travers ce court échange entre deux officiers, on peut percevoir les
dures émotions que ressentent les soldats, décrites par ce que l'écrivain luimême a vécu, il exprime finalement ses propres ressentis à travers son roman.
Aussi, ce court dialogue montre bien l’incompréhension des soldats face à
l’attitude distante de leurs officiers (l18), marquant l'incompréhension et le dépit
du messager.
Le colonel semble ne pas se préoccuper du sort des soldats sous
ses ordres mais l’idée qu’on se fait de lui peut être nuancée par la remarque du
narrateur à la fin de cet extrait de texte avec la citation « Quant au colonel, lui,
je ne lui voulais pas de mal » (l 39).
Mais on peut aussi considérer que sa mort
répare comme une injustice.
En second lieu, la citation (qui pourrait émouvoir le
lecteur) décrit un homme qui semble encore bien pire que le colonel, comme on
peut le voir avec la remarque au discours direct du narrateur « une charogne en
moins » (l 34) ainsi que la phrase « sacrées ordures (…) comme Barousse » (l
38).
Le point de vue du narrateur est interne, le lecteur est témoin des scènes
à travers son regard étranger et ses pensées qui peuvent lui avoir été volées,
montrant ainsi à un lecteur ignorant face la dure réalité de la guerre.
Il écrit la
scène de façon ironique, marquée également par une sorte d’indifférence avec
les termes « Nos allemands » (l 6) et avec un possessif semblant être une
marque d’affection « leurs sottises » (l 7) alors qu’ils cherchent à tuer le plus
d’adversaires possibles : une nouvelle fois, un contraste est appuyé par l'auteur,
un décalage entre réalité et les propos tenus par le protagoniste, finement
ironiques.
Il y a aussi de nombreuses comparaisons telles que « comme de gros paquets
d’allumettes » (l 8) et, parfois, presque poétiques « comme des essaims de
balles rageuses, pointilleuses comme des guêpes » (l 9), une citation ici proche
d’une construction en chiasme avec "essaims" "guêpes entourant rageuses,
pointilleuses".
Au sein de toute cette violence sanglante, le personnage de
Bardamu paraît indifférent.
Il se réjouit cyniquement de la mort de Barousse car,
pour lui, ce dernier est « une bien grande charogne en moins dans le régiment !
».
Et l'on peut noter l'humour de Bardamu qui dit : « j'en connaissais bien encore
(...) de sacrées ordures que j'aurais aidé volontiers à trouver un obus comme
Barousse ».
Pourtant, son commentaire sur l'utilité de la guerre est ensuite
détruit car il dit : « Quand au colonel, lui, je ne lui voulais pas de mal.
Lui
pourtant aussi, il était mort ».
Le cynisme n'est qu'apparent et Bardamu, double
de Céline, condamne l'absurdité de toute cette horreur.
Même s'il ajoute « Tant
pis pour lui ! s'il était parti dès les premières balles, ça ne serait pas arrivé », le
lecteur sait qu'un officier de cette envergure ne peut pas s'enfuir et donc Céline
tient une nouvelle fois des propos ironiques par l'intermédiaire de son alter ego.
Malgré cette désinvolture apparente, on ressent l’émotion et le
traumatisme, à travers les propos du narrateur.
Même si, par sa façon de
raconter, il semblerait jeter un regard distancié sur une situation pourtant
terrible, il est bel et bien présent, malgré lui, sur le champ de bataille avec le
champ lexical du corps à la ligne 25, puis aux lignes 27 et 28.
On ressent
également ses émotions à travers les sensations exacerbées (celles de l’odorat,
de l’ouïe et d’une vue troublée par la....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentaire sur Voyage au bout de la nuit de LouisFerdinand Céline Extrait de la page 13 « Le colonel, c’était donc un monstre !
- Commentaire Voyage au bout de la Nuit, Louis-Ferdinand Céline
- Commentaire Voyage au bout de la Nuit, Louis-Ferdinand Céline
- commentaire de Voyage au bout de la nuit de Louis Ferdinand Céline
- COMMENTAIRE DE TEXTE, Louis Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, chapitre 26