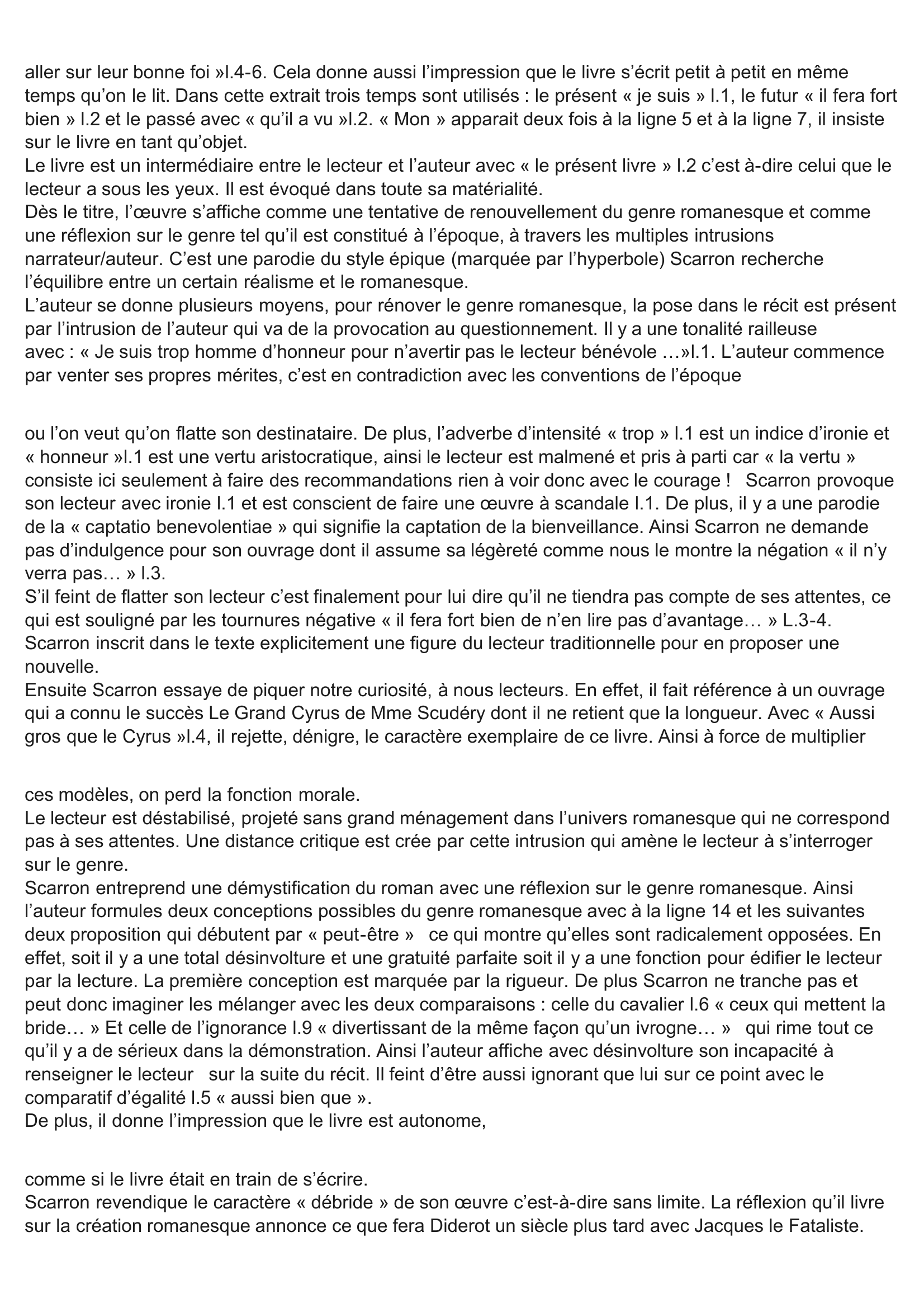Commentaire rédigé : Le Roman comique (1651-1657). Scarron
Publié le 05/01/2013
Extrait du document

Ensuite, il y a un jeu sur l’omniscience et l’omnipotence de l’auteur qui entraine une réflexion sur les
possibles narratifs et l’interrogation sur la liberté du récit. Scarron énonce aussi une fonction possible du
roman qui est une fonction morale, celle de rendre meilleur et pour cela il utilise d’autre voies que les
voies traditionnelles. En effet au lieu de héros, il s’intéresse aux petites gens et choisit, ici, des
personnages avec une situation moyenne qui est une situation contrastée avec le balancement l.8
marqué par « tantôt «… « Tantôt « qui donne à voir des actions répréhensibles. Il y a un chiasme à la
ligne 8 « Tantôt ridicules, tantôt blâmables « et la ligne 9 « pour son vice du plaisir … pour les
« impertinences « qui reprend « ridicules«.
De plus on retrouve les préceptes classiques: « docere «, « placere « et « movere « qui sont retrouvés
chez Molière («Castigat ridendo mores «) et chez la Fontaine, avec « j’instruirais en divertissant «.
Ensuite, il y a un retour au récit avec l’application de ses

«
aller sur leur bonne foi »l.4-6.
Cela donne aussi l’impression que le livre s’écrit petit à petit en même
temps qu’on le lit.
Dans cette extrait trois temps sont utilisés : le présent « je suis » l.1, le futur « il fera fort
bien » l.2 et le passé avec « qu’il a vu »l.2.
« Mon » apparait deux fois à la ligne 5 et à la ligne 7, il insiste
sur le livre en tant qu’objet.
Le livre est un intermédiaire entre le lecteur et l’auteur avec « le présent livre » l.2 c’est à-dire celui que le
lecteur a sous les yeux.
Il est évoqué dans toute sa matérialité.
Dès le titre, l’œuvre s’affiche comme une tentative de renouvellement du genre romanesque et comme
une réflexion sur le genre tel qu’il est constitué à l’époque, à travers les multiples intrusions
narrateur/auteur.
C’est une parodie du style épique (marquée par l’hyperbole) Scarron recherche
l’équilibre entre un certain réalisme et le romanesque.
L’auteur se donne plusieurs moyens, pour rénover le genre romanesque, la pose dans le récit est présent
par l’intrusion de l’auteur qui va de la provocation au questionnement.
Il y a une tonalité railleuse
avec : « Je suis trop homme d’honneur pour n’avertir pas le lecteur bénévole …»l.1.
L’auteur commence
par venter ses propres mérites, c’est en contradiction avec les conventions de l’époque
ou l’on veut qu’on flatte son destinataire.
De plus, l’adverbe d’intensité « trop » l.1 est un indice d’ironie et
« honneur »l.1 est une vertu aristocratique, ainsi le lecteur est malmené et pris à parti car « la vertu »
consiste ici seulement à faire des recommandations rien à voir donc avec le courage ! Scarron provoque
son lecteur avec ironie l.1 et est conscient de faire une œuvre à scandale l.1.
De plus, il y a une parodie
de la « captatio benevolentiae » qui signifie la captation de la bienveillance.
Ainsi Scarron ne demande
pas d’indulgence pour son ouvrage dont il assume sa légèreté comme nous le montre la négation « il n’y
verra pas… » l.3.
S’il feint de flatter son lecteur c’est finalement pour lui dire qu’il ne tiendra pas compte de ses attentes, ce
qui est souligné par les tournures négative « il fera fort bien de n’en lire pas d’avantage… » L.3-4.
Scarron inscrit dans le texte explicitement une figure du lecteur traditionnelle pour en proposer une
nouvelle.
Ensuite Scarron essaye de piquer notre curiosité, à nous lecteurs.
En effet, il fait référence à un ouvrage
qui a connu le succès Le Grand Cyrus de Mme Scudéry dont il ne retient que la longueur.
Avec « Aussi
gros que le Cyrus »l.4, il rejette, dénigre, le caractère exemplaire de ce livre.
Ainsi à force de multiplier
ces modèles, on perd la fonction morale.
Le lecteur est déstabilisé, projeté sans grand ménagement dans l’univers romanesque qui ne correspond
pas à ses attentes.
Une distance critique est crée par cette intrusion qui amène le lecteur à s’interroger
sur le genre.
Scarron entreprend une démystification du roman avec une réflexion sur le genre romanesque.
Ainsi
l’auteur formules deux conceptions possibles du genre romanesque avec à la ligne 14 et les suivantes
deux proposition qui débutent par « peut -être » ce qui montre qu’elles sont radicalement opposées.
En
effet, soit il y a une total désinvolture et une gratuité parfaite soit il y a une fonction pour édifier le lecteur
par la lecture.
La première conception est marquée par la rigueur.
De plus Scarron ne tranche pas et
peut donc imaginer les mélanger avec les deux comparaisons : celle du cavalier l.6 « ceux qui mettent la
bride… » Et celle de l’ignorance l.9 « divertissant de la même façon qu’un ivrogne… » qui rime tout ce
qu’il y a de sérieux dans la démonstration.
Ainsi l’auteur affiche avec désinvolture son incapacité à
renseigner le lecteur sur la suite du récit.
Il feint d’être aussi ignorant que lui sur ce point avec le
comparatif d’égalité l.5 « aussi bien que ».
De plus, il donne l’impression que le livre est autonome,
comme si le livre était en train de s’écrire.
Scarron revendique le caractère « débride » de son œuvre c’est-à-dire sans limite.
La réflexion qu’il livre
sur la création romanesque annonce ce que fera Diderot un siècle plus tard avec Jacques le Fataliste..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- SCARRON, ROMAN COMIQUE, II. CHAPITRE XVII: commentaire
- ROMAN COMIQUE (le) de Scarron
- Fiche de lecture : ROMAN COMIQUE (Le) de Paul Scarron
- ROMAN COMIQUE (le). Roman de Paul Scarron (résumé & analyse)
- ROMAN COMIQUE (Le) de Paul Scarron (résumé & analyse)