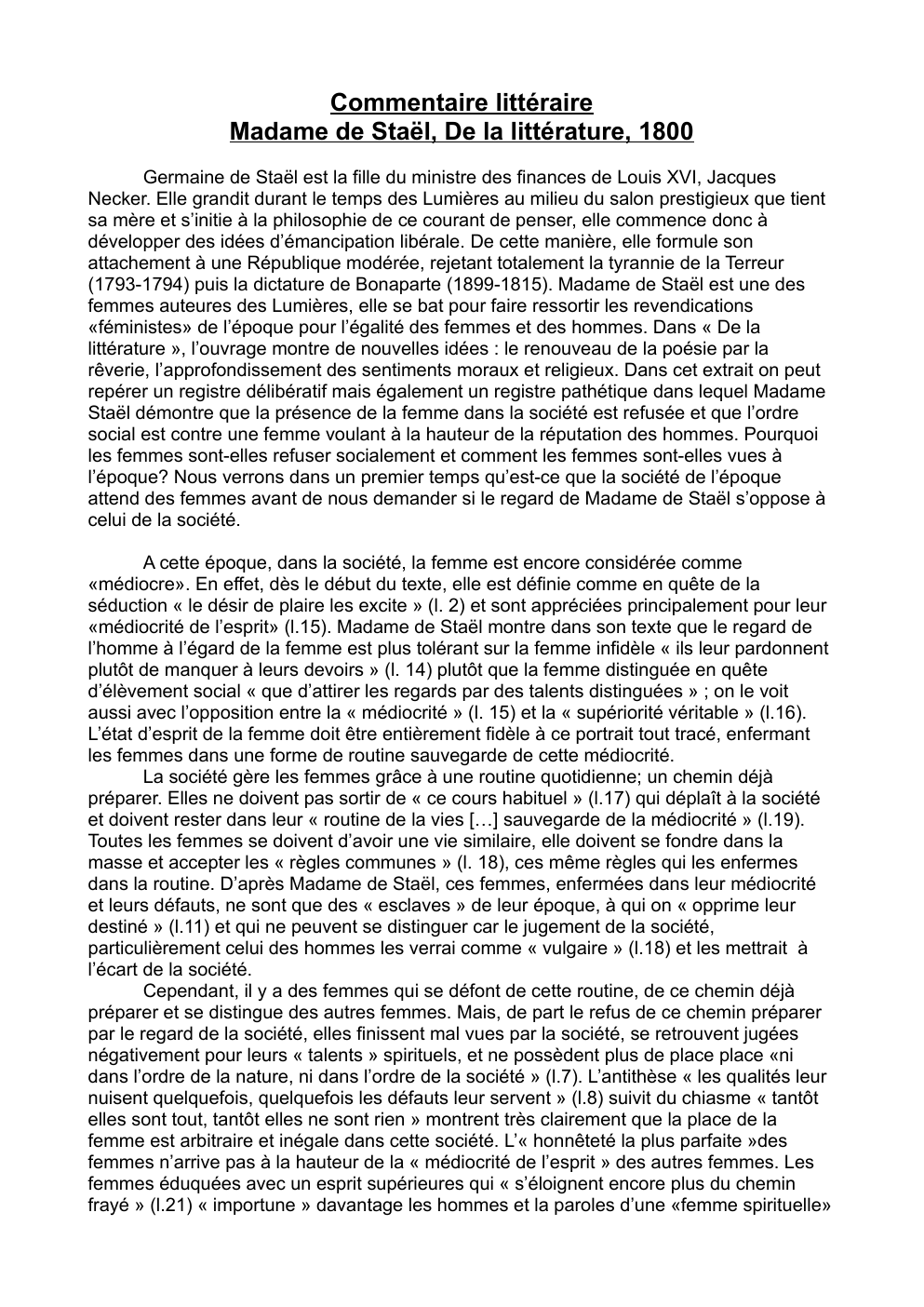Commentaire littéraire Madame de Staël, De la littérature, 1800
Publié le 10/05/2023
Extrait du document
«
Commentaire littéraire
Madame de Staël, De la littérature, 1800
Germaine de Staël est la fille du ministre des finances de Louis XVI, Jacques
Necker.
Elle grandit durant le temps des Lumières au milieu du salon prestigieux que tient
sa mère et s’initie à la philosophie de ce courant de penser, elle commence donc à
développer des idées d’émancipation libérale.
De cette manière, elle formule son
attachement à une République modérée, rejetant totalement la tyrannie de la Terreur
(1793-1794) puis la dictature de Bonaparte (1899-1815).
Madame de Staël est une des
femmes auteures des Lumières, elle se bat pour faire ressortir les revendications
«féministes» de l’époque pour l’égalité des femmes et des hommes.
Dans « De la
littérature », l’ouvrage montre de nouvelles idées : le renouveau de la poésie par la
rêverie, l’approfondissement des sentiments moraux et religieux.
Dans cet extrait on peut
repérer un registre délibératif mais également un registre pathétique dans lequel Madame
Staël démontre que la présence de la femme dans la société est refusée et que l’ordre
social est contre une femme voulant à la hauteur de la réputation des hommes.
Pourquoi
les femmes sont-elles refuser socialement et comment les femmes sont-elles vues à
l’époque? Nous verrons dans un premier temps qu’est-ce que la société de l’époque
attend des femmes avant de nous demander si le regard de Madame de Staël s’oppose à
celui de la société.
A cette époque, dans la société, la femme est encore considérée comme
«médiocre».
En effet, dès le début du texte, elle est définie comme en quête de la
séduction « le désir de plaire les excite » (l.
2) et sont appréciées principalement pour leur
«médiocrité de l’esprit» (l.15).
Madame de Staël montre dans son texte que le regard de
l’homme à l’égard de la femme est plus tolérant sur la femme infidèle « ils leur pardonnent
plutôt de manquer à leurs devoirs » (l.
14) plutôt que la femme distinguée en quête
d’élèvement social « que d’attirer les regards par des talents distinguées » ; on le voit
aussi avec l’opposition entre la « médiocrité » (l.
15) et la « supériorité véritable » (l.16).
L’état d’esprit de la femme doit être entièrement fidèle à ce portrait tout tracé, enfermant
les femmes dans une forme de routine sauvegarde de cette médiocrité.
La société gère les femmes grâce à une routine quotidienne; un chemin déjà
préparer.
Elles ne doivent pas sortir de « ce cours habituel » (l.17) qui déplaît à la société
et doivent rester dans leur « routine de la vies […] sauvegarde de la médiocrité » (l.19).
Toutes les femmes se doivent d’avoir une vie similaire, elle doivent se fondre dans la
masse et accepter les « règles communes » (l.
18), ces même règles qui les enfermes
dans la routine.
D’après Madame de Staël, ces femmes, enfermées dans leur médiocrité
et leurs défauts, ne sont que des « esclaves » de leur époque, à qui on « opprime leur
destiné » (l.11) et qui ne peuvent se distinguer car le jugement de la société,
particulièrement celui des hommes les verrai comme « vulgaire » (l.18) et les mettrait à
l’écart de la société.
Cependant, il y a des femmes qui se défont de cette routine, de ce chemin déjà
préparer et se distingue des autres femmes.
Mais, de part le refus de ce chemin préparer
par le regard de la société, elles finissent mal vues par la société, se retrouvent jugées
négativement pour leurs « talents » spirituels, et ne possèdent plus de place place «ni
dans l’ordre de la nature, ni dans l’ordre de la société » (l.7).
L’antithèse « les qualités leur
nuisent quelquefois, quelquefois les défauts leur servent » (l.8) suivit du chiasme « tantôt
elles sont tout, tantôt elles ne sont rien » montrent très clairement que la place de la
femme est arbitraire et inégale dans cette société.
L’« honnêteté la plus parfaite »des
femmes n’arrive pas à la hauteur de la « médiocrité de l’esprit » des autres femmes.
Les
femmes éduquées avec un esprit supérieures qui « s’éloignent encore plus du chemin
frayé » (l.21) « importune » davantage les hommes et la paroles d’une «femme spirituelle»
(l.25) ainsi que sa célébrité « n’est qu’un bruit fatigant pour eux » : la société trouve que,
contrairement à « un homme distingué ayant presque toujours une carrière importante à
parcourir », la femme n’apportera jamais que le « moins intéressant » des idées nouvelles
évidemment refuser par la société ou « des sentiments élevés » (l.26) : pour la société une
femme supérieure spirituellement n’est là que pour parler avec son cœur et non pas sa
raison.
Tout ce que ces femmes diront sera plus présent sur le plan....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Madame de Staël écrit on 1800 dans De la Littérature (Première Partie, chap. 11 ) : « Ce que l'homme a fait de plus grand, il le doit au sentiment douloureux de l'incomplet de sa destinée. Les esprits médiocres sont, en général, assez satisfaits de la vie commune: ils arrondissent, pour ainsi dire, leur existence, et suppléent a ce qui peut leur manquer encore par les illusions de la vanité: mais le sublime de l'esprit, des sentiments et des actions doit son essor au besoin d'échapper
- Madame de Staël écrit en 1800 dans De la Littérature (Première Partie, chap.11) : «Ce que l'homme a fait de plus grand, il le doit au sentiment douloureux de l'incomplet de sa destinée. Les esprits médiocres sont, en général, assez satisfaits de la vie commune ; ils arrondissent, pour ainsi dire, leur existence, et suppléent à ce qui peut leur manquer encore par les illusions de la vanité ; mais le sublime de l'esprit, des sentiments et des actions doit son essor au besoin d'échapper a
- DE LA LITTÉRATURE CONSIDÉRÉE DANS SES RAPPORTS AVEC LES INSTITUTIONS SOCIALES MADAME DE Staël
- Staël, Madame de - littérature.
- Madame de Staël (1766-1817), De la littérature, deuxième partie, ch. IV, « Des femmes qui cultivent les Lettres ».