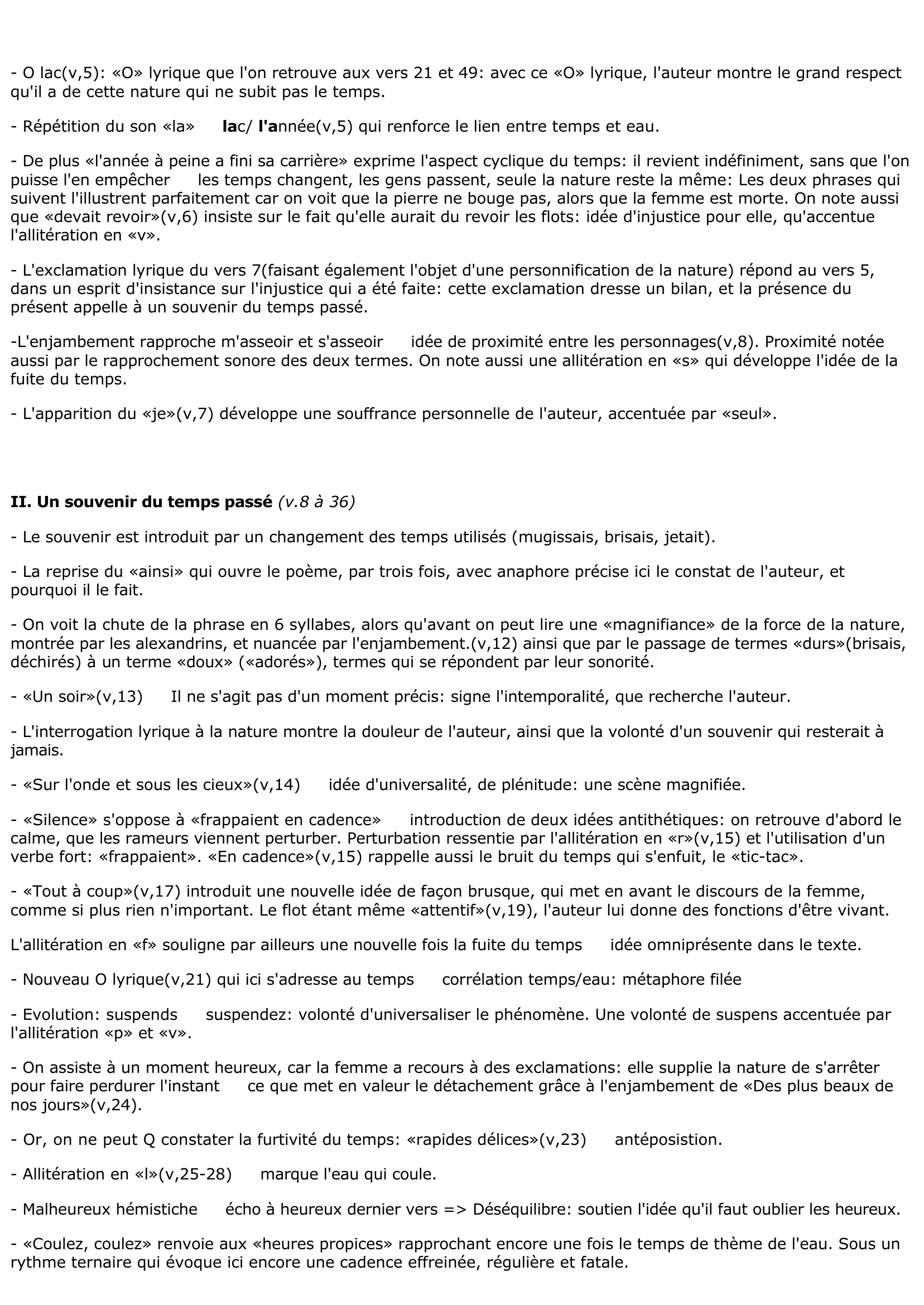Commentaire: Le lac de Lamartine
Publié le 10/03/2012
Extrait du document
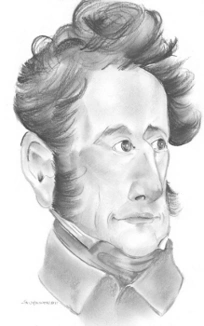
Lamartine, faisant parti du mouvement romantique, voyage dans sa jeunesse en Italie, puis se met au service de Louis XVIII. C'est à cette époque qu'il commence à composer de la poésie. Son premier ouvrage: Les méditations poétiques, publié en 1820, reçoit un succès retentissant. Et pour cause, il signe là un ouvrage représentant le premier recueil romantique de la littérature française.
Le lac, fleuron de la poésie romantique, est le dixième poème de ce recueil. Il fut inspiré de sa liaison amoureuse avec Julie Charles, décédée en 1817. Dans celui-ci, on retrouve les thèmes intarissables de l'inquiétude face à la fatalité du temps, du bonheur amoureux, ainsi que de la force de la nature.
L'auteur y exprime des sentiments personnels mais aussi universels. Aussi peut-on se demander comment l'auteur exprime sa tristesse quant à la perte d'un être cher et à l'inexorable fuite du temps dans ce poème?
Ce poème relevant du romantisme, l'art du lyrisme y est abondant. On retrouve également dans ce poème une métaphore filée de l'eau et du temps qui s'écoule.
Le texte se précise en trois mouvements: tout d'abord, on observe un constat(vers 1 à 8) d'un souvenir du temps passé(vers 9 à 36), puis on constate une révolte de la part de l'auteur, accompagnée d'une volonté de mémoire par la nature(vers 37 à 64).
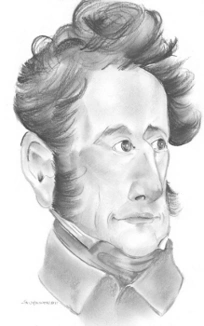
«
- O lac(v,5): «O» lyrique que l'on retrouve aux vers 21 et 49: avec ce «O» lyrique, l'auteur montre le grand respectqu'il a de cette nature qui ne subit pas le temps.
- Répétition du son «la» lac/ l'année(v,5) qui renforce le lien entre temps et eau.
- De plus «l'année à peine a fini sa carrière» exprime l'aspect cyclique du temps: il revient indéfiniment, sans que l'onpuisse l'en empêcher les temps changent, les gens passent, seule la nature reste la même: Les deux phrases quisuivent l'illustrent parfaitement car on voit que la pierre ne bouge pas, alors que la femme est morte.
On note aussique «devait revoir»(v,6) insiste sur le fait qu'elle aurait du revoir les flots: idée d'injustice pour elle, qu'accentuel'allitération en «v».
- L'exclamation lyrique du vers 7(faisant également l'objet d'une personnification de la nature) répond au vers 5,dans un esprit d'insistance sur l'injustice qui a été faite: cette exclamation dresse un bilan, et la présence duprésent appelle à un souvenir du temps passé.
-L'enjambement rapproche m'asseoir et s'asseoir idée de proximité entre les personnages(v,8).
Proximité notéeaussi par le rapprochement sonore des deux termes.
On note aussi une allitération en «s» qui développe l'idée de lafuite du temps.
- L'apparition du «je»(v,7) développe une souffrance personnelle de l'auteur, accentuée par «seul».
II.
Un souvenir du temps passé (v.8 à 36)
- Le souvenir est introduit par un changement des temps utilisés (mugissais, brisais, jetait).
- La reprise du «ainsi» qui ouvre le poème, par trois fois, avec anaphore précise ici le constat de l'auteur, etpourquoi il le fait.
- On voit la chute de la phrase en 6 syllabes, alors qu'avant on peut lire une «magnifiance» de la forc e de la nature, montrée par les alexandrins, et nuancée par l'enjambement.(v,12) ainsi que par le passage de termes «durs»(brisais,déchirés) à un terme «doux» («adorés»), termes qui se répondent par leur sonorité.
- «Un soir»(v,13) Il ne s'agit pas d'un moment précis: signe l'intemporalité, que recherche l'auteur.
- L'interrogation lyrique à la nature montre la douleur de l'auteur, ainsi que la volonté d'un souvenir qui resterait àjamais.
- «Sur l'onde et sous les cieux»(v,14) idée d'universalité, de plénitude: une scène magnifiée.
- «Silence» s'oppose à «frappaient en cadence» introduction de deux idées antithétiques: on retrouve d'abord lecalme, que les rameurs viennent perturber.
Perturbation ressentie par l'allitération en «r»(v,15) et l'utilisation d'unverbe fort: «frappaient».
«En cadence»(v,15) rappelle aussi le bruit du temps qui s'enfuit, le «tic-tac».
- «Tout à coup»(v,17) introduit une nouvelle idée de façon brusque, qui met en avant le discours de la femme,comme si plus rien n'important.
Le flot étant même «attentif»(v,19), l'auteur lui donne des fonctions d'être vivant.
L'allitération en «f» souligne par ailleurs une nouvelle fois la fuite du temps idée omniprésente dans le texte.
- Nouveau O lyrique(v,21) qui ici s'adresse au temps corrélation temps/eau: métaphore filée
- Evolution: suspends suspendez: volonté d'universaliser le phénomène.
Une volonté de suspens accentuée parl'allitération «p» et «v».
- On assiste à un moment heureux, car la femme a recours à des exclamations: elle supplie la nature de s'arrêterpour faire perdurer l'instant ce que met en valeur le détachement grâce à l'enjambement de «Des plus beaux denos jours»(v,24).
- Or, on ne peut Q const ater la furtivité du temps: «rapides délices»(v,23) antéposistion.
- Allitération en «l»(v,25-28) marque l'eau qui coule.
- Malheureux hémistiche écho à heureux dernier vers => Déséquilibre: soutien l'idée qu'il faut oublier les heureux.
- «Coulez, coulez» renvoie aux «heures propices» rapprochant encore une fois le temps de thème de l'eau.
Sous unrythme ternaire qui évoque ici encore une cadence effreinée, régulière et fatale..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentaire sur « Le Lac » de Alphonse de Lamartine
- Commentaire "Le lac" (Alphonse de Lamartine)
- LaMartine - Le Lac Commentaire Littéraire
- Commentaire Le Lac de Lamartine
- LE Lac, Lamartine (commentaire composé)