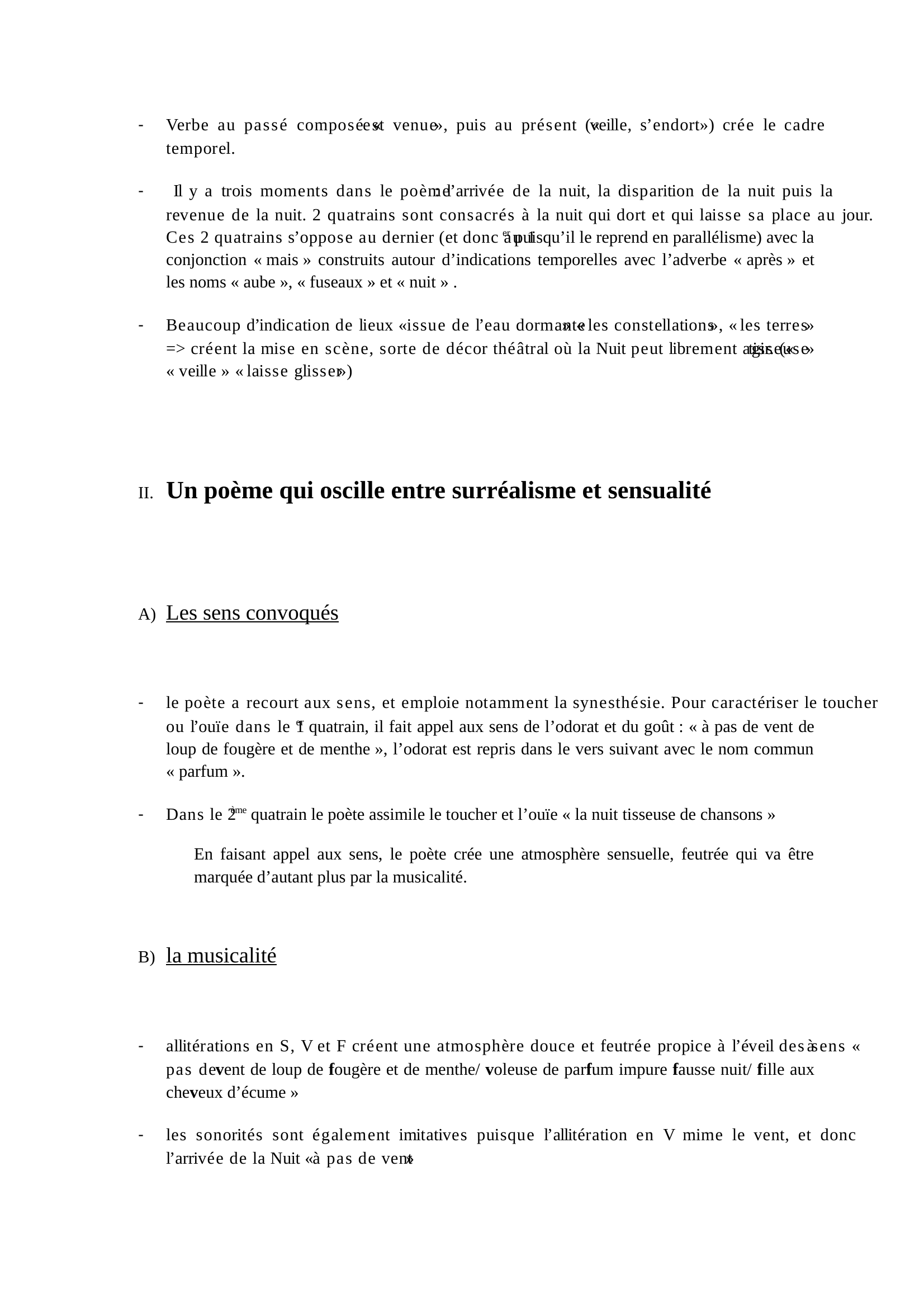Claude Roy
Publié le 01/12/2013
Extrait du document
«
Verb e a u p a s s é compo s é « e st venu e », puis a u pr é s e nt (« veille, s’endort ») cr é e le c a dr e
tempor el.
Il y a trois mom e nt s d a n s le po è m e : l’arrivé e d e la nuit, la disp arition d e la nuit puis la
rev enu e d e la nuit.
2 qu atr ain s s o nt con s a cr é s à la nuit qui dort et qui lais s e s a plac e a u jour.
C e s 2 qu atr ain s s’oppo s e a u d ernier (et donc a u 1 er
puisqu’il le reprend en parallélisme) avec la
conjonction « mais » construits autour d’indications temporelles avec l’adverbe « après » et
les noms « aube », « fuseaux » et « nuit » .
Be a uc oup d’indic ation d e lieux «is s u e d e l’ea u dorm a nt e » « le s con st ellation s », « le s terr e s »
=> cr é e nt la mis e e n s c è n e , s ort e d e d é c or th é âtr al où la Nuit p e ut librem e nt a gir.
(« tis s e u s e »
« veille » « lais s e glis s er »)
II.
Un poème qui oscille entre surréalisme et sensualité
A) Les sens convoqués
le po èt e a recourt a ux s e n s , et e m ploie not amm e nt la syn e sth é si e.
P our c ar a ct éris er le touch er
ou l’ouïe d a n s le 1 er
quatrain, il fait appel aux sens de l’odorat et du goût : « à pas de vent de
loup de fougère et de menthe », l’odorat est repris dans le vers suivant avec le nom commun
« parfum ».
Dan s le 2 ème
quatrain le poète assimile le toucher et l’ouïe « la nuit tisseuse de chansons »
En faisant appel aux sens, le poète crée une atmosphère sensuelle, feutrée qui va être
marquée d’autant plus par la musicalité.
B) la musicalité
allitér ation s e n S , V et F cr é e nt un e atmo s p h èr e douc e et feutré e propic e à l’éveil d e s s e n s « à
p a s d e v ent de loup de f ougère et de menthe/ v oleuse de par f um impure f ausse nuit/ f ille aux
che v eux d’écume »
le s s o n orité s s o nt é g al em e nt imitative s puisqu e l’allitér ation e n V mim e le vent, et donc
l’arrivé e d e la Nuit « à p a s d e vent ».
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Claude Roy, Clair comme le jour, 1943.
- Roy (Claude Orland.
- Pierre Marivaux par Claude Roy Rien n'est plus mince que le fil d'un rasoir, rien ne tranche moins (si on en voit seulement l'épaisseur) sur ce qui entoure.
- Paul Éluard par Claude Roy Paul Éluard est né à Saint-Denis.
- Roy, Claude - littérature française.