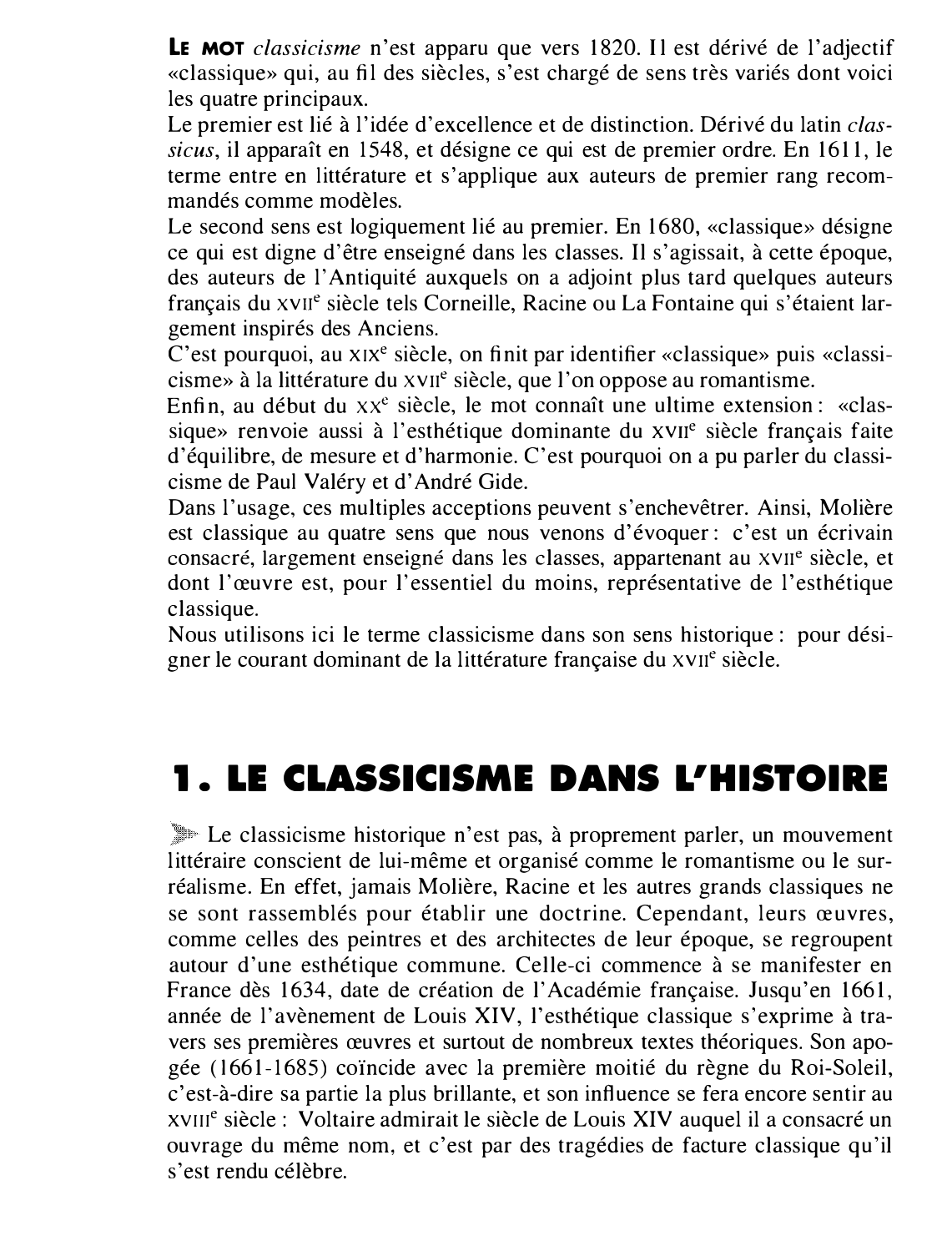CLASSICISME - Histoire de la littérature
Publié le 30/01/2018
Extrait du document

«La colère est superbe et veut des mots altiers,
L'abattement s'explique en des termes moins fiers.»
Pierre Corneille (1606 1684)
Jean de La Fontaine (1621-1695)
Molière (1622 1673)
Mme de La Fayette (1634-1693)
Nicolas Boileau (1636-1711)
Jean Racine (1639-1699)
Le Cid (1636), Cinna (1641 ), Polyeucte (1642) P. Corneille
Tartuffe (1664 1667), Dom Juan (1665), Le Misanthrope (1666) Molière
Andromaque (1667), Bérénice (1670), Phèdre (1677) J. Racine
Les Fables (trois recueils : 1668-1678 1694) J. de La Fontaine
L'Art poétique (1674) N. Boileau
La Princesse de Clèves (1678) Mme de La Fayette
1634 Création de l'Académie franç aise.
1634-1685 Limites du mouvement.
1661 Début du règne personnel de Louis XIV.
1685 Révocation de l'Édit de Nantes.
1715 Mort de Louis XIV.
«La principale règle est de plaire et de toucher. Toutes les autres ne sont faites
que pour parvenir à cette première.»
(Racine, préface de Bérénice.)
«Aimez donc la raison ; que toujours vos écrits
Empruntent d'elle seule et leur lustre et leur prix.»
(Boileau, l'Art poétique.)

«
LE
MOT classicisme n'est apparu que vers 1820.
Il est dérivé de l'ad jectif
«classique» qui, au f l des siècles, s'est cha rgé de sens très variés dont voici
les quatre principaux.
Le premier est lié à l'idée d'excellence et de distinction.
Dérivé du latin clas
sicus, il apparaît en 1548, et désigne ce qui est de premier ordre.
En 1611, le
terme entre en 1 ittérature et s'applique aux auteurs de premier rang recom
mandés comme modèles.
Le second sens est logiquement lié au premier.
En 1680, «classique» désigne
ce qui est digne d'être enseigné dans les classes.
Il s'a gissait, à cette époque,
des auteurs de l'Antiquité auxquels on a adjoint plus tard quelques auteurs
franç ais du xvu e siècle tels Corneille, Racine ou La Fontaine qui s'étaient lar
gement inspirés des Anciens.
C' est pourquoi, au XIX e siècle, on f nit par identifier «classique» puis «classi
cisme» à la littérature du xvn e siècle, que l'on oppose au roman tisme.
Enf n, au début du xxe siècle, le mot conna ît une ultime extension : «clas
sique» renvoie aussi à l'esthétique dominante du xvn e siècle franç ais faite
d'é quili bre, de mes ure et d'harmo nie.
C'est pourquoi on a pu parler du classi
cisme de Paul Valéry et d'André Gide.
Dans l'usage, ces multiples acceptions peuvent s'enchevêtrer.
Ainsi, Molière
est classique au quatre sens que nous venons d'évoquer : c'est un écrivain
consacré, largement enseigné dans les classes, appartenant au xvne siècle, et
dont l'œuvre est, pour l'essentiel du moins, représentative de l'esthétique
classique.
Nous utilisons ici le terme classicisme dans son sens historiq ue: pour dési
gner le courant dominant de la littérature française du xvn e siècle.
1 • LE CLAS SICIS ME DANS L'HIS TOIRE
Le classicisme historique n'est pas, à proprement parler, un mouvement
li ttéraire conscient de lui-m ême et organisé comme le romantisme ou le sur
réa lisme.
En effet, jamais Molière, Racine et les autres grands classiques ne
se sont rassemblés pour éta blir une doctrine.
Cependant, leurs œu vres,
comme celles des peint res et des architectes de leur époque, se regroupent
autour d'une esthétique commune.
Celle-ci commence à se manif ester en
France dès 1634, date de création de l'Académie française.
Jusqu'e n 1661,
année de l'avènement de Louis XIV, l'esthétique classique s'exprime à tra
vers ses premières œuvres et surtout de nombreux textes théoriques.
Son apo
gée (166 1-1685) coïncide avec la premi ère moitié du règne du Roi-Soleil,
c' est -à-dire sa partie la plus brillante, et son inf uence se fera encore sentir au
XVIIIe siècle : Voltaire admirait le siècle de Louis XIV auquel il a consa cré un
ouvrage du même nom, et c'est par des tragédies de facture classique qu'il
s' est rendu célèbre..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Que pensez-vous de cette idée de J. Bayet : «Le classicisme est un équilibre, de pensée, de sensibilité et de forme, qui assure à l'œuvre d'art un intérêt humain et une diffusion universelle. L'ordre, la clarté, la plénitude, la maîtrise consciente en sont les signes apparents. Mais on ne saurait parler d'«époque classique»; en un temps donné, une littérature offre, à côté des «classiques», des retardataires et des novateurs. Il n'y a que des «auteurs classiques», ou même parfois seule
- l'histoire de la littérature
- Comment la littérature peut-elle témoigner de la violence de l’histoire ?
- Histoire de la littérature française - cours
- ARTHUR et la légende arthurienne (Histoire de la littérature)