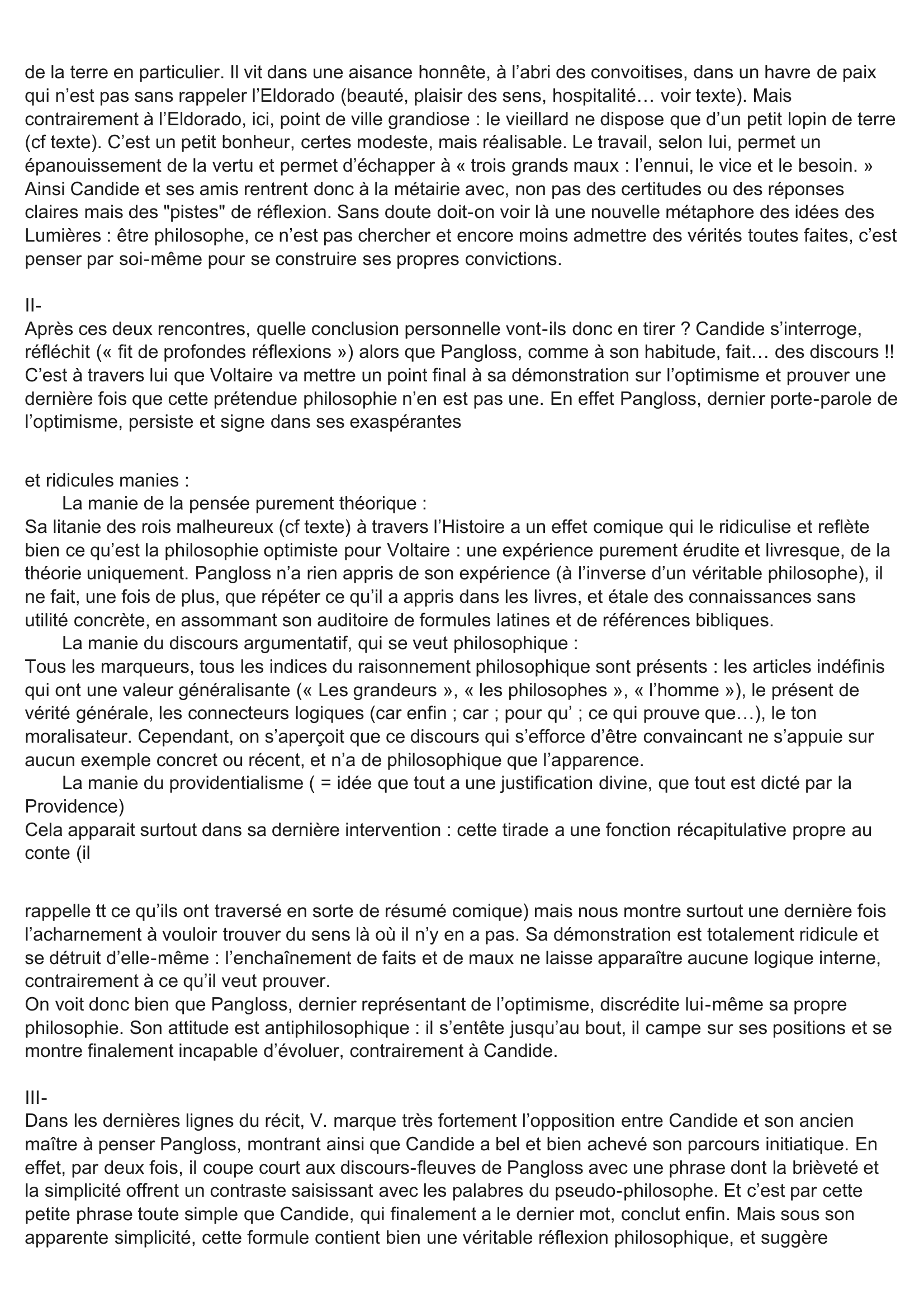Chapitre XXX : L'excipit (de « Il y avait dans le voisinage… » à la fin) - Candide de Voltaire
Publié le 08/11/2012

Extrait du document

1ère interprétation possible : « Il faut cultiver notre jardin « est d’abord une injonction pratique. Il
s’agit de viser le concret, l’utile, l’efficace. C’est une morale de l’action que nous propose cette formule.
L’ardeur au travail devient la seule véritable vertu. Tout le monde est occupé, chacun contribue au bienêtre
commun, selon ses capacités, il n’y pas d’exploitation de l’homme par l’homme (cf texte). Chacun est
jugé à sa juste valeur et le mérite est reconnu.
2° interprétation : une réflexion critique. « cultiver son jardin «, c’est se mettre à l’abri, rejeter tout ce
qui peut nuire à la tranquillité morale : les « convulsions de l’inquiétude « produites par la métaphysique
(cf le derviche), la politique (cf le vieillard), le fanatisme religieux. Il s’agit de se créer sa propre
philosophie, fondée sur le libéralisme, l’individualisme.

«
de la terre en particulier.
Il vit dans une aisance honnête, à l’abri des convoitises, dans un havre de paix
qui n’est pas sans rappeler l’Eldorado (beauté, plaisir des sens, hospitalité… voir texte).
Mais
contrairement à l’Eldorado, ici, point de ville grandiose : le vieillard ne dispose que d’un petit lopin de terre
(cf texte).
C’est un petit bonheur, certes modeste, mais réalisable.
Le travail, selon lui, permet un
épanouissement de la vertu et permet d’échapper à « trois grands maux : l’ennui, le vice et le besoin.
»
Ainsi Candide et ses amis rentrent donc à la métairie avec, non pas des certitudes ou des réponses
claires mais des "pistes" de réflexion.
Sans doute doit-on voir là une nouvelle métaphore des idées des
Lumières : être philosophe, ce n’est pas chercher et encore moins admettre des vérités toutes faites, c’est
penser par soi-même pour se construire ses propres convictions.
II-
Après ces deux rencontres, quelle conclusion personnelle vont-ils donc en tirer ? Candide s’interroge,
réfléchit (« fit de profondes réflexions ») alors que Pangloss, comme à son habitude, fait… des discours !!
C’est à travers lui que Voltaire va mettre un point final à sa démonstration sur l’optimisme et prouver une
dernière fois que cette prétendue philosophie n’en est pas une.
En effet Pangloss, dernier porte-parole de
l’optimisme, persiste et signe dans ses exaspérantes
et ridicules manies :
La manie de la pensée purement théorique :
Sa litanie des rois malheureux (cf texte) à travers l’Histoire a un effet comique qui le ridiculise et reflète
bien ce qu’est la philosophie optimiste pour Voltaire : une expérience purement érudite et livresque, de la
théorie uniquement.
Pangloss n’a rien appris de son expérience (à l’inverse d’un véritable philosophe), il
ne fait, une fois de plus, que répéter ce qu’il a appris dans les livres, et étale des connaissances sans
utilité concrète, en assommant son auditoire de formules latines et de références bibliques.
La manie du discours argumentatif, qui se veut philosophique :
Tous les marqueurs, tous les indices du raisonnement philosophique sont présents : les articles indéfinis
qui ont une valeur généralisante (« Les grandeurs », « les philosophes », « l’homme »), le présent de
vérité générale, les connecteurs logiques (car enfin ; car ; pour qu’ ; ce qui prouve que…), le ton
moralisateur.
Cependant, on s’aperçoit que ce discours qui s’efforce d’être convaincant ne s’appuie sur
aucun exemple concret ou récent, et n’a de philosophique que l’apparence.
La manie du providentialisme ( = idée que tout a une justification divine, que tout est dicté par la
Providence)
Cela apparait surtout dans sa dernière intervention : cette tirade a une fonction récapitulative propre au
conte (il
rappelle tt ce qu’ils ont traversé en sorte de résumé comique) mais nous montre surtout une dernière fois
l’acharnement à vouloir trouver du sens là où il n’y en a pas.
Sa démonstration est totalement ridicule et
se détruit d’elle-même : l’enchaînement de faits et de maux ne laisse apparaître aucune logique interne,
contrairement à ce qu’il veut prouver.
On voit donc bien que Pangloss, dernier représentant de l’optimisme, discrédite lui -même sa propre
philosophie.
Son attitude est antiphilosophique : il s’entête jusqu’au bout, il campe sur ses positions et se
montre finalement incapable d’évoluer, contrairement à Candide.
III-
Dans les dernières lignes du récit, V.
marque très fortement l’opposition entre Candide et son ancien
maître à penser Pangloss, montrant ainsi que Candide a bel et bien achevé son parcours initiatique.
En
effet, par deux fois, il coupe court aux discours-fleuves de Pangloss avec une phrase dont la brièveté et
la simplicité offrent un contraste saisissant avec les palabres du pseudo-philosophe.
Et c’est par cette
petite phrase toute simple que Candide, qui finalement a le dernier mot, conclut enfin.
Mais sous son
apparente simplicité, cette formule contient bien une véritable réflexion philosophique, et suggère.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Chapitre XXX : L'excipit (de « Il y avait dans le voisinage… » à la fin) - Candide de Voltaire
- Chapitre XXX : L'excipit (de « Il y avait dans le voisinage » à la fin).
- Texte A : Fénelon, Les Aventures de Télémaque (1699), Septième livre - Texte B : Montesquieu, Lettres persanes (1721), Lettre XII - Texte C : Voltaire, Candide (1759), chapitre XXX
- Voltaire: chapitre 30, de « Candide en retournant dans sa métairie » jusqu’à la fin du conte. Explication de texte.
- Candide chapitre XXX - Voltaire (commentaire)