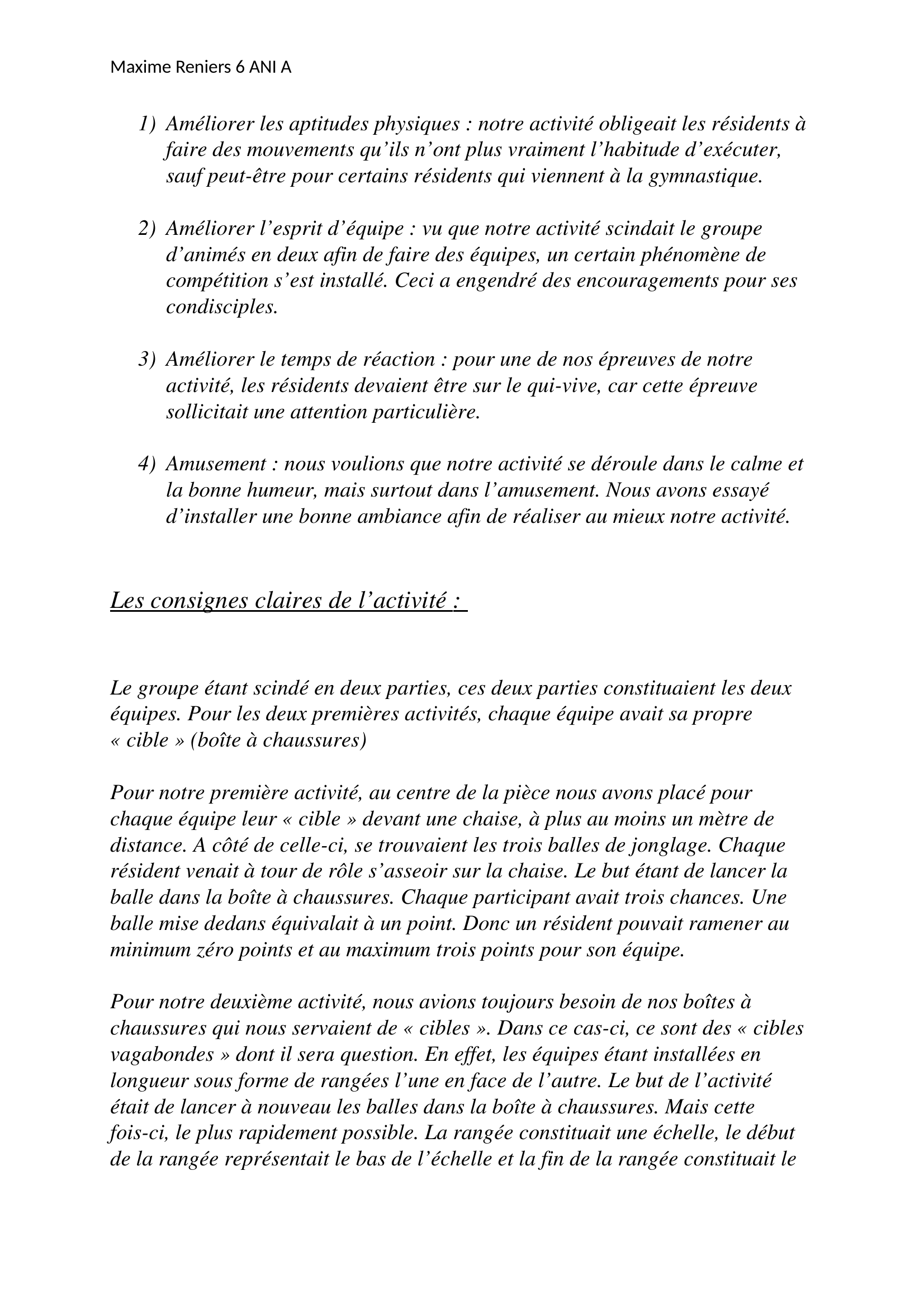EAC 2 : Travail écrit
Publié le 25/04/2017
Extrait du document


« Maxime Reniers 6 ANI A 1) Améliorer les aptitudes physiques : notre activit é obligeait les r ésidents à faire des mouvements qu’ils n’ont plus vraiment l’habitude d’ex écuter, sauf peut être pour certains r ésidents qui viennent à la gymnastique. 2) Am éliorer l’esprit d’ équipe : vu que notre activit é scindait le groupe d’anim és en deux afin de faire des équipes, un certain ph énom ène de comp étition s’est install é. Ceci a engendr é des encouragements pour ses condisciples. 3) Am éliorer le temps de r éaction : pour une de nos épreuves de notre activit é, les r ésidents devaient être sur le quivive, car cette épreuve sollicitait une attention particuli ère. 4) Amusement : nous voulions que notre activit é se d éroule dans le calme et la bonne humeur, mais surtout dans l’amusement. Nous avons essay é d’installer une bonne ambiance afin de r éaliser au mieux notre activit é. Les consignes claires de l’activit é : Le groupe étant scind é en deux parties, ces deux parties constituaient les deux é quipes. Pour les deux premi ères activit és, chaque équipe avait sa propre « cible » (bo îte à chaussures) Pour notre premi ère activit é, au centre de la pi èce nous avons plac é pour chaque équipe leur « cible » devant une chaise, à plus au moins un m ètre de distance. A c ôté de celleci, se trouvaient les trois balles de jonglage. Chaque r ésident venait à tour de r ôle s’asseoir sur la chaise. Le but étant de lancer la balle dans la bo îte à chaussures. Chaque participant avait trois chances. Une balle mise dedans équivalait à un point. Donc un r ésident pouvait ramener au minimum z éro points et au maximum trois points pour son équipe. Pour notre deuxi ème activit é, nous avions toujours besoin de nos bo îtes à chaussures qui nous servaient de « cibles ». Dans ce casci, ce sont des « cibles vagabondes » dont il sera question. En effet, les équipes étant install ées en longueur sous forme de rang ées l’une en face de l’autre. Le but de l’activit é é tait de lancer à nouveau les balles dans la bo îte à chaussures. Mais cette foisci, le plus rapidement possible. La rang ée constituait une échelle, le d ébut de la rang ée repr ésentait le bas de l’ échelle et la fin de la rang ée constituait le . »
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Dans son essai Croissance zéro, Alfred Sauvy écrit, à propos de la fascination qu'exerce sur l'homme l'idée du retour à la nature : « ... L'idée séduisante de retour à l'état naturel, à une vie végétale, ne dure guère qu'un été et d'une façon très relative. Virgile s'extasiait devant les gémissements des boeufs, mais avait des esclaves pour traire ses vaches. Rousseau fut fort aise de trouver une assistance publique pour élever ses enfants. Quant à Diogene, il devait bien produire quel
- Marx écrit que, dans la société communiste, le travail, de simple moyen de vivre, deviendra le premier besoin de l'existence. Comment concevez-vous une telle transformation ?
- « A l'inverse de ce qu'on affirme souvent, le jeu n'est pas apprentissage de travail. Le jeu ne prépare pas à un métier défini, il introduit à la vie dans son ensemble en accroissant toute capacité de surmonter les obstacles ou de faire face aux difficultés », écrit Roger Caillois dans Les Jeux et les Hommes, en 1958. Pensez-vous que le jeu exerce cette fonction dans notre société, qu'il s'agisse des enfants ou des adultes?
- André Gide s'adresse ainsi à un jeune homme : « Ne cherche pas à remanger ce qu'ont digéré tes ancêtres. Vois s'envoler les grains ailés du platane et du sycomore, comme s'ils comprenaient que l'ombre paternelle ne leur promet qu'étiolement et qu'atrophie ... sache comprendre et t'éloigner le plus possible du passé. » Par ailleurs Renan a écrit : « Tous les siècles d'une nation sont les feuillets d'un même livre. Les vrais hommes de progrès sont ceux qui ont pour point de départ un res
- Dans Qu’est-ce que la littérature , Jean-Paul SARTRE écrit que la poésie ne se sert pas des mots de la même manière que la prose : « Et même, elle ne s’en sert pas du tout ; je dirais plutôt qu’elle les sert… Le poète s’est retiré d’un seul coup du langage instrument ; il a choisi une fois pour toutes l’attitude poétique qui considère les mots comme des choses et non comme des signes. » Vous commenterez ce jugement de SARTRE et analyserez, en vous appuyant sur des exemples précis, ce