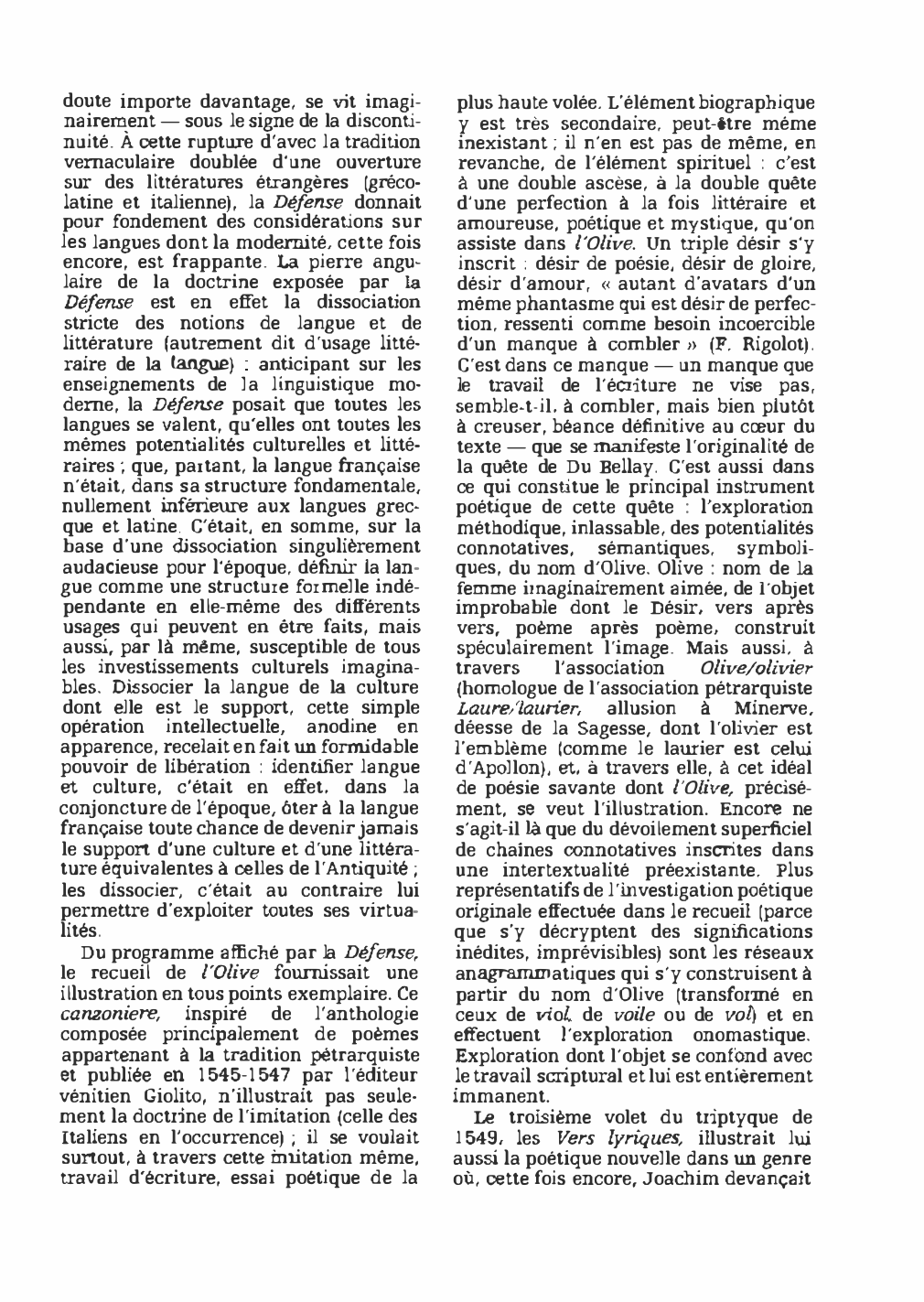BELLAY (Joachim du)
Publié le 16/02/2019
Extrait du document


«
doute
importe davantage, se vit imagi
naire�ent- sous le signe de la disconti
nuité.
A cette rupture d'avec la tradition
vernaculaire doublée d'une ouverture
sur des littératures étrangères (gréco·
latine et italienne), la Défense donnait
pour fondement des considérations sur
les langues dont la modernité, cette fois
encore, est frappante.
La pierre angu
laire de la doctrine exposée par la
Défense est en effet la dissociation
stricte des notions de langue et de
littérature (autrement dit d'usage litté
raire de la langue) anticipant sur les
enseignements de la linguistique mo
derne, la Défense posait que toutes les
langues se valent, qu'elles ont toutes les
mêmes potentialités culturelles et litté·
raires ; que, partant, la langue française
n'était, dans sa structure fondamentale,
nullement inférieure aux langues grec
que et latine.
C'était, en somme, sur la
base d'une dissociation singulièrement
audacieuse pour l'époque, définir la lan
gue comme une structure formelle indé
pendante en elle-même des différents
usages qui peuvent en être faits, mais
aussi, par là même, susceptible de tous
les investissements culturels imagina
bles.
Dissocier la langue de la culture
dont elle est le support, cette simple
opération intellectuelle, anodine en
apparence, recelait en fait un formidable
pouvoir de libération : identifier langue
et culture, c'était en effet, dans la
conjoncture de l'époque, ôter à la langue
française toute chance de devenir jamais
le support d'une culture et d'une littéra
ture équivalentes à celles de l'Antiquité ;
les dissocier, c'était au contraire lui
permettre d'exploiter toutes ses virtua
lités.
Du programme affiché par la Défense,
le recueil de l'Olive fournissait une
illustration en tous points exemplaire.
Ce
canzoniere, inspiré de l'anthologie
composée principalement de poèmes
appartenant à la tradition pétrarquiste
et publiée en 1545·1547 par l'éditeur
vénitien Giolito, n'illustrait pas seule·
ment la doctrine de l'imitation (celle des
Italiens en l'occurrence) ; il se voulait
surtout, à travers cette imitation même,
travail d'écriture, essai poétique de la plus
haute volée.
L'élément biographique
y est très secondaire, peut-être méme
inexistant; il n'en est pas de même, en
revanche, de l'élément spirituel : c'est
à une double ascèse, à la double quête
d'une perfection à la fois littéraire et
amoureuse, poétique et mystique, qu'on
assiste dans l'Olive.
Un triple désir s'y
inscrit : désir de poésie, désir de gloire,
désir d'amour, «autant d'avatars d'un
même phantasme qui est désir de perfec·
tion, ressenti comme besoin incoercible
d'un manque à combler » (F.
Rigolot).
C'est dans ce manque -un manque que
le travail de l'écriture ne vise pas,
semble-t-il.
à combler, mais bien plutôt
à creuser, béance définitive au cœur du
texte -que se manifeste l'originalité de
la quête de Du Bellay.
C'est aussi dans
ce qui constitue le principal instrument
poétique de cette quête : l'exploration
méthodique, inlassable, des potentialités
connotatives, sémantiques, symboli
ques, du nom d'Olive.
Olive : nom de la
femme i.maginairement aimée, de l'objet
improbable dont le Désir, vers après
vers, poème après poème, construit
spéculairement l'image.
Mais aussi, à
travers l'association Olive/olivier
(homologue de l'association pétrarquiste
Laure/laurier, allusion à Minerve,
déesse de la Sagesse, dont l'olivier est
l'emblème (comme le lawier est celui
d'Apollon), et, à travers elle, à cet idéal
de poésie savante dont l'Olive, précisé
ment, se veut l'illustration.
Encore ne
s'agit-il là que du dévoilement superficiel
de chaînes connotatives inscrites dans
une intertextualité préexistante.
Plus
représentatifs de l'investigation poétique
originale effectuée dans Je recueil (parce
que s'y décryptent des significations
inédites, imprévisibles) sont les réseaux
an agramm atiques qui s'y construisent à
partir du nom d'Olive (transformé en
ceux de viol, de voile ou de vol) et en
effectuent 1 'exploration onomastique.
Exploration dont l'objet se confond avec
le travail scriptural et lui est entièrement
immanent.
Le troisième volet du triptyque de
1549, les Vers lyriques, illustrait lui
aussi la poétique nouvelle dans un genre
où, cette fois encore, Joachim devançait.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- DIVERS JEUX RUSTIQUES et autres œuvres poétiques. de Joachim du Bellay (résumé)
- REGRETS (Les) Joachim Du Bellay. Résumé et analyse
- Les Regrets - Joachim du Bellay
- DÉFENSE ET ILLUSTRATION DE LA LANGUE FRANÇAISE Joachim du Bellay (résumé & analyse)
- Antiquités de Rome (les) de Joachim du Bellay (fiche de lecture)