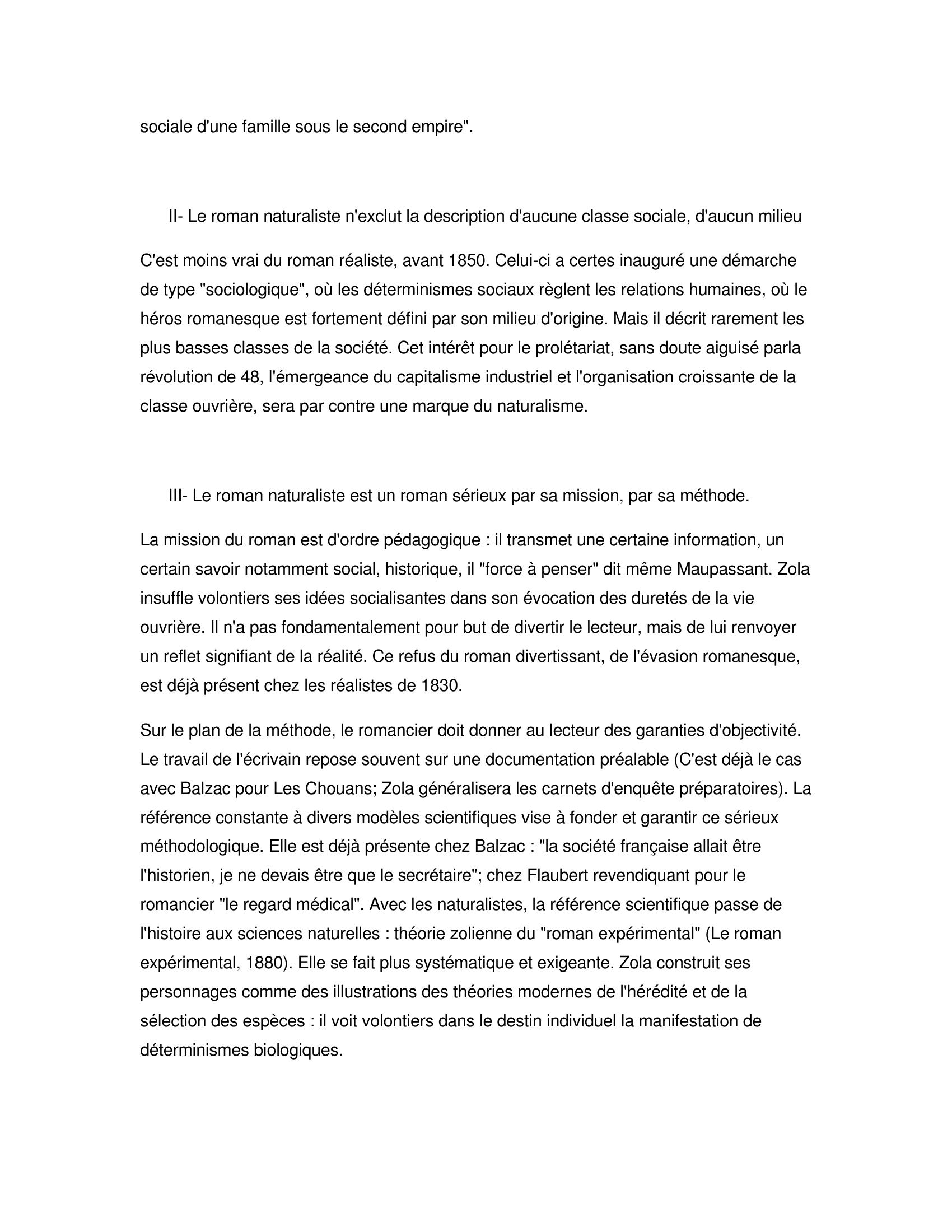Bel Ami
Publié le 26/01/2013
Extrait du document
«
sociale d'une famille sous le second empire".
II Le roman naturaliste n'exclut la description d'aucune classe sociale, d'aucun milieu
C'est moins vrai du roman réaliste, avant 1850. Celuici a certes inaugur é une d émarche
de type "sociologique", o
ù les d éterminismes sociaux r èglent les relations humaines, o ù le
h
éros romanesque est fortement d éfini par son milieu d'origine. Mais il d écrit rarement les
plus basses classes de la soci
été. Cet int érêt pour le prol étariat, sans doute aiguis é parla
r
évolution de 48, l' émergeance du capitalisme industriel et l'organisation croissante de la
classe ouvri
ère, sera par contre une marque du naturalisme.
III Le roman naturaliste est un roman s
érieux par sa mission, par sa m éthode.
La mission du roman est d'ordre p
édagogique : il transmet une certaine information, un
certain savoir notamment social, historique, il "force
à penser" dit m ême Maupassant. Zola
insuffle volontiers ses id
ées socialisantes dans son évocation des duret és de la vie
ouvri
ère. Il n'a pas fondamentalement pour but de divertir le lecteur, mais de lui renvoyer
un reflet signifiant de la r
éalit é. Ce refus du roman divertissant, de l' évasion romanesque,
est d
éjà pr ésent chez les r éalistes de 1830.
Sur le plan de la m
éthode, le romancier doit donner au lecteur des garanties d'objectivit é.
Le travail de l' écrivain repose souvent sur une documentation pr éalable (C'est d éjà le cas avec Balzac pour Les Chouans; Zola g énéralisera les carnets d'enqu ête pr éparatoires). La r éférence constante à divers mod èles scientifiques vise à fonder et garantir ce s érieux m éthodologique. Elle est d éjà pr ésente chez Balzac : "la soci été fran çaise allait être l'historien, je ne devais être que le secr étaire"; chez Flaubert revendiquant pour le romancier "le regard m édical". Avec les naturalistes, la r éférence scientifique passe de l'histoire aux sciences naturelles : th éorie zolienne du "roman exp érimental" (Le roman exp érimental, 1880). Elle se fait plus syst ématique et exigeante. Zola construit ses personnages comme des illustrations des th éories modernes de l'h érédit é et de la s élection des esp èces : il voit volontiers dans le destin individuel la manifestation de d éterminismes biologiques. . »
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Carnet de lecture de Bel Ami
- Bel-Ami, Etude de texte n°2, chapitre 2
- Commentaire de texte sur Bel-Ami
- analyse lineaire extrait bel-ami
- L'amour dans Bel Ami