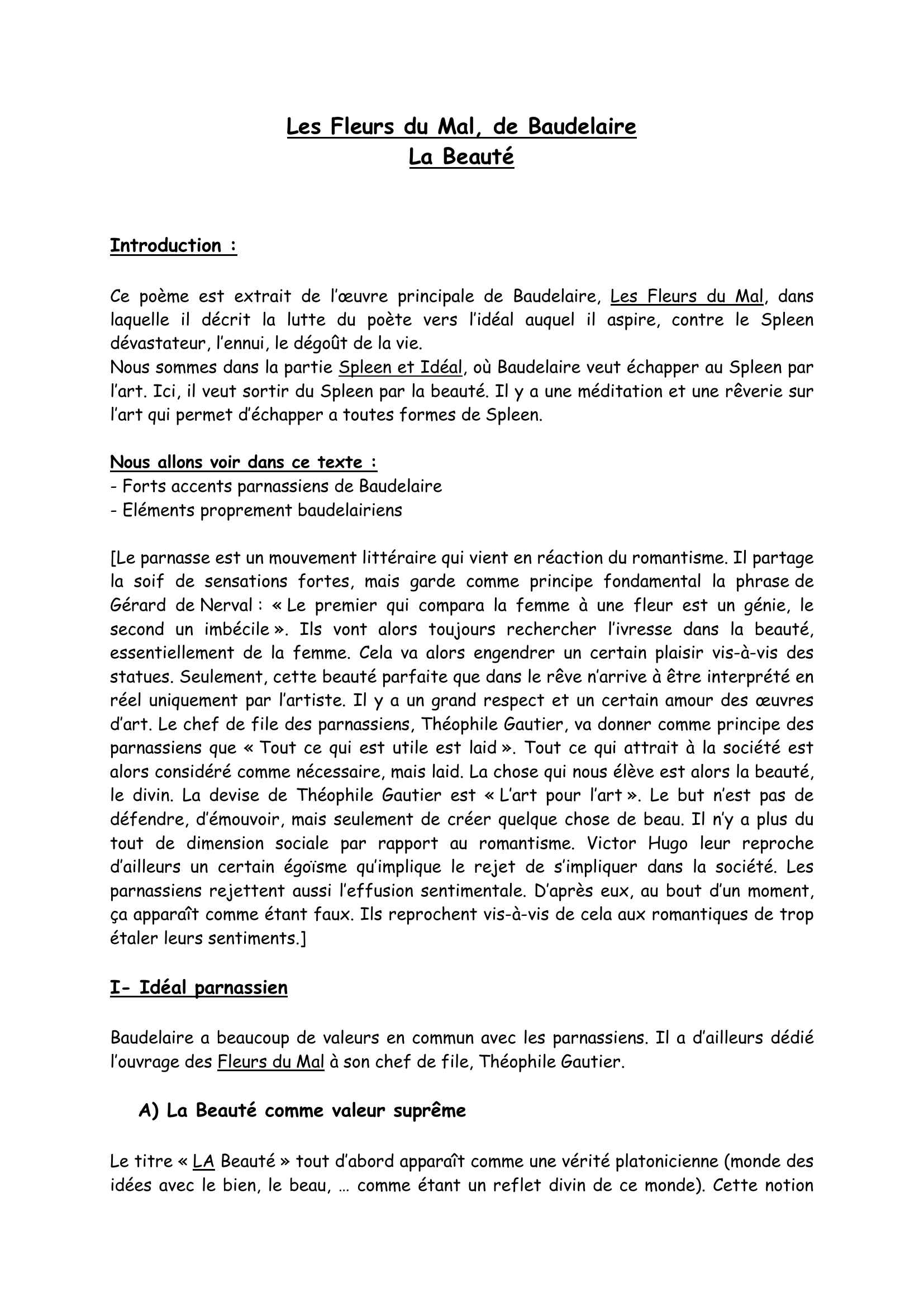BAUDELAIRE: « Spleen et idéal », « La Beauté » - commentaire
Publié le 22/09/2011
Extrait du document

C’est pourquoi, le poète utilise le champ lexical du monument afin de nous sensibiliser à son côté immuable et stable avec les substantifs « pierre (v.1), matière (v.4), « monuments (v.10). Le nom « sphinx « (v.5) renvoie aux statues érigées par les Egyptiens et relie clairement la beauté à la divinité puisque ce monument était source de vénération. Par ailleurs, l’absence de sensibilité affichée par la beauté complète son portrait de déesse immuable : le parallélisme du vers 8 avec la répétition de « jamais « insiste sur son impassibilité. Elle ne manifeste aucune émotion que ce soit la douleur ou la joie, à la manière d’une statue. L’image du vers 9, « cœur de neige « proche de l’oxymore montre combien le siège du sentiment est inactif, à la fois pur et glacé. Cette supériorité ainsi que cette insensibilité dégagent une certaine insolence dont peut souffrir le poète.

«
Les Fleurs du Mal, de Baudelaire
La Beauté
Introduction :
Ce poème est extrait de l’œuvre principale de Baudelaire, Les Fleurs du Mal, dans
laquelle il décrit la lutte du poète vers l’idéal auquel il aspire, contre le Spleen
dévastateur, l’ennui, le dég oût de la vie.
Nous sommes dans la partie Spleen et Idéal, où Baudelaire veut échapper au Spleen par
l’art.
Ici, il veut sortir du Spleen par la beauté.
Il y a une méditation et une rêverie sur
l’art qui permet d’échapper a toutes formes de Spleen.
Nous allons voir dans ce texte :
- Forts accents parnassiens de Baudelaire
- Eléments proprement baudelairiens
[Le parnasse est un mouvement littéraire qui vient en réaction du romantisme.
Il partage
la soif de sensations fortes, mais garde comme principe fonda mental la phrase de
Gérard de Nerval : «
Le premier qui compara la femme à une fleur est un génie, le
second un imbécile ».
Ils vont alors toujours rechercher l’ivresse dans la beauté,
essentiellement de la femme.
Cela va alors engendrer un certain plaisir vis -à -vis des
statues.
Seulement, cette beauté parfaite que dans le rêve n’arrive à être interprété en
réel uniquement par l’artiste.
Il y a un grand respect et un certain amour des œuvres
d’art.
Le chef de file des parnassiens, Théophile Gautier, va donn er comme principe des
parnassiens que « Tout ce qui est utile est laid ».
Tout ce qui attrait à la société est
alors considéré comme nécessaire, mais laid.
La chose qui nous élève est alors la beauté,
le divin.
La devise de Théophile Gautier est « L’art po ur l’art ».
Le but n’est pas de
défendre, d’émouvoir, mais seulement de créer quelque chose de beau.
Il n’y a plus du
tout de dimension sociale par rapport au romantisme.
Victor Hugo leur reproche
d’ailleurs un certain égoïsme qu’implique le rejet de s’imp liquer dans la société.
Les
parnassiens rejettent aussi l’effusion sentimentale.
D’après eux, au bout d’un moment,
ça apparaît comme étant faux.
Ils reprochent vis -à -vis de cela aux romantiques de trop
étaler leurs sentiments.]
I - Idéal parnassien
Baudelaire a beaucoup de valeurs en commun avec les parnassiens.
Il a d’ailleurs dédié
l’ouvrage des Fleurs du Mal à son chef de file, Théophile Gautier.
A) La Beauté comme valeur suprême
Le titre « LA Beauté » tout d’abord apparaît comme une vérité platonicien ne (monde des
idées avec le bien, le beau, … comme étant un reflet divin de ce monde).
Cette notion.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- BAUDELAIRE : L’Albatros. (Les fleurs du Mal, Spleen et Idéal.) - Commentaire
- Commentaire de texte Correspondances : Fleurs du Mal - « Spleen et Idéal » (Baudelaire)
- « L'Ennemi » - « Spleen et Idéal » de Baudelaire (commentaire)
- Etude linéaire - Spleen et Idéal, Les Fleurs du mal, Charles Baudelaire
- Analyse "Spleen et Idéal" extrait de Les Fleurs du Mal de Baudelaire