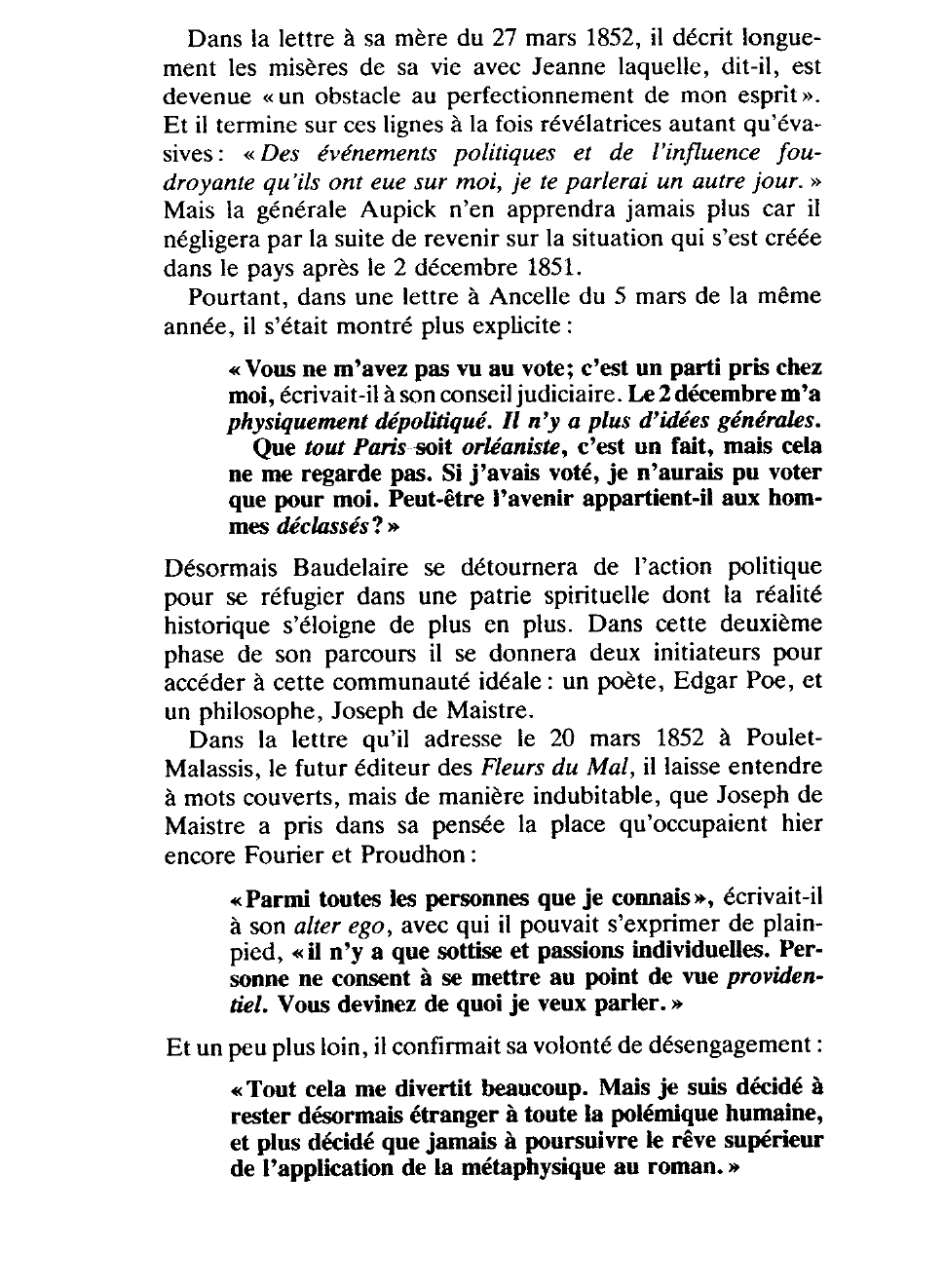BAUDELAIRE: La vocation du naufrage
Publié le 07/09/2013
Extrait du document

Le poète et son double
Une influence foudroyante
Alors que Baudelaire a peu écrit et peu publié au cours de la
période marquée par son engagement dans les luttes sociales,
c'est sous le second Empire qu'il donnera toute sa mesure.
Cela confirme une loi générale à laquelle obéit la création
littéraire et artistique.
Les époques de turbulence et d'agitation politique sont
rarement fécondes pour celle-ci, car l'utopie s'investit dans
l'action. On constate au contraire que la stabilité, voire la
stagnation engendrée par les régimes autoritaires sont propices
à l'explosion d'une énergie qui ne peut s'extérioriser et
qui, devant la déception causée par Je monde réel, tend à
constituer un pôle de résistance dans l'imaginaire. Il y a donc
un rapport de compensation et d'opposition à la fois entre la
réalité matérielle et la vie de l'esprit. On constate cette tension
dans la relation entre Baudelaire et son temps.
Il n'a laissé que de rares confidences sur ses sentiments à
l'égard des changements apportés par Je coup d'Etat. Il est,
d'ailleurs, significatif que dans sa correspondance il se livre
sur ce sujet en fonction de ses interlocuteurs.
Dans la lettre à sa mère du 27 mars 1852, il décrit longuement
les misères de sa vie avec Jeanne laquelle, dit-il, est
devenue «un obstacle au perfectionnement de mon esprit«.
Et il termine sur ces lignes à la fois révélatrices autant qu'évasives:
«Des événements politiques et de l'influence foudroyante
qu'ils ont eue sur moi, je te parlerai un autre jour.«
Mais la générale Aupick n'en apprendra jamais plus car il
négligera par la suite de revenir sur la situation qui s'est créée
dans le pays après le 2 décembre 1851.
Pourtant, dans une lettre à Ancelle du 5 mars de la même
année, il s'était montré plus explicite :
«Vous ne m'avez pas vu au vote; c'est un parti pris chez
moi, écrivait-il à son conseil judiciaire. Le 2 décembre m'a
physiquement dépolitiqué. Il n'y a plus d'idées générales.
Que tout Paris soit orléaniste, c'est un fait, mais cela
ne me regarde pas. Si j'avais voté, je n'aurais pu voter
que pour moi. Peut-être l'avenir appartient-il aux hommes
déclassés? «
Désormais Baudelaire se détournera de l'action politique
pour se réfugier dans une patrie spirituelle dont la réalité
historique s'éloigne de plus en plus. Dans cette deuxième
phase de son parcours il se donnera deux initiateurs pour
accéder à cette communauté idéale: un poète, Edgar Poe, et
un philosophe, Joseph de Maistre.
Dans la lettre qu'il adresse le 20 mars 1852 à PouletMalassis,
le futur éditeur des Fleurs du Mal, il laisse entendre
à mots couverts, mais de manière indubitable, que Joseph de
Maistre a pris dans sa pensée la place qu'occupaient hier
encore Fourier et Proudhon :
«Parmi toutes les personnes que je connais«, écrivait-il
à son alter ego, avec qui il pouvait s'exprimer de plainpied,
« il n'y a que sottise et passions individuelles. Personne
ne consent à se mettre au point de vue providentiel.
Vous devinez de quoi je veux parler.«

«
Dans la lettre à sa mère du 27 mars 1852, il décrit longue
ment les misères de sa vie avec Jeanne laquelle, dit-il, est
devenue
«un obstacle au perfectionnement de mon esprit».
Et il termine sur ces lignes à la fois révélatrices autant qu'éva
sives:
«Des événements politiques et de l'influence fou
droyante qu'ils ont eue sur moi, je
te parlerai un autre jour.»
Mais la générale Aupick n'en apprendra jamais plus car il
négligera par la suite de revenir sur la situation qui s'est créée
dans le pays après le 2 décembre 1851.
Pourtant, dans une lettre
à Ancelle du 5 mars de la même
année,
il s'était montré plus explicite :
«Vous ne m'avez pas vu au vote; c'est un parti pris chez
moi, écrivait-il
à son conseil judiciaire.
Le 2 décembre m'a
physiquement dépolitiqué.
Il n'y a plus d'idées générales.
Que tout Paris soit orléaniste, c'est un fait, mais cela
ne
me regarde pas.
Si j'avais voté, je n'aurais pu voter
que pour moi.
Peut-être l'avenir appartient-il aux hom
mes
déclassés? »
Désormais Baudelaire se détournera de l'action politique
pour se réfugier dans une patrie spirituelle dont la réalité
historique s'éloigne de plus en plus.
Dans cette deuxième
phase de son parcours
il se donnera deux initiateurs pour
accéder
à cette communauté idéale: un poète, Edgar Poe, et
un philosophe, Joseph de Maistre.
Dans la lettre qu'il adresse le 20 mars 1852 à Poulet
Malassis, le futur éditeur des
Fleurs du Mal, il laisse entendre
à mots couverts, mais de manière indubitable, que Joseph de
Maistre a pris dans sa pensée la place qu'occupaient hier
encore Fourier et Proudhon :
«Parmi toutes les personnes que je connais», écrivait-il
à son alter ego, avec qui il pouvait s'exprimer de plain
pied, « il n'y a que sottise et passions individuelles.
Per
sonne ne consent à se mettre au point de vue providen
tiel.
Vous devinez de quoi je veux parler.»
Et un peu plus loin, il confirmait sa volonté de désengagement:
«Tout cela me divertit beaucoup.
Mais je suis décidé à
rester désormais étranger à toute la polémique humaine,
et plus décidé que jamais à poursuivre le rêve supérieur
de l'application de la métaphysique au roman.».
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Texte d’étude : Charles Baudelaire, « L’Ennemi », Les Fleurs du Mal (1857): Le temps mange-t-il la vie ? (HLP Philo)
- Analyse linéaire Bac Français A une passante de Baudelaire
- explication linéaire charogne baudelaire
- Baudelaire, A un passante, analyse linéaire
- Le poison, Charles Baudelaire