Baudelaire, « Harmonie du soir », Les Fleurs du Mal
Publié le 17/01/2022

Extrait du document
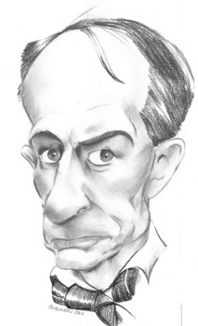
Si le titre du recueil baudelairien, Les Fleurs du Mal, fonde une analogie entre fleur et poème, il semble induire que l’activité poétique naît d’une conscience sombre et pervertie, pour faire connaître au lecteur une sorte de mort par contamination. Pourtant « Harmonie du soir «, poème qui figure dans la première section intitulée « Spleen et Idéal «, laisse paraître le motif de la fleur-poème, mais de façon à lui conférer une valeur positive. La forme codifiée du pantoum, d’origine indienne, organise le retour des alexandrins d’une strophe à l’autre, et purifie la fleur-poème de ses attraits sensuels (première et deuxième strophes) en la métamorphosant, par le douloureux travail du poète (troisième strophe), en vecteur spirituel du souvenir éternel (strophe finale. Dès lors, comment la rigidité du pantoum, et le retour du même, permettent-ils de fonder une dynamique propre à constituer la poésie comme moyen de solidifier le souvenir contre les assauts de la mort et de l’oubli ?
Baudelaire fait l’expérience d’un envoûtement sensuel (première partie), à la manière d’un impressionniste, à travers la présence charnelle et fluide du matériau sonore. Mais la nostalgie de l’Idéal invite le poète à chercher un sens sacré (deuxième partie) derrière les signes de la nature. Ce désir, ce manque alimentent une foi dans le travail poétique (troisième partie), qui répond au délitement du réel par le rituel de résurrection qu’opère la mémoire.
Le poète s’abandonne au « vertige « du rythme poétique, qui seul peut rendre compte d’une connaissance profonde et totale de la nature dans la mesure où elle s’empare de tous les sens, de toutes les dynamiques, pour mieux imposer sa fugacité L’atmosphère orchestre un ballet d’impressions, autant de présences auxquelles le poète qui occupe le cœur de l’espace ne peut se soustraire. Aussi témoigne-t-il d’une expérience synesthésique, à travers la mention des sons et des parfums qui, mêlés, semblent renforcer leur puissance labile les uns des autres : de toutes les sensations, le poète est envahi avant tout par les plus fuyantes et les plus ténues. Elles sont rappelées métonymiquement par la référence à leur origine (la fleur, le violon), et leur conséquence (la valse), et des allitérations en labiales (« fleurs «, « mélancolique «, « langoureux «, « afflige «) et en fricatives (« voici «, « venir «, « vibrant «, « s’évapore «, « valse «, « vertige «, « violon «) dans les deux premières strophes, comme pour prolonger leur présence. Malgré la douceur d’un demi-jour, les facultés visuelles sont éprouvées par les couleurs du couchant, qu’évoquent les termes « noir «, « sang «, « soleil «, « lumineux «, « luit «, tons contrastés qui, conjoints à la technique de parataxe à l’œuvre pour égrener chacune des impressions, ne sont pas sans rappeler le courant pictural impressionniste de l’époque. La nature constitue cependant un tout organisé où chaque fragment a sa place. Ainsi sont évoqués les quatre éléments : sons et parfums remplissent l’air, mentionné précisément au vers 3, tige et fleur font référence à la terre, le soleil est symbole et incarnation du feu, et le ciel de l’eau, comme en atteste l’image de la noyade. Si cette sensualité profuse prend place dans un espace organisé, elle n’en demeure pas moins dynamisée par des échanges entre les objets, qui en assurent la force d’envoûtement. L’étude des mouvements évoqués par le texte permet de dégager la charge invocatoire du poème, et de cerner la fonction paradoxalement vivifiante du ressassement. La première strophe met en lumière l’envoûtement qu’opère le paysage, animé par des mouvements très légèrement modulés. Le poète commence par évoquer un balancement dans le terme « vibrant «, puis une effusion dans « s’évapore «, le tournoiement dans « tournent «, toutes ces manifestations s’incarnant dans le substantif « valse « qui récupère l’ensemble des sens égrenés auparavant. Le rythme des vers 3 et 4, en 2-4-2-4, est mimétique de la claudication de la danse. Les substantifs « valse « et « vertige «, disposés en chiasme aux deux extrémités du vers 4, aimantent l’attention du lecteur vers les pôles, et ce mouvement centrifuge restitue la violence du tourbillon. Pourtant, ces secousses de gaieté se muent en une forme pathologique, d’où le verbe « frémit « au vers 6, avant d’aboutir à l’immobilité, symbole de mort (le verbe « être « au vers 8 fonctionne à la fois comme verbe d’état, support de la description, et comme indication spatiale qui réfère à la fixité) confirmé par la noyade (« se fige «). Cependant, cette mort s’avère n’être qu’un repli temporaire, voire stratégique : le poète « recueille « pour mieux faire ressurgir, l’engloutissement est le préalable nécessaire à l’apothéose rayonnante que signale le verbe « luit « à la fin du poème.
Le mouvement de spirale ne mène à l’horizontalité du reposoir que pour mieux plonger et rejaillir, suivant une dialectique positive de la verticalité, de même que le silence des points de suspension (vers 15) ouvre à la tonicité victorieuse de l’exclamative. Le temps propre aux mouvements de danse, présent en perpétuelle recomposition, offre cependant le vertige de l’inconsistance, qui ne garantit en rien, d’emblée, la réussite finale.
Si l’absorption dans la délectation sensuelle est vécue comme une extase, elle contient en creux la menace de sa disparition, puisqu’un de ses attraits réside dans le caractère ultime de l’instant : le soir. L’évolution du sens des présents et les rapports du poète à l’instant manifestent cette ambiguïté angoissante. Le présentatif « voici venir « joue le rôle d’embrayeur, dans la mesure où il ouvre une dynamique temporelle dans laquelle se profile l’ensemble du poème, et la tonalité prophétique signale la singularité de ce moment. Le participe présent « vibrant « actualise immédiatement le procès, en concentrant les valeurs duratives et itératives du signifiant. Les présents des vers deux et trois, placés sous l’égide de la formule d’attaque, conservent cependant une charge de futur. La deuxième strophe reprend deux de ces vers, mais ils sont libérés de la prophétie, et s’actualisent pleinement comme des présents descriptifs. Aussi les présents réitérés dans la troisième strophe sont-ils plus menaçants : déjà réalisés auparavant, peuvent-ils se prolonger plus longtemps ? La menace de dissolution s’achève par l’usage du passé composé qui marque l’accompli du présent : dans le « s’est noyé « du vers 12, le poète prend conscience d’être dépassé par la temporalité. La strophe finale renverse pourtant le processus : le poète accepte de se séparer de l’actualité, par l’usage des présents gnomiques « hait « et « recueille « qui évoquent les facultés que le poète peut mettre à contribution à toute occasion, pour pérenniser le passé dans le souvenir, d’où le passage du passé composé « s’est noyé « à « luit «. Ainsi, le présent connu sur le mode de la sensation n’est guère que précaire, et seul le travail poétique permet de transfigurer la fragilité en éternité. N’est-ce fonder le principe de l’écriture poétique dans la quête d’un absolu soustrait à l’anéantissement de la mort ?
Si « Harmonie du soir « appartient à la section « Spleen et Idéal «, c’est qu’il dépasse la mélancolie douce (le spleen) par la recherche d’une vérité plus solide (l’idéal). Aussi l’architecture du poème permet-elle d’approfondir la portée spirituelle de l’expérience sensuelle, qui en devient mystique. Paysage-état d’âme, le poème-fleur fait accéder non seulement aux sentiments du poète, mais également à une figure divine qui explique la majesté de la parole poétique. Le poème n’est en aucune façon l’évocation référentielle d’une expérience. Chacun des éléments est transposition métaphorique et métonymique des sentiments du poète. Aussi la pièce met-elle davantage l’accent sur les adjectifs qualificatifs, qui signalent l’effet des objets sur le spectateur, que sur les substantifs qui indiqueraient une essence, une vérité de l’objet. Ainsi en est-il des termes « triste et beau «, « hait «. Le chiasme grammatical (substantif-adjectif-adjectif-substantif) et rythmique (2-4-4-2) du vers 4, ralentit et alourdit le vers, afin de suggérer cette atmosphère mélancolique pesante. L’analogie du violon avec le cœur du poète permet de poser l’équation entre la valse enivrante et le chant poétique qui déroule les sentiments : le vertige s’explique par la dilatation du moi aux dimensions de la nature entière. Le soleil récupère alors son sens allégorique traditionnel, à savoir celui de l’amour, qu’il faut arracher à la mort par le souvenir. Lorsque le dernier vers emploie pour la première fois des marques personnelles, par l’intermédiaire de l’adjectif « ton « et du pronom « moi «, il explicite la fonction état d’âme du poème et invite le lecteur à une relecture qui se ferait dans ce sens. Le poème devient le détour nécessaire pour rétablir l’alliance avec la femme aimée, à travers un rite religieux. La quête de l’absolu se résout alors en recherche du sacré. L’aimée disparue devient l’objet d’un rite, et le poème, instrument d’une célébration commémorative qui retrouve, telle une anamnèse, le temps de la vie du Christ, sous la figure de cette femme. Par l’usage de tournures comparatives lourdes telles que « ainsi qu’un encensoir «, « comme un grand reposoir «, « comme un ostensoir «, Baudelaire dénude le processus de symbolisation, qui favorise le passage des objets profanes aux objets sacrés du culte. L’extase mystique, le ton prophétique s’inscrivent dès lors dans un rite eucharistique. Le cœur sanglant n’est pas sans rappeler le sacré-cœur du Christ : l’adjectif « tendre « est à comprendre dans son sens ancien de ce qui est fragile ; le reposoir symbolise une station dans la montée au Calvaire ; le néant, sa passion ; le soleil, l’hostie ; l’ostensoir glorieux, la résurrection finale. La nausée des sens qu’évoque la première strophe manifeste le besoin de dépasser l’expérience par une communication avec le divin. La forme du pantoum devient l’instrument privilégié d’une incantation qui ressuscite le souvenir de la femme, grâce à une adoration solennelle.
La majesté des vers témoigne d’une recherche de l’idéalité des canons poétiques, recourant aux modèles classiques d’une architecture travaillée, comme si l’absolu de la parole pouvait seul toucher l’absolu de la quête. La formule prophétique d’attaque réfère d’emblée à la parole sacrée, messianique, de l’Ancien Testament. Le lecteur est ainsi placé dans un procès dramatisé, dont la gravité explique l’usage du registre soutenu. Les pluriels deviennent alors marques de majesté, dans les termes « les temps «, « les sons «, « les parfums «. Le vocabulaire est simple voire pauvre, tel les adjectifs « triste et beau «, exception faite des termes précis et techniques qui désignent les objets du culte, mais qui servent nécessairement la richesse des images, puisque ces objets ne sauraient être évoqués autrement. Une telle simplicité confère au texte une grande pureté, et elle est compensée par la recherche de rimes très riches, dont la cohérence est moins à chercher au sein d’une même strophe, que comme échos entre les différentes strophes : « sa tige « rime alors avec « afflige « et « se fige «, « vertige « avec « vestige «, « encensoir « avec « vaste et noir « et « ostensoir «, « air du soir « avec « reposoir «. Une rigueur quasi mathématique fait alterner rimes masculines et féminines, rimes sur deux pieds et rimes sur trois pieds, dans une structure embrassée. Les alexandrins, mètres de majesté, se déploient presque toujours régulièrement avec césure à l’hémistiche. Enfin, ce rythme binaire est renforcé par des structures lexicales binaires, telles « les sons et les parfums «, « valse mélancolique et langoureux vertige «, « triste et beau «, « vaste et noir «, mimétiques du balancement de l’encensoir. Ainsi, dans le corps même du poème se lit la conscience poétique au travail, qui tente de conférer à sa parole pure une valeur spirituelle propre à rétablir la communication avec le divin. Le travail réalisé sur le langage suppose un acharnement, un approfondissement progressif de l’écriture par un poète sûr des vertus de l’acte poétique.
Le pantoum consiste à retravailler une expression poétique pour créer une épaisseur de sens. Mais seul une croyance ferme dans la fonction créatrice du rythme poétique permet de dépasser l’illusion que le ressassement des mêmes termes est vain. Aussi ce poème structuré fait-il l’épreuve douloureuse de la foi du poète dans son activité, et ouvre à une proclamation victorieuse du pouvoir poétique. La structure de « Harmonie du soir « montre la progression laborieuse du poète vers cette profession de foi. La strophe 1 est empreinte d’une mélancolie douce et heureuse dont témoigne la maîtrise de la métrique (4-2-3-3 vers 1 et 3-3-3-3 au vers 2, ce qui connote la sérénité, et 2-4-2-4 aux vers 3 et 4, mimétiques des sautillements de la valse). A la seconde strophe émerge une note discordante, donc angoissante : la diérèse sur « vi-olon « renforce la stridence du [i] de « frémit «, confirmée par la sécheresse des monosyllabes du vers 8, et la disharmonie est confortée par le fait que le vers le plus heureux de la première strophe, le vers 3, n’est pas repris. Pourtant, le vers 7, lent, atténue l’agressivité du vers 6, et l’image du reposoir évoquée dans une déclarative grave au vers 8 ménage une pause pour reprendre le souffle. La strophe 3 constitue une rupture en tant qu’elle marque l’apogée de la perturbation : la reprise du vers 6 est prolongée par la rupture rythmique forte du vers 10 organisée autour de la pause forte qu’est la virgule, et autour de la scansion des monosyllabes. La sérénité n’est guère retrouvée que dans la mort, à savoir dans l’immobilité hiératique que suggère le vers 12, articulé en tétramètre régulier (3-3-3-3). Cette sérénité redevient positive dans la strophe finale lorsqu’il s’agit d’évoquer la maîtrise dont fait preuve le poète à travers son art : le vers 14 est un tétramètre régulier, et le vers final en 4-2-1-5, sorte de cadence majeure, triomphe du silence menaçant des points de suspension et relance le souffle dans l’exaltation de l’exclamative. De même, l’exclamation attestait de l’épuisement de plus en plus rapide du souffle poétique, dans la mesure où elle « remontait « dans la structure de chaque nouvelle strophe (vers 4, 7, 9), incapable de vectoriser longtemps l’élan de la parole. Elle restitue une nouvelle énergie dans sa double occurrence de la strophe finale. Aussi se met-il en place une dynamique dans la structure du pantoum puisque la délectation de la valse s’épuise progressivement jusqu’à parvenir à la disharmonie, l’immobilité et la mort, pour trouver un nouvel élan dans l’enthousiasme final. La progression souligne cependant la nécessité pour le poète de passer par le mal et l’anéantissement avant de retrouver une harmonie pérenne.
La souffrance devient mal nécessaire à l’expérience poétique. L’image de la déperdition d’énergie dans l’expansion hante Baudelaire : si le poème est fleur, comment parler sans l’épuiser ? Le motif de la fragilité et la précarité est latent dès le début du poème, dans la finesse de la tige, ou la singularité et la ténuité des fleurs que note le terme « chaque «. Le violon est le symbole de la torture que doit s’infliger le poète pour produire son chant, dans la mesure où la résurrection du souvenir est l’aveu de son essence passée, en même temps que sa conjuration. La mélancolie se mâtine alors de douceur, d’où les deux oxymores du vers 4, ou l’antithèse du ciel « triste et beau «. Le cri du vers 10 devient un performatif qui vise, en disant la mort par l’euphémisme du « néant vaste et noir «, à repousser l’invasion des forces dissolvantes de l’oubli. Cette parole désespérée semble échouer dans le suspens ménagé à la fin du vers 15. En vérité, le poète a rassemblé ses forces (« recueille « est à entendre au sens propre), et le passage par la mort permet la transfiguration du « néant vaste et noir « en « passé lumineux «, éternellement rayonnant, et exhibé comme tel par l’ostensoir. Ce geste final de revendication et de fierté témoigne de ce que le poème a rempli sa mission. Le poète dénude donc ici ce qui constitue pour lui la valeur de ses poèmes.
Un métadiscours, discours sur son propre discours, se met en place, qui approfondit la portée du poème : celui-ci est tout à la fois théorie et vérification par l’expérimentation. Les vers 2 et 14, réemployant les images florales qui désignent les poèmes dans le titre même du recueil, font référence au travail poétique, de même que l’image du violon. Il s’agit pour Baudelaire d’éviter tout à la fois l’évaporation, donc la disparition de la femme aimée dans l’oubli, et la pétrification qui « fige «. Le poème se doit de fixer le souvenir sans en altérer la dynamique, la vie interne, la puissance vivifiante. La forme du pantoum devient dès lors la structure la plus propice à pareille transfiguration, si tant est qu’elle conjoint la solidification dans un moule rythmique précis, d’une part au recueillement, conçu comme rétention du souffle (par le retour des mêmes vers et sonorités qui créent une mémoire chez le lecteur), et d’autre part à la légèreté d’un glissement en douceur d’une strophe à l’autre, de la mort à la résurrection. Par la poésie, l’amour échappe alors au temps, et sa fugacité devient objet de délectation infinie. Le poème devient tout à la fois résurrection de l’aimée, révélation de la vérité leur rapport amoureux, mimé pour le lecteur par l’apparition inopinée des marques de personne au dernier vers, et adoration de cet amour. Si l’analogie entre fleur, femme et poème reste conventionnelle, l’emploi de la structure du pantoum pour dynamiser l’émergence du souvenir en réutilisant les phases du culte l’est beaucoup moins. Le poème s’instaure alors comme parole sacrée, mais liée à l’intimité qu’elle purifie et transcende.
Le pantoum, loin de se résoudre en un vain ressassement litanique qui ne mène qu’au vertige mortel, offre au poète des prises pour fonder l’assise du souvenir. L’économie structurelle de la pièce constitue les garde-fous de la délectation morose dans la mélancolie, si bien que le poète peut fixer ses regards vers l’Idéal à construire par le labeur poétique. Si le pantoum apparaît comme la forme clé qui répond à la définition baudelairienne de la poésie comme thyrse (bâton entouré d’un ruban en spirale), le poème en prose, dont le poète fera usage, vise-t-il à transfigurer le temps de la même façon, à savoir comme une expérience déployée dans la durée ? Ne cherche-t-il plutôt à cerner une connaissance plus moderne de la temporalité où bouleversements et discordances auraient plus de poids ?
Liens utiles
- Les Fleurs du mal - Spleen et Idéal - Charles Baudelaire : HARMONIE DU SOIR
- Baudelaire, « Harmonie du soir », Les Fleurs du Mal
- HARMONIE DU SOIR - BAUDELAIRE, Fleurs du Mal (commentaire)
- PODCAST: Harmonie du soir - Les Fleurs du mal - Spleen et Idéal - Charles Baudelaire
- BAUDELAIRE: LES FLEURS DU MAL : Harmonie du soir































