Balzac (Le colonel Chabert) - Premier chapitre (Chabert et Derville)
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
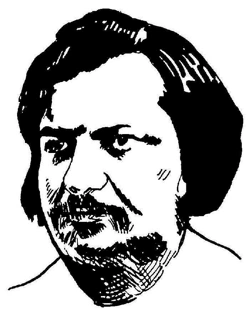
" Le jeune avoué demeura pendant un moment stupéfait en entrevoyant dans le clair-obscur le singulier client qui l'attendait. Le colonel Chabert était aussi parfaitement immobile que peut l'être une figure en cire de ce cabinet de Curtius où Godeschal avait voulu mener ses camarades. Cette immobilité n'aurait peut-être pas été un sujet d'étonnement, si elle n'eût complété le spectacle surnaturel que présentait l'ensemble du personnage. Le vieux soldat était sec et maigre. Son front, volontairement caché sous les cheveux de sa perruque lisse, lui donnait quelque chose de mystérieux. Ses yeux paraissaient couverts d'une taie transparente: vous eussiez dit de la nacre sale dont les reflets bleuâtres chatoyaient à la lueur des bougies. Le visage pâle, livide, et en lame de couteau, s'il est permis d'emprunter cette expression vulgaire, semblait mort. Le cou était serré par une mauvaise cravate de soie noire. L'ombre cachait si bien le corps à partir de la ligne brune que décrivait ce haillon, qu'un homme d'imagination aurait pu prendre cette vieille tête pour quelque silhouette due au hasard, ou pour un portrait de Rembrandt, sans cadre. Les bords du chapeau qui couvrait le front du vieillard projetaient un sillon noir sur le haut du visage. Cet effet bizarre, quoique naturel, faisait ressortir, par la brusquerie du contraste, les rides blanches, les sinuosités froides, le sentiment décoloré de cette physionomie cadavéreuse. Enfin l'absence de tout mouvement dans le corps, de toute chaleur dans le regard, s'accordait avec une certaine expression de démence triste, avec les dégradants symptômes par lesquels se caractérise l'idiotisme, pour faire de cette figure je ne sais quoi de funeste qu'aucune parole humaine ne pourrait exprimer."
I. Un portrait contrasté
- L'organisation du portrait
- Les lignes et les contrastes
II. Un spectacle fascinant
- L'art du clair-obscur
- La stupeur des spectateurs
III. Sous le signe de la mort
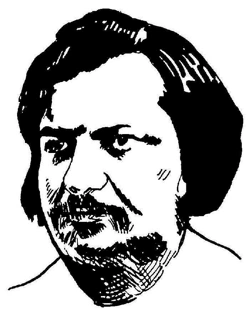
«
car toute sa personne est un «sujet d'étonnement» (l.
6-7), son chapeau provoque un « effet bizarre » (l.
22), etl'ensemble est un «spectacle surnaturel» (l.
7).
L'étrangeté est telle que le narrateur, qui intervient à la premièrepersonne («je ne sais quoi», 1.
29), avoue son incapacité à en rendre l'essence qu'« aucune parole humaine nepourrait exprimer» (l.
30).
Seul un «homme d'imagination» (l.
18) pourrait trouver un point de comparaison entre leColonel Chabert et un dessin ou un tableau.
Le lecteur lui-même est sollicité par le narrateur qui écrit : « vouseussiez dit de la nacre» (l.
12).
Le portrait se développe donc sous les yeux de Derville, du narrateur et du lecteur,d'autant plus fascinant que tous les participants sont pétrifiés par cette apparition d'outre-tombe.En effet, ce « vieux soldat» (l.
8), qui n'a plus sa place dans la société civile, n'a pas non plus de place dans lemonde des vivants, marqué qu'il est des signes de la mort.
Ce « débris » de l'armée napoléonienne comme l'appelleBalzac est une ruine humaine.
Son corps de « vieillard » (l.
21) décharné est noyé dans l'ombre du néant et seuleémerge la «physionomie cadavéreuse» (l.
25) de son visage émacié.
L'adjectif est significatif et d'autres élémentsviennent corroborer cette impression que nous sommes face à un cadavre : le regard voilé d'une « taie » (l.
11)s'inscrit dans un visage « livide » (l.
14) aux traits marqués de «sinuosités froides» (l.
24).
De manière significative,les mots « mort » (l.
15), « cadavéreuse» (l.
25) et, à un moindre degré, « noire » (l.
16) et « maigre » (l.
9), setrouvent en fin de phrase où ils acquièrent une grande force de suggestion.
La place des adjectifs, après lessubstantifs, rythme et alourdit le propos dans l'énumération : «les rides blanches, les sinuosités froides, le sentimentdécoloré de cette physionomie cadavéreuse» (l.
23-25).
La dernière phrase résume cette impression dansl'expression «je ne sais quoi de funeste» (l.
29) qui traduit le malaise ressenti face à cet être « mystérieux » (l.
10)qui n'appartient déjà plus au monde des vivants.L'ensemble du texte est d'ailleurs contaminé par la morbidité du portrait.
Nous savons que la scène se passe à uneheure du matin et la « lueur des bougies» (l.
13) peut être celle d'une veillée funèbre, comme la « mauvaise cravatede soie noire » (l.
16) habille d'un « haillon » (l.
18) le Colonel à la façon d'un vêtement de mort.
D'autre part,l'expression dont s'excuse Balzac, «le visage [...] en lame de couteau» (l.
13-14), renvoie de manière indirecte à lablessure qu'a reçue le soldat, ce coup de sabre qui l'oblige à porter une perruque pour masquer son crâne ouvert.Enfin, la succession des phrases, sans véritable lien syntaxique entre elles, permet au texte de se maintenir danscette immobilité qui caractérise le personnage.
Chabert est aussi « immobile que peut l'être une figure en cire» (l.
3-4) ; son « immobilité » (l.
6) est mentionnée une fois encore et la fin du texte souligne «l'absence de toutmouvement» (l.
25-26).
Le caractère statique du portrait tient autant à l'immobilité du personnage qu'à la stupeurde l'avoué Derville, comme soumis, lui aussi, à une raideur cadavérique.
Le passage est encadré par les mentions decette fixité : « Le jeune avoué » est « un moment stupéfait» (l.
1) devant le Colonel «parfaitement immobile» (l.
3-4) au début ; « l'absence de tout mouvement» (l.
25-26) et « l'idiotisme » (l.
28-29) de la fin.
***
Ainsi la présentation du héros, le Colonel Chabert, nous plonge-t-elle d'emblée dans un sentiment de malaise face àce revenant, ni vraiment vivant, ni complètement mort.
Balzac, par la juxtaposition de détails picturaux, sait nousrendre présente cette sombre mais intéressante figure dans laquelle se concentrent la misère de la déchéance etl'inquiétante absence au monde..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Colonel Chabert: l'incipit, la description du colonel Chabert dans le cabinet de Derville (BALZAC)
- (SA). En 1832, Balzac écrit colonel Chabert. Balzac est né
- Le personnage de CHABERT (le colonel) d’Honoré de Balzac
- Analyse Balzac-Colonel Chabert
- le portrait du colonel Chabert Balzac

































