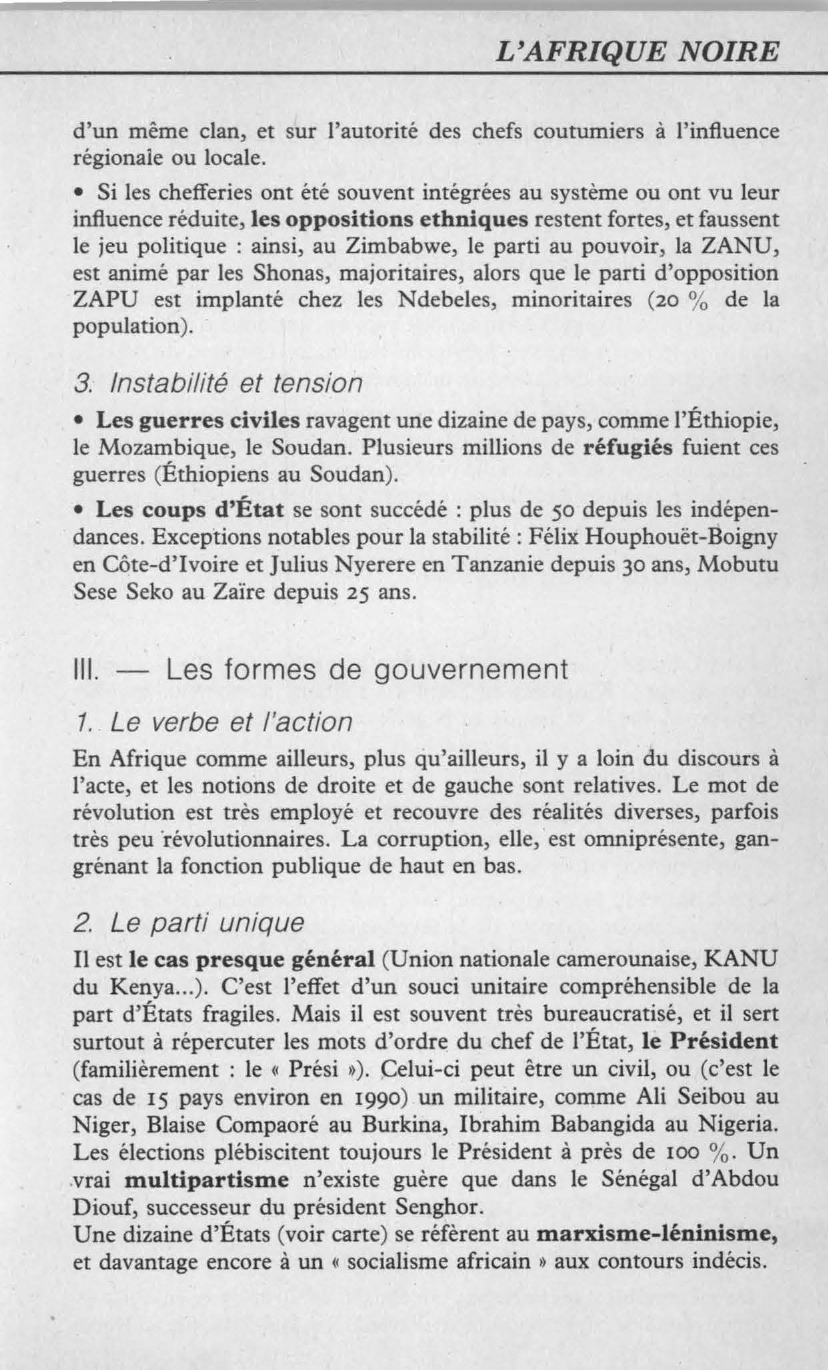Après avoir fait soit un résumé qui respecte le mou¬vement de la page suivante, soit une analyse qui en dis¬tingue et ordonne les thèmes principaux, vous dégagerez du texte le problème qui vous paraît le plus important, vous le discuterez s'il y a lieu et vous exposerez vos vues personnelles sur la question.
Publié le 29/03/2014

Extrait du document

Après avoir fait soit un résumé qui respecte le mou¬vement de la page suivante, soit une analyse qui en dis¬tingue et ordonne les thèmes principaux, vous dégagerez du texte le problème qui vous paraît le plus important, vous le discuterez s'il y a lieu et vous exposerez vos vues personnelles sur la question.
Il y a dans le monde deux sortes de grandeurs ; car il y a des grandeurs d'établissement et des grandeurs naturelles. Les gran-deurs d'établissement dépendent de la volonté des hommes, qui ont
cru avec raison devoir honorer certains états et y attacher certains respects. Les dignités et la noblesse sont de ce genre. En un pays on honore les nobles, en l'autre les roturiers ; en celui-ci les aînés, en cet autre les cadets. Pourquoi cela ? Parce qu'il a plu aux hommes. La chose était indifférente avant l'établissement : après l'établissement elle devient juste, parce qu'il est injuste de la troubler.
Les grandeurs naturelles sont celles qui sont indépendantes de la fantaisie des hommes, parce qu'elles consistent dans des qualités réelles et effectives de l'âme ou du corps, qui rendent l'une ou l'autre plus estimable, comme les sciences, la lumière de l'esprit, la vertu, la santé, la force.
Nous devons quelque chose à l'une et à l'autre de ces grandeurs ; mais comme elles sont d'une nature différente, nous leur devons aussi différents respects.
Aux grandeurs d'établissement, nous leur devons des respects d'établissement, c'est-à-dire certaines cérémonies extérieures qui doivent être néanmoins accompagnées, selon la raison, d'une reconnaissance intérieure de la justice de cet ordre, mais qui ne nous font pas concevoir quelque qualité réelle en ceux que nous honorons de cette sorte. Il faut parler aux rois à genoux ; il faut se tenir debout dans la chambre des princes. C'est une sottise et une bassesse d'esprit que de leur refuser ces devoirs.
Mais pour les respects naturels qui consistent dans l'estime, nous ne les devons qu'aux grandeurs naturelles ; et nous devons au contraire le mépris et l'aversion aux qualités contraires à ces grandeurs naturelles. Il n'est pas nécessaire, parce que vous êtes duc, que je vous estime ; mais il est nécessaire que je vous salue. Si vous êtes duc et honnête homme, je rendrai ce que je dois à l'une et à l'autre dè ces qualités. Je ne vous refuserai point les cérémonies que mérite votre qualité de duc, ni l'estime que mérite celle d'honnête homme. Mais si vous étiez duc sans être honnête homme, je vous ferais encore justice ; car en vous rendant les devoirs extérieurs que l'ordre des hommes a attachés à votre naissance, je ne man¬querais pas d'avoir pour vous le mépris intérieur que mériterait la bassesse de votre esprit.
PASCAL, Second discours sur la condition des grands.
RÉSUMÉ
Parlant aux grands, Pascal distingue deux sortes de grandeurs : les grandeurs d'établissement et les grandeurs naturelles. Les grandeurs d'établissement dépendent des coutumes d'un pays
qui ont attaché des honneurs particuliers à certains états ; les grandeurs naturelles tiennent aux qualités réelles des hommes. Aux premières nous devons des signes extérieurs de respect ; aux secondes nous devons l'estime. Mais nous ne devons pas confondre les deux niveaux de grandeur.
ANALYSE
Pascal part de la distinction entre les grandeurs d'établisse¬ment et les grandeurs naturelles.
I° Il en fait la définition
a) Les grandeurs d'établissement, comme les dignités et la noblesse, sont arbitraires. Elles ont été instituées simplement parce que certaines conventions sont nécessaires.

«
L'AFRIQUE NOIRE
d'un même clan, et sur l'autorité des chefs coutumiers à l'influence
régionale ou locale .
• Si les chefferies ont été souvent intégrées au système ou ont vu leur
influence réduite, les oppositions ethniques restent fortes, et faussent
le jeu politique : ainsi, au Zimbabwe, le parti au pouvoir, la ZANU, est animé par les Shonas, majoritaires, alors que le parti d'opposition ZAPU est implanté chez les Ndebeles, minoritaires (20 % de la population ).
3.
Instabilité et tension
• Les guerres civiles ravagent une dizaine de pays, comme l'Éthiopie,
le Mozambique, le Soudan.
Plusieurs millions de réfugiés fuient ces
guerres (Éthiopiens au Soudan ).
• Les coups d'État se sont succédé : plus de 50 depuis les indépen
dances.
Exceptions notables pour la stabilité: Félix Houphouët-Boigny
en Côte-d'Ivoire et Julius Nyerere en Tanzanie depuis 30 ans, Mobutu
Sese Seko au Zaïre depuis 25 ans.
Ill.
-Les formes de gouvernement
1.
Le verbe et l'action
En Afrique comme ailleurs, plus qu'ailleurs, il y a loin du discours à l'acte, et les notions de droite et de gauche sont relatives .
Le mot de
révolution est très employé et recouvre des réalités diverses, parfois
très peu 'révolutionnaires.
La corruption, elle, est omniprésente, gan
grénant la fonction publique de haut en bas.
2.
Le parti unique
Il est le cas presque général (Union nationale camerounaise, KANU du Kenya ...
).
C'est l'effet d'un souci unitaire compréhensible de la part d'États fragiles.
Mais il est souvent très bureaucratisé, et il sert
surtout à répercuter les mots d'ordre du chef de l'État, le Président
(familièrement : le « Prési ») .
Celui-ci peut être un civil, ou (c'est le
cas de
15 pays environ en 1990 ) un militaire, comme Ali Seibou au
Niger, Blaise Compaoré au Burkina, Ibrahim Babangida au Nigeria .
Les élections plébiscitent toujours le
Président à près de 100 %.
Un .vrai multipartisme n'existe guère que dans le Sénégal d'Abdou
Diouf, successeur du président Senghor.
Une dizaine d'États (voir carte) se réfèrent au marxisme-léninisme,
et davantage encore à un « socialisme africain» aux contours indécis..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- PASCAL, Second discours sur la condition des grands. Après avoir fait soit un résumé qui respecte le mouvement de la page suivante, soit une analyse qui en distingue et ordonne les thèmes principaux, vous dégagerez du texte le problème qui vous paraît le plus important, vous le discuterez s'il y a lieu et vous exposerez vos vues personnelles sur la question.
- Selon votre préférence, vous ferez soit un court résumé du passage suivant dont vous respecterez le mouvement, soit une analyse qui, distinguant et analysant les thèmes, s'attache à rendre compte de leurs rapports. Vous dégagerez ensuite du texte un problème que vous jugez important, en préciserez les données, le discuterez s'il y a lieu et exposerez, en les justifiant, vos propres vues sur la question.
- Selon votre préférence, vous ferez soit un court résumé du passage suivant dont vous respecterez le mouvement, soit une analyse qui, distinguant et analysant les thèmes, s'attache à rendre compte de leurs rapports. Vous dégagerez ensuite du texte un problème que vous jugez important, en préciserez les données, le discuterez s'il y a lieu et exposerez, en les justifiant, vos propres vues sur la question.
- Vous ferez, suivant votre préférence, soit un résumé respectant le mouvement de ce texte, soit une analyse en ordonnant les thèmes. Vous en dégagerez ensuite un problème que vous jugez important, vous en préciserez les données et vous exposerez, en les justifiant, vos propres vues sur la question.
- Vous donnerez d'abord un résumé ou une analyse (à votre choix, mais en l'indiquant clairement au début), du passage suivant de La Démocratie en Amérique, ouvrage publié par l'historien Tocqueville en 1836-1839. Puis vous choisirez dans ce texte un problème; vous en préciserez les données selon l'auteur; vous exposerez, en les justifiant, vos propres vues sur la question.