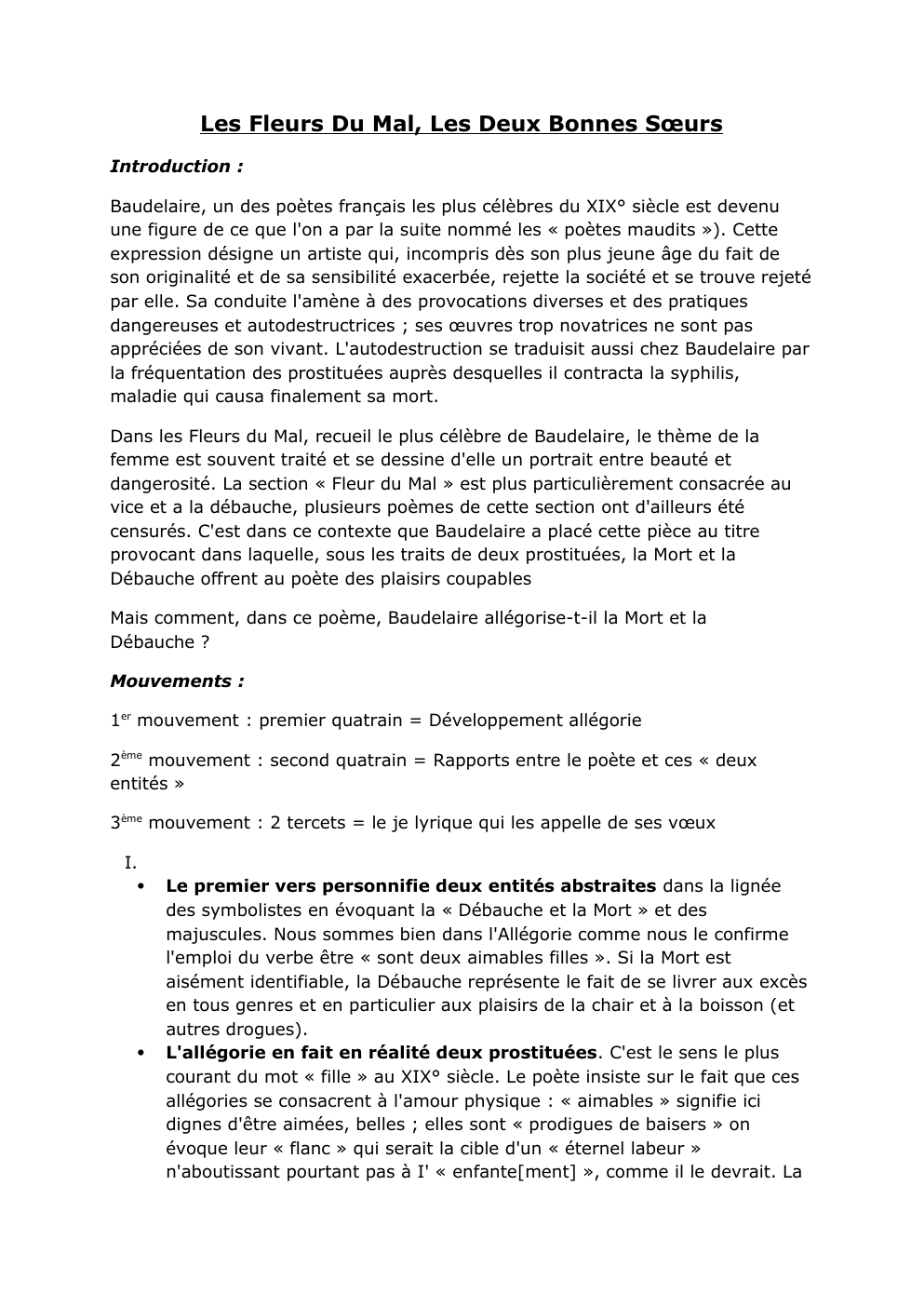Analyse linéaire les deux bonnes soeurs
Publié le 19/02/2023
Extrait du document
«
Les Fleurs Du Mal, Les Deux Bonnes Sœurs
Introduction :
Baudelaire, un des poètes français les plus célèbres du XIX° siècle est devenu
une figure de ce que l'on a par la suite nommé les « poètes maudits »).
Cette
expression désigne un artiste qui, incompris dès son plus jeune âge du fait de
son originalité et de sa sensibilité exacerbée, rejette la société et se trouve rejeté
par elle.
Sa conduite l'amène à des provocations diverses et des pratiques
dangereuses et autodestructrices ; ses œuvres trop novatrices ne sont pas
appréciées de son vivant.
L'autodestruction se traduisit aussi chez Baudelaire par
la fréquentation des prostituées auprès desquelles il contracta la syphilis,
maladie qui causa finalement sa mort.
Dans les Fleurs du Mal, recueil le plus célèbre de Baudelaire, le thème de la
femme est souvent traité et se dessine d'elle un portrait entre beauté et
dangerosité.
La section « Fleur du Mal » est plus particulièrement consacrée au
vice et a la débauche, plusieurs poèmes de cette section ont d'ailleurs été
censurés.
C'est dans ce contexte que Baudelaire a placé cette pièce au titre
provocant dans laquelle, sous les traits de deux prostituées, la Mort et la
Débauche offrent au poète des plaisirs coupables
Mais comment, dans ce poème, Baudelaire allégorise-t-il la Mort et la
Débauche ?
Mouvements :
1er mouvement : premier quatrain = Développement allégorie
2ème mouvement : second quatrain = Rapports entre le poète et ces « deux
entités »
3ème mouvement : 2 tercets = le je lyrique qui les appelle de ses vœux
I.
Le premier vers personnifie deux entités abstraites dans la lignée
des symbolistes en évoquant la « Débauche et la Mort » et des
majuscules.
Nous sommes bien dans l'Allégorie comme nous le confirme
l'emploi du verbe être « sont deux aimables filles ».
Si la Mort est
aisément identifiable, la Débauche représente le fait de se livrer aux excès
en tous genres et en particulier aux plaisirs de la chair et à la boisson (et
autres drogues).
L'allégorie en fait en réalité deux prostituées.
C'est le sens le plus
courant du mot « fille » au XIX° siècle.
Le poète insiste sur le fait que ces
allégories se consacrent à l'amour physique : « aimables » signifie ici
dignes d'être aimées, belles ; elles sont « prodigues de baisers » on
évoque leur « flanc » qui serait la cible d'un « éternel labeur »
n'aboutissant pourtant pas à I' « enfante[ment] », comme il le devrait.
La
métaphore en fait donc deux péripatéticiennes se livrant depuis toujours à
l'amour physique.
On se demande alors comment comprendre l'image.
La Débauche et la
Mort sont pour le poète aussi attirantes et faciles (« prodigues de
baisers ») que des femmes publiques.
Elles procurent comme elles du
plaisir.
Le fait qu'elles soient stériles : » leur flanc [.
.] n'a jamais enfanté
» illustre le fait que la Débauche comme la mort sont des conduites qui
mènent au néant, elles ne produisent rien mais au contraire détruisent
celui qui s'y adonne.
II.
La strophe suivante est consacrée à la figure du poète qui est
particulièrement tenté par la Débauche et la Mort, repris ici par les
lieux qu'elles hantent : « Tombeaux et lupanars »).
Le poète voit dans ces
lieux un « lit que le remords n'a jamais fréquenté ».
L'image se justifie par
le fait que dans la mort aussi bien que dans l'amour physique, on est le
plus souvent couché.
La mort comme l'amour tarifé n'est pas empoisonnée
par les scrupules moraux, les « remords ») ; le poète est à la recherche de
cette absence de tourments de la part de la conscience, de cette absence
de souffrance morale.
Se dessine également dans cette seconde strophe un portrait du poète.
On peut noter tout d'abord l'orthographe particulière de ce terme chez
Baudelaire.
Le tréma de « poète » est une allusion à l'étymologie du mot «
poète » gui vient du grec « poiêsis.»), création du verbe « poiein» qui
signifie « faire », « créer».
C'est une manière de dire que pour Baudelaire,
le poète est l'artiste en général mais aussi le créateur ce qui l'égale à une
sorte de Dieu.
Cette définition positive du poète qui est celle de Baudelaire
s'oppose à la manière dont le poète est considéré par la société
(pour plus de détails sur l'image du poète, vous pouvez lire le célèbre
poème « l'albatros »).
L'épithète « sinistre» signifie de mauvais augure,
qui annonce des malheurs, sombre, funeste, terrifiant mais renvoie non
pas à la manière dont Baudelaire considère le poète mais à la manière
dont la société le voit.
Le poète fait peur car il n'est pas compris.
Le tableau du poète pour la société est complété par trois appositions :
« ennemi des familles ».
En effet, le poète est l'ennemi du modèle
bourgeois fondé sur la cellule familiale, il est souvent en rupture avec
celle-ci.
On peut aussi comprendre qu'il ne souhaite pas en fonder, d'où
son attrait pour la stérilité de la Débauche, du sexe pour le sexe et non
pour la procréation ou pour la Mort, qui mettra fin à sa lignée.
« Favori de
l'enfer » : présente une allitération en « f » (et « v » sonorité proche) et «
r » qui rend la formule marquante phoniquement.
Par sa prise de distance
avec la morale bourgeoise, le poète....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- analyse linéaire Les caractères Giton et Phédon
- Analyse linéaire de l'incipit Au Bonheur des dames
- analyse linéaire Les Caractères V, 9 (portrait d'Arrias)
- Analyse linéaire Bac Français A une passante de Baudelaire
- Baudelaire, A un passante, analyse linéaire