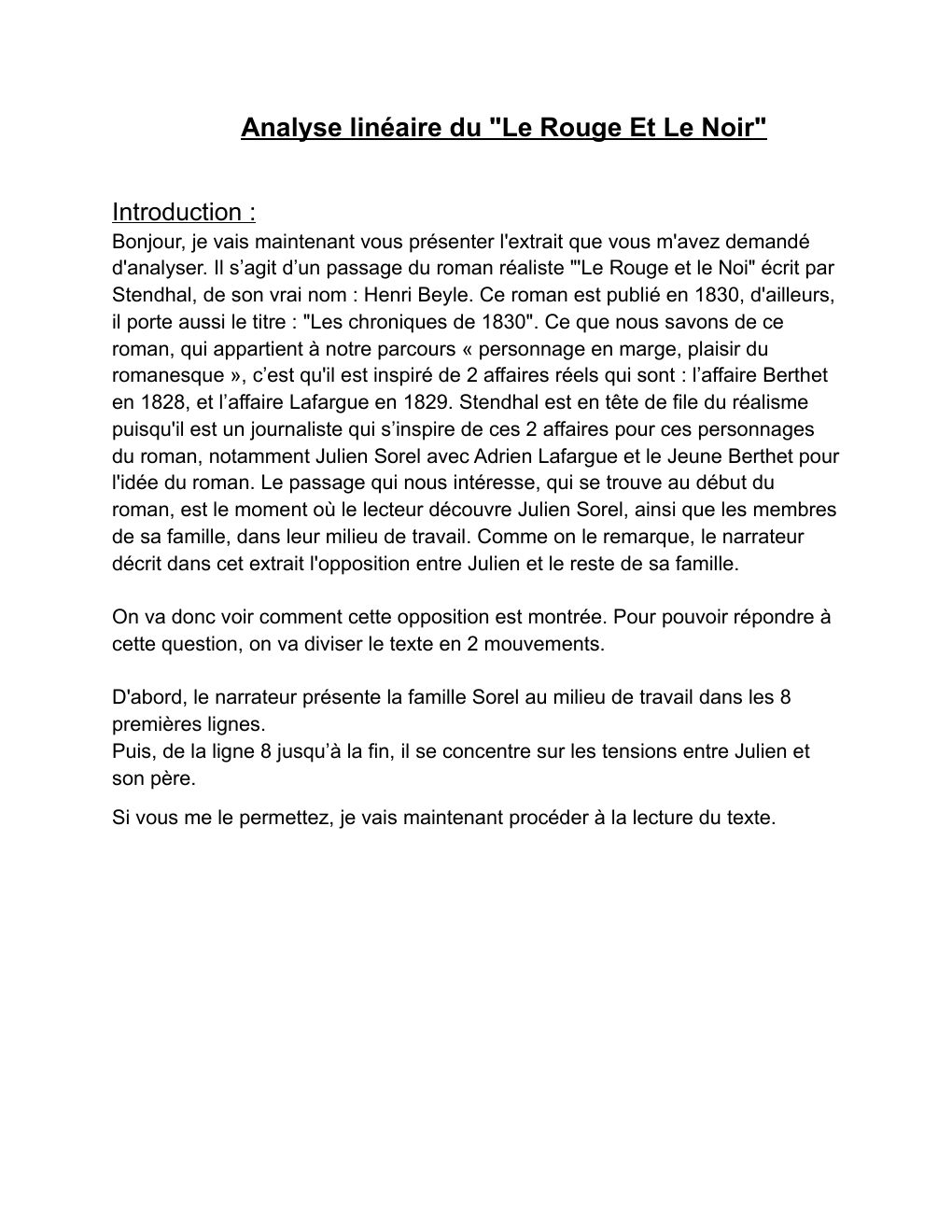Analyse linéaire du "Le Rouge Et Le Noir"
Publié le 05/04/2024
Extrait du document
«
Analyse linéaire du "Le Rouge Et Le Noir"
Introduction :
Bonjour, je vais maintenant vous présenter l'extrait que vous m'avez demandé
d'analyser.
Il s’agit d’un passage du roman réaliste "'Le Rouge et le Noi" écrit par
Stendhal, de son vrai nom : Henri Beyle.
Ce roman est publié en 1830, d'ailleurs,
il porte aussi le titre : "Les chroniques de 1830".
Ce que nous savons de ce
roman, qui appartient à notre parcours « personnage en marge, plaisir du
romanesque », c’est qu'il est inspiré de 2 affaires réels qui sont : l’affaire Berthet
en 1828, et l’affaire Lafargue en 1829.
Stendhal est en tête de file du réalisme
puisqu'il est un journaliste qui s’inspire de ces 2 affaires pour ces personnages
du roman, notamment Julien Sorel avec Adrien Lafargue et le Jeune Berthet pour
l'idée du roman.
Le passage qui nous intéresse, qui se trouve au début du
roman, est le moment où le lecteur découvre Julien Sorel, ainsi que les membres
de sa famille, dans leur milieu de travail.
Comme on le remarque, le narrateur
décrit dans cet extrait l'opposition entre Julien et le reste de sa famille.
On va donc voir comment cette opposition est montrée.
Pour pouvoir répondre à
cette question, on va diviser le texte en 2 mouvements.
D'abord, le narrateur présente la famille Sorel au milieu de travail dans les 8
premières lignes.
Puis, de la ligne 8 jusqu’à la fin, il se concentre sur les tensions entre Julien et
son père.
Si vous me le permettez, je vais maintenant procéder à la lecture du texte.
LECTURE
En approchant de son usine, le père Sorel appela Julien de sa voix de stentor ;
personne ne répondit.
Il ne vit que ses fils aînés, espèce de géants qui, armés de
lourdes haches, équarrissaient les troncs de sapin, qu’ils allaient porter à la scie.
Tout occupés à suivre exactement la marque noire tracée sur la pièce de bois,
chaque coup de leur hache en séparait des copeaux énormes.
Ils n’entendirent
pas la voix de leur père.
Celui-ci se dirigea vers le hangar ; en y entrant, il
chercha vainement Julien à la place qu’il aurait dû occuper, à côté de la scie.
Il
l’aperçut à cinq ou six pieds plus haut, à cheval sur l’une des pièces de la toiture.
Au lieu de surveiller attentivement l’action de tout le mécanisme, Julien lisait.
Rien n’était plus antipathique au vieux Sorel ; il eût peut-être pardonné à Julien
sa taille mince, peu propre aux travaux de force, et si différente de celle de ses
aînés ; mais cette manie de lecture lui était odieuse : il ne savait pas lire luimême.
Ce fut en vain qu’il appela Julien deux ou trois fois.
L’attention que le jeune
homme donnait à son livre, bien plus que le bruit de la scie, l’empêcha
d’entendre la terrible voix de son père.
Enfin, malgré son âge, celui-ci sauta
lestement sur l’arbre soumis à l’action de la scie, et de là sur la poutre
transversale qui soutenait le toit.
Un coup violent fit voler dans le ruisseau le livre
que tenait Julien ; un second coup aussi violent, donné sur la tête, en forme de
calotte, lui fit perdre l’équilibre.
Il allait tomber à douze ou quinze pieds plus bas,
au milieu des leviers de la machine en action, qui l’eussent brisé, mais son père
le retint de la main gauche, comme il tombait :
– Eh bien, paresseux ! tu liras donc toujours tes maudits livres, pendant que tu
es de garde à la scie ? Lis-les le soir, quand tu vas perdre ton temps chez le
curé, à la bonne heure.
Julien, quoiqu’étourdi par la force du coup, et tout sanglant, se rapprocha de son
poste officiel, à côté de la scie.
Il avait les larmes aux yeux, moins à cause de la
douleur physique, que pour la perte de son livre qu’il adorait.
Développement :
Je vais commencer par examiner le premier mouvement qui nous permet de
découvrir la Famille Sorel.
On voit la famille à travers les yeux du père Sorel.
Le narrateur utilise le point de
vue du père pour nous montrer ce qui se passe.
En suivant les actions du père,
on remarque qu'il est à la recherche de son fils, comme le montrent les verbes
d'actions " appela", "vit", "chercha” et "l'aperçut".
On parle donc de la théâtralisation dans cet extrait, puisque le narrateur met en
scène l'apparition du Julien, cela attire l’attention du lecteur, en commençant par
décrire le père et les frères du Julien.
La métaphore "voix de stentor" utilisée pour décrire le père donne l’image d’un
homme fort et puissant.
Cette idée de force est également présente dans la
description des frères avec la métaphore "espèces de géants".
Le vocabulaire lié
à leur activité renforce cette impression de puissance : ils ont des " lourdes
haches" et produisent des " copeaux énormes".
Les adjectifs " lourdes" et "
énormes" évoquent une force herculéenne dans la manipulation de ces objets.
Cependant, cette présentation des frères s'accompagne d'une certaine
déshumanisation ; ils ne sont pas identifiés par leur vrai nom ni leur nombre,
mais plutôt par une expression générique "fils ainés".
De même, ils sont
complètement absorbés par leur travail physique, ils....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Analyse lineaire le rouge et le noir exipit
- Linéaire Le Rouge et le Noir - Partie 2- Chapitre 4
- Lecture linéaire le rouge et le noir, livre 1 chapitre 6
- ROUGE ET LE NOIR (Le) de Stendhal (résumé et analyse)
- Le Rouge et le Noir Incipit Analyse