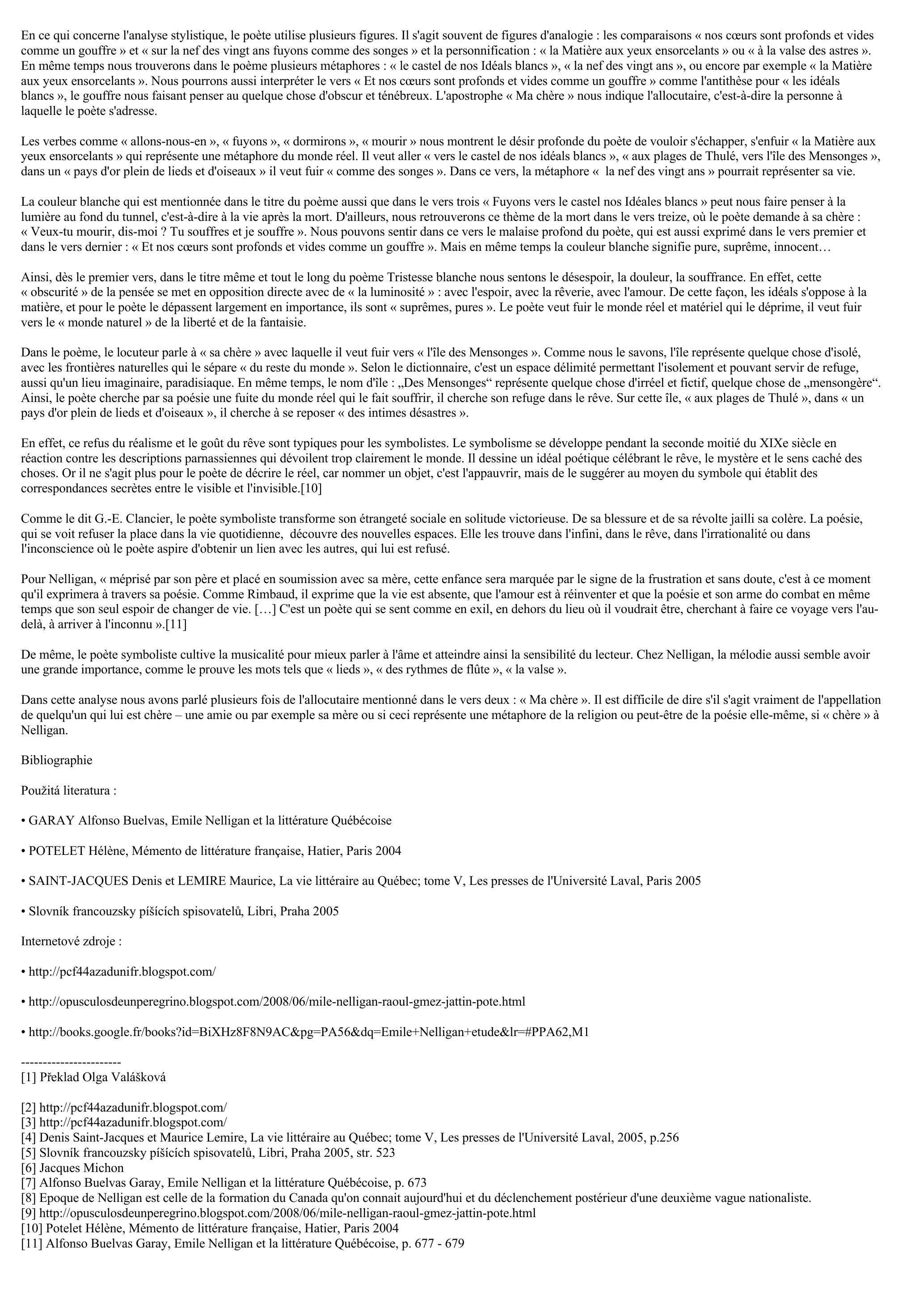Analyse du poéme d'Émile Nelligan : Tristestesse blanche
Publié le 19/07/2012
Extrait du document
Comme le dit G.-E. Clancier, le poète symboliste transforme son étrangeté sociale en solitude victorieuse. De sa blessure et de sa révolte jailli sa colère. La poésie, qui se voit refuser la place dans la vie quotidienne, découvre des nouvelles espaces. Elle les trouve dans l'infini, dans le rêve, dans l'irrationalité ou dans l'inconscience où le poète aspire d'obtenir un lien avec les autres, qui lui est refusé. Pour Nelligan, « méprisé par son père et placé en soumission avec sa mère, cette enfance sera marquée par le signe de la frustration et sans doute, c'est à ce moment qu'il exprimera à travers sa poésie. Comme Rimbaud, il exprime que la vie est absente, que l'amour est à réinventer et que la poésie et son arme do combat en même temps que son seul espoir de changer de vie. […] C'est un poète qui se sent comme en exil, en dehors du lieu où il voudrait être, cherchant à faire ce voyage vers l'au-delà, à arriver à l'inconnu «.[11]
«
En ce qui concerne l'analyse stylistique, le poète utilise plusieurs figures.
Il s'agit souvent de figures d'analogie : les comparaisons « nos cœurs sont profonds et videscomme un gouffre » et « sur la nef des vingt ans fuyons comme des songes » et la personnification : « la Matière aux yeux ensorcelants » ou « à la valse des astres ».En même temps nous trouverons dans le poème plusieurs métaphores : « le castel de nos Idéals blancs », « la nef des vingt ans », ou encore par exemple « la Matièreaux yeux ensorcelants ».
Nous pourrons aussi interpréter le vers « Et nos cœurs sont profonds et vides comme un gouffre » comme l'antithèse pour « les idéalsblancs », le gouffre nous faisant penser au quelque chose d'obscur et ténébreux.
L'apostrophe « Ma chère » nous indique l'allocutaire, c'est-à-dire la personne àlaquelle le poète s'adresse.
Les verbes comme « allons-nous-en », « fuyons », « dormirons », « mourir » nous montrent le désir profonde du poète de vouloir s'échapper, s'enfuir « la Matière auxyeux ensorcelants » qui représente une métaphore du monde réel.
Il veut aller « vers le castel de nos idéals blancs », « aux plages de Thulé, vers l'île des Mensonges »,dans un « pays d'or plein de lieds et d'oiseaux » il veut fuir « comme des songes ».
Dans ce vers, la métaphore « la nef des vingt ans » pourrait représenter sa vie.
La couleur blanche qui est mentionnée dans le titre du poème aussi que dans le vers trois « Fuyons vers le castel nos Idéales blancs » peut nous faire penser à lalumière au fond du tunnel, c'est-à-dire à la vie après la mort.
D'ailleurs, nous retrouverons ce thème de la mort dans le vers treize, où le poète demande à sa chère :« Veux-tu mourir, dis-moi ? Tu souffres et je souffre ».
Nous pouvons sentir dans ce vers le malaise profond du poète, qui est aussi exprimé dans le vers premier etdans le vers dernier : « Et nos cœurs sont profonds et vides comme un gouffre ».
Mais en même temps la couleur blanche signifie pure, suprême, innocent…
Ainsi, dès le premier vers, dans le titre même et tout le long du poème Tristesse blanche nous sentons le désespoir, la douleur, la souffrance.
En effet, cette« obscurité » de la pensée se met en opposition directe avec de « la luminosité » : avec l'espoir, avec la rêverie, avec l'amour.
De cette façon, les idéals s'oppose à lamatière, et pour le poète le dépassent largement en importance, ils sont « suprêmes, pures ».
Le poète veut fuir le monde réel et matériel qui le déprime, il veut fuirvers le « monde naturel » de la liberté et de la fantaisie.
Dans le poème, le locuteur parle à « sa chère » avec laquelle il veut fuir vers « l'île des Mensonges ».
Comme nous le savons, l'île représente quelque chose d'isolé,avec les frontières naturelles qui le sépare « du reste du monde ».
Selon le dictionnaire, c'est un espace délimité permettant l'isolement et pouvant servir de refuge,aussi qu'un lieu imaginaire, paradisiaque.
En même temps, le nom d'île : „Des Mensonges“ représente quelque chose d'irréel et fictif, quelque chose de „mensongère“.Ainsi, le poète cherche par sa poésie une fuite du monde réel qui le fait souffrir, il cherche son refuge dans le rêve.
Sur cette île, « aux plages de Thulé », dans « unpays d'or plein de lieds et d'oiseaux », il cherche à se reposer « des intimes désastres ».
En effet, ce refus du réalisme et le goût du rêve sont typiques pour les symbolistes.
Le symbolisme se développe pendant la seconde moitié du XIXe siècle enréaction contre les descriptions parnassiennes qui dévoilent trop clairement le monde.
Il dessine un idéal poétique célébrant le rêve, le mystère et le sens caché deschoses.
Or il ne s'agit plus pour le poète de décrire le réel, car nommer un objet, c'est l'appauvrir, mais de le suggérer au moyen du symbole qui établit descorrespondances secrètes entre le visible et l'invisible.[10]
Comme le dit G.-E.
Clancier, le poète symboliste transforme son étrangeté sociale en solitude victorieuse.
De sa blessure et de sa révolte jailli sa colère.
La poésie,qui se voit refuser la place dans la vie quotidienne, découvre des nouvelles espaces.
Elle les trouve dans l'infini, dans le rêve, dans l'irrationalité ou dansl'inconscience où le poète aspire d'obtenir un lien avec les autres, qui lui est refusé.
Pour Nelligan, « méprisé par son père et placé en soumission avec sa mère, cette enfance sera marquée par le signe de la frustration et sans doute, c'est à ce momentqu'il exprimera à travers sa poésie.
Comme Rimbaud, il exprime que la vie est absente, que l'amour est à réinventer et que la poésie et son arme do combat en mêmetemps que son seul espoir de changer de vie.
[…] C'est un poète qui se sent comme en exil, en dehors du lieu où il voudrait être, cherchant à faire ce voyage vers l'au-delà, à arriver à l'inconnu ».[11]
De même, le poète symboliste cultive la musicalité pour mieux parler à l'âme et atteindre ainsi la sensibilité du lecteur.
Chez Nelligan, la mélodie aussi semble avoirune grande importance, comme le prouve les mots tels que « lieds », « des rythmes de flûte », « la valse ».
Dans cette analyse nous avons parlé plusieurs fois de l'allocutaire mentionné dans le vers deux : « Ma chère ».
Il est difficile de dire s'il s'agit vraiment de l'appellationde quelqu'un qui lui est chère – une amie ou par exemple sa mère ou si ceci représente une métaphore de la religion ou peut-être de la poésie elle-même, si « chère » àNelligan.
Bibliographie
Použitá literatura :
• GARAY Alfonso Buelvas, Emile Nelligan et la littérature Québécoise
• POTELET Hélène, Mémento de littérature française, Hatier, Paris 2004
• SAINT-JACQUES Denis et LEMIRE Maurice, La vie littéraire au Québec; tome V, Les presses de l'Université Laval, Paris 2005
• Slovník francouzsky píšících spisovatelů, Libri, Praha 2005
Internetové zdroje :
• http://pcf44azadunifr.blogspot.com/
• http://opusculosdeunperegrino.blogspot.com/2008/06/mile-nelligan-raoul-gmez-jattin-pote.html
• http://books.google.fr/books?id=BiXHz8F8N9AC&pg=PA56&dq=Emile+Nelligan+etude&lr=#PPA62,M1
-----------------------[1] P řeklad Olga Valášková
[2] http://pcf44azadunifr.blogspot.com/[3] http://pcf44azadunifr.blogspot.com/[4] Denis Saint-Jacques et Maurice Lemire, La vie littéraire au Québec; tome V, Les presses de l'Université Laval, 2005, p.256[5] Slovník francouzsky píšících spisovatel ů, Libri, Praha 2005, str.
523[6] Jacques Michon[7] Alfonso Buelvas Garay, Emile Nelligan et la littérature Québécoise, p.
673[8] Epoque de Nelligan est celle de la formation du Canada qu'on connait aujourd'hui et du déclenchement postérieur d'une deuxième vague nationaliste.[9] http://opusculosdeunperegrino.blogspot.com/2008/06/mile-nelligan-raoul-gmez-jattin-pote.html[10] Potelet Hélène, Mémento de littérature française, Hatier, Paris 2004[11] Alfonso Buelvas Garay, Emile Nelligan et la littérature Québécoise, p.
677 - 679.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- FORTUNE DES ROUGON (La) d'Émile ZOLA (résumé & analyse)
- SUICIDE (LE), 1897. Émile Durkheim (résumé & analyse)
- NANA d'Émile Zola (résumé & analyse)
- VILLES TENTACULAIRES (les) d'Émile Verhaeren (résumé & analyse)
- Germinal. Roman d'Émile Zola (analyse détaillée)