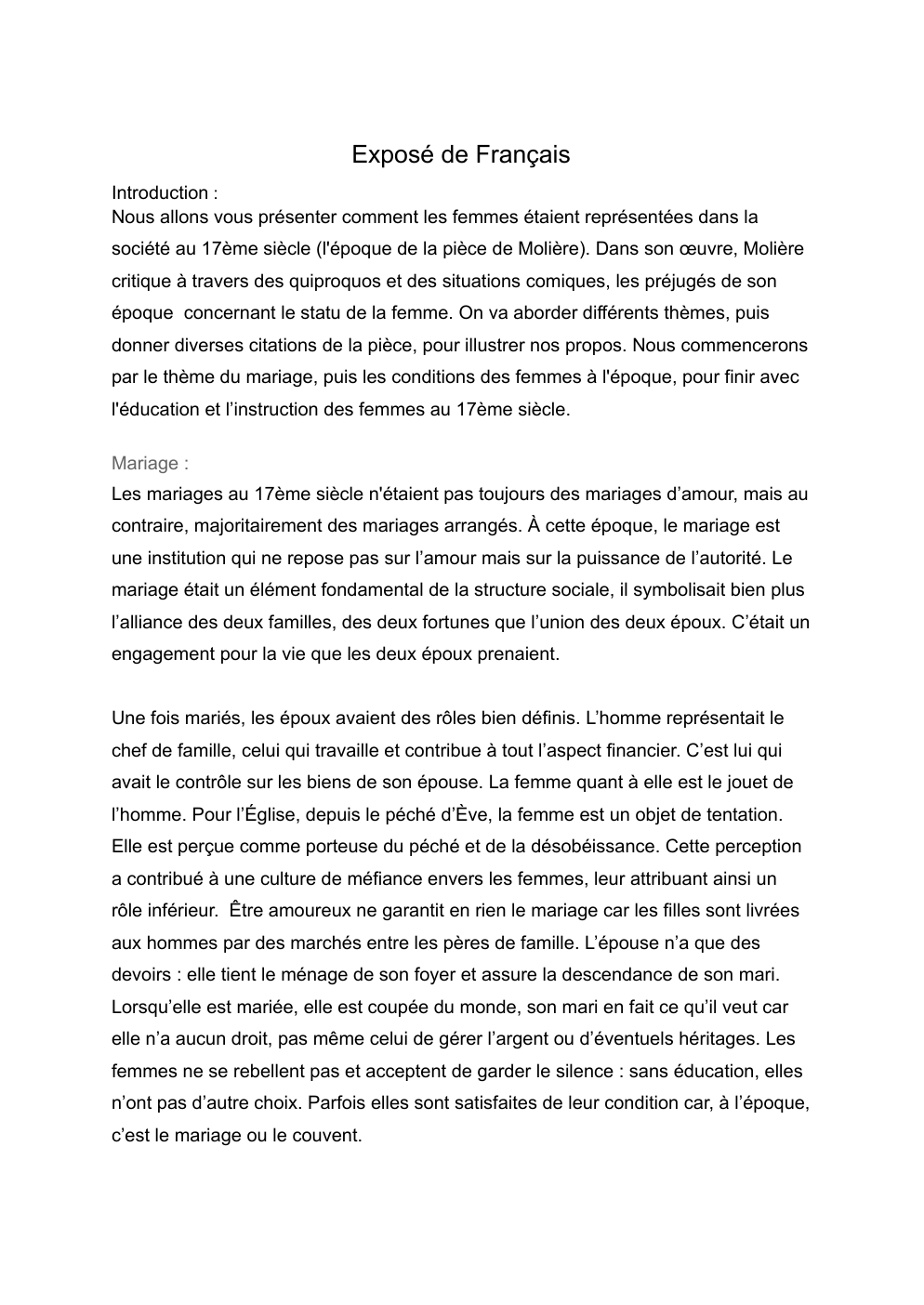Analyse conditions des femmes, leurs éduations et le mariage, dans lécole des femmes
Publié le 25/03/2025
Extrait du document
«
Exposé de Français
Introduction :
Nous allons vous présenter comment les femmes étaient représentées dans la
société au 17ème siècle (l'époque de la pièce de Molière).
Dans son œuvre, Molière
critique à travers des quiproquos et des situations comiques, les préjugés de son
époque concernant le statu de la femme.
On va aborder différents thèmes, puis
donner diverses citations de la pièce, pour illustrer nos propos.
Nous commencerons
par le thème du mariage, puis les conditions des femmes à l'époque, pour finir avec
l'éducation et l’instruction des femmes au 17ème siècle.
Mariage :
Les mariages au 17ème siècle n'étaient pas toujours des mariages d’amour, mais au
contraire, majoritairement des mariages arrangés.
À cette époque, le mariage est
une institution qui ne repose pas sur l’amour mais sur la puissance de l’autorité.
Le
mariage était un élément fondamental de la structure sociale, il symbolisait bien plus
l’alliance des deux familles, des deux fortunes que l’union des deux époux.
C’était un
engagement pour la vie que les deux époux prenaient.
Une fois mariés, les époux avaient des rôles bien définis.
L’homme représentait le
chef de famille, celui qui travaille et contribue à tout l’aspect financier.
C’est lui qui
avait le contrôle sur les biens de son épouse.
La femme quant à elle est le jouet de
l’homme.
Pour l’Église, depuis le péché d’Ève, la femme est un objet de tentation.
Elle est perçue comme porteuse du péché et de la désobéissance.
Cette perception
a contribué à une culture de méfiance envers les femmes, leur attribuant ainsi un
rôle inférieur.
Être amoureux ne garantit en rien le mariage car les filles sont livrées
aux hommes par des marchés entre les pères de famille.
L’épouse n’a que des
devoirs : elle tient le ménage de son foyer et assure la descendance de son mari.
Lorsqu’elle est mariée, elle est coupée du monde, son mari en fait ce qu’il veut car
elle n’a aucun droit, pas même celui de gérer l’argent ou d’éventuels héritages.
Les
femmes ne se rebellent pas et acceptent de garder le silence : sans éducation, elles
n’ont pas d’autre choix.
Parfois elles sont satisfaites de leur condition car, à l’époque,
c’est le mariage ou le couvent.
Dans les pays catholiques, le mariage était un sacrement, et le divorce était très mal
vu, voire impossible.
Dans l’école des femmes, Molière s’interroge sur la place des femmes et met en
lumière les hypocrisies liées au mariage.
Il aborde ce sujet à travers des rôles et une
approche critique.
On y retrouve Arnolphe, un homme adulte, qui a élevé Agnès, une
jeune fille innocente afin de la rendre totalement soumise, ignorante et d’en faire son
épouse dans les années à venir.
Arnolphe pense que pour avoir une épouse
vertueuse, il doit la garder dans l’ignorance.
Molière utilise l’humour et la comédie
pour critiquer les normes sociétales de son époque.
Il relève l’absurdité de certaines
conventions liées au mariage.
Molière va aussi mettre l’accent sur l’importance de la
communication, qui est souvent absente lors de mariages arrangés.
Dans la scène 2, Arnolphe fait une description du mariage à Agnès.
Il lui déclare
dans cette scène qu'il veut prendre sa main.
Il met en évidence sa supériorité sociale
et la chance qui s’offre à elle, la chance de pouvoir à son échelle de “pauvre
villageoise“ vers 684, monter au rang d’honorable bourgeoise.
Il représente le
mariage comme un devoir, un engagement et il met surtout l’accent sur l’inégalité
évidente entre les deux amants.
En effet, du vers (702-704), Arnolphe apprend à
Agnès cette soumission qu’elle devra naturellement vivre en temps que femme.
Le
terme "mariage" est amplifié au vers (695) et associé à "d'austères devoirs", repris
au vers (714) : "Son devoir aussitôt est de baisser les yeux".
Le mariage n'est donc
qu'un ensemble de contraintes pour l'épouse.
Pour appuyer cette conception,
Arnolphe fait appel à l'éducation religieuse reçue par Agnès au couvent.
Les jeunes
séducteurs deviennent donc des incarnations du diable et manquer à un "devoir" est
un péché qui sera puni comme tel.
Une vision de l'Enfer destinée à faire peur à la
future épouse vers (727-728).
Il veut à tout pris l’éloigner, la distinguer, de cette
image de la femme qui lui fait peur.
Cette peur de la féminité indépendante et de la
liberté des femmes provoque de la haine chez Arnolphe qui en vient même à
menacer Agnès (vers 733-777).
Tout le discours de l’acte lll scène 2, vise à rabaisser la femme à l'état d'esclave,
comme le montrent les négations : "Votre sexe n'est là que..." ; elle est réduite à
l'état de "moitié" et voir complètement négligée.
Après ces explications, Arnolphe présente à Agnès, les maximes du mariage: une
série de devoir que la femme marié doit exercer.
Conditions des femmes à l'époque (statu de la femme et juridique social) :
Le statut juridique de la femme était marqué par des lois et des traditions
patriarcales qui la plaçaient sous la dépendance des hommes, avec une place
restreinte dans la société, principalement en raison de normes patriarcales.
Les
femmes étaient, pour la plupart, sous la tutelle légale d'un homme toute leur vie, qu'il
s'agisse de leur père ou de leur mari.
En comparaison avec la pièce, Agnès est
placée sous la tutelle d’Arnolphe, elle est entièrement soumise à son autorité de
tuteur, qui prévoit de l'épouser.
Les femmes mariées avaient un accès restreint à la propriété.
Comme nous l’avons
dit plus haut, leur mari gérait les biens du couple, et assurait la gestion économique.
Les femmes célibataires et les veuves avaient davantage de liberté en matière de
gestion de leurs biens, mais restaient souvent soumises à des conseils masculins.
Dans les affaires judiciaires, les femmes avaient peu de droits.
Elles ne pouvaient
pas agir seules en justice sans l’autorisation de leur mari ou d'un tuteur, et leurs
témoignages pouvaient être considérés comme moins crédibles.
Dans le cadre
social et politique, les femmes étaient exclues des lieux de pouvoir (gouvernements,
universités, ordres professionnels).
Lorsqu’Agnès rencontre Horace, elle commence à entrevoir la possibilité d’un amour
fondé sur le choix et l’égalité.....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- l'école des femmes analyse acte II scène 5
- Le Mariage de Figaro (résumé & analyse) de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais
- FEMMES de SOLLERS (résumé & analyse)
- ÉCOLE DES FEMMES (L’) Molière (résumé & analyse)
- QUINZE JOIES DE MARIAGE (les) (résumé & analyse)