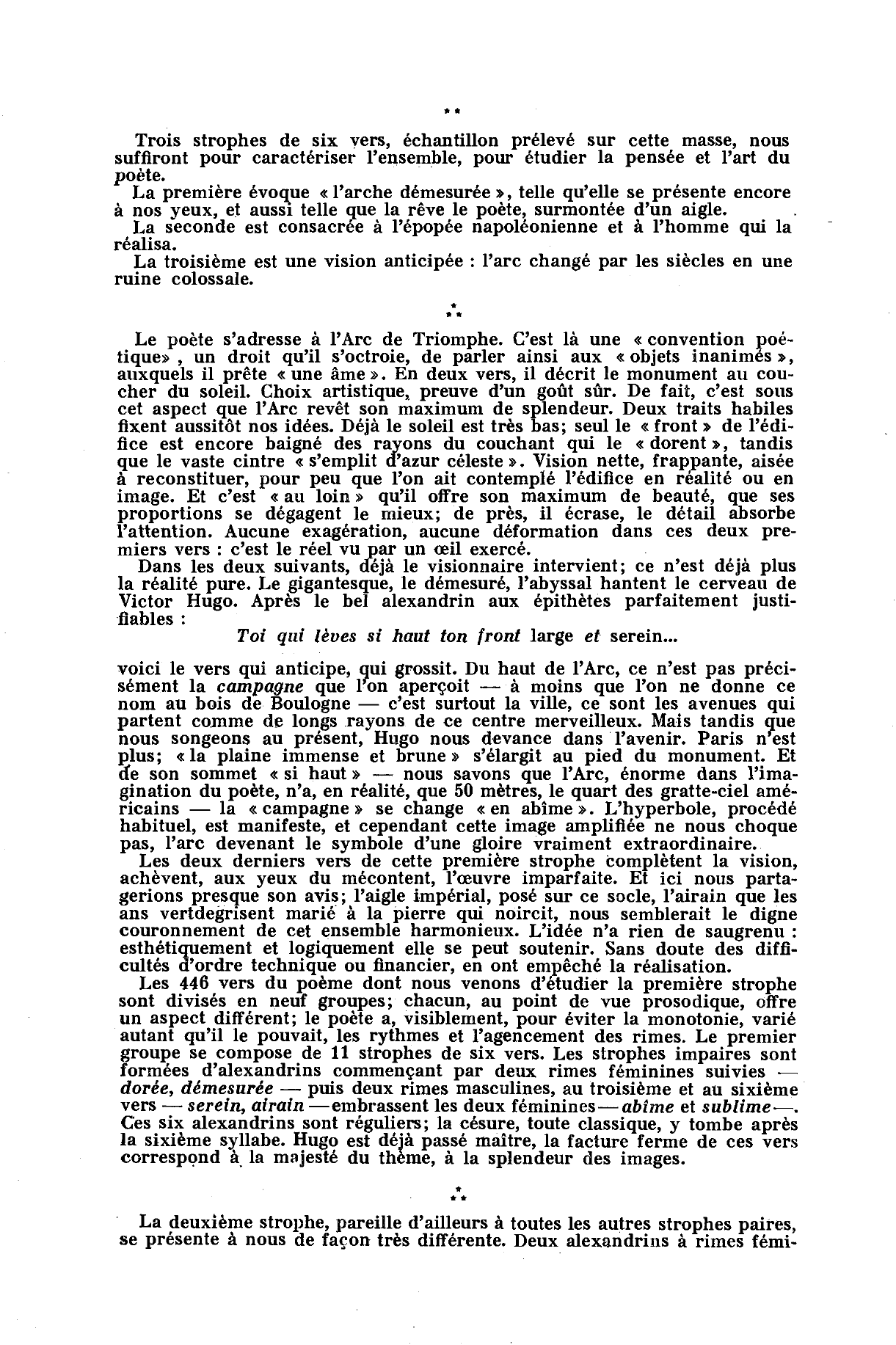A l'Arc de Triomphe. Hugo. Les Voix intérieures. commentaire
Publié le 14/02/2012

Extrait du document
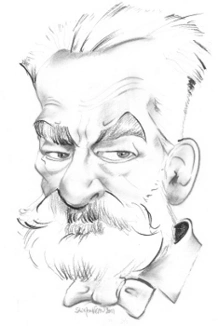
I Toi dont la courbe au loin, par le couchant dorée, S'emplit d'azur céleste, arche démesurée; Toi qui lèves si haut ton front large et serein, Fait pour changer sous lui la campagne en abîme, Et pour servir de base à quelque aigle sublime Qui viendra s'y poser et qui sera d'airain ! O vaste entassement ciselé par l'histoire ! Monceau de pierre assis sur un monceau de gloire ! Edifice inouï ! Toi que l'homme par qui notre siècle commence, De loin, dans les rayons de l'avenir immense, Voyait, tout ébloui ! Non, tu n'es pas fini quoique tu sois superbe ! Non ! puisque aucun passant, dans l'ombre assis sur l'herbe, Tandis que triviale, errante et vagabonde, Entre tes quatre pieds toute la ville abonde Comme une fourmilière aux pieds d'un éléphant ! A ta beauté royale il manque quelque chose. Les siècles vont venir pour ton apothéose Qui te l'apporteront. Il manque sur ta tête un sombre amas d'années Qui pendent pêle-mêle et toutes ruinées Aux brèches de ton front !
La préface explique la dédicace. L'auteur, placé entre «le trophée de l'Etoile« et «le tombeau de son père«, mort en 1828, accomplit un devoir; «sans bruit, sans colère, sans étonnement «. Il demande, ni plus ni moins, que le nom de son père, général des armées impériales, soit ajouté aux 386 noms des généraux de la Révolution et de l'Empire, gravés sur l'édifice. Le quatrième morceau du recueil, A l'Arc de Triomphe, se termine par ces vers:
Je ne regrette rien, devant ton mur sublime, Que Phidias absent et mon père oublié.
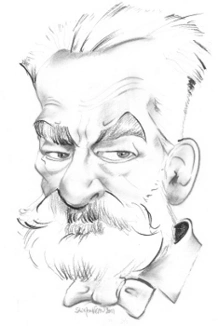
«
Trois strophes de six vers, echantillon preleve sur cette masse, nous
suffiront pour caracteriser rensemble, pour etudier la pensee et l'art du
poete.
La premiere &vogue < l'arche demesuree telle qu'elle se presente encore
A nos yeux, et aussi telle que la rave le poke, surmontee d'un aigle.
La seconde est consacree a l'epopee napoleonienne et a l'homme qui la
realis a.
La troisieme est une vision anticipee : l'arc change par les siecles en une
ruine colossale.
Le poete s'adresse a l'Arc de Triomphe.
C'est la une e convention poe-
tique , un droit qu'il s'octroie, de parley ainsi aux e objets inanimes »,
auxquels it prate e une ame En deux vers, it (Merit le monument au cou-
cher du soleil.
Choix artistique, preuve d'un goat stir.
De fait, c'est sous
cet aspect que l'Arc revet son maximum de splendeur.
Deux traits habiles
fixent aussitot nos idees.
Deja le soleil est fres bas; seul le e front xo de 'Wi-
nce est encore baigne des rayons du couchant qui le « dorenttandis
que le vaste cintre re s'emplit d'azur celeste Vision nette, frappante, aisee
a reconstituer, pour peu que l'on ait contemple ''edifice en realite ou en
image.
Et c'est re au loin »qu'il offre son maximum de beaute, que ses
proportions se degagent le mieux; de pros, it &rase, le detail absorbe
''attention.
Aucune exageration, aucune deformation dans ces deux pre-
miers vers : c'est le reel vu par un cell exerce.
Dans les deux suivants, déjà le visionnaire intervient; ce n'est déjà plus
la realite pure.
Le gigantesque, le demesure, l'abyssal hantent le cerveau de
Victor Hugo.
Apres le bel alexandrin aux epithetes parfaitement justi-
fiables : Toi qui Miles si haut ton front large et serein...
voici le vers qui anticipe, qui grossit.
Du haut de l'Arc, ce n'est pas preci- sement la campagne que l'on apercoit - a moins que l'on ne donne ce
nom an bois de Boulogne - c'est surtout in vine, ce sont les avenues qui
partent comme de longs rayons de ce centre merveilleux.
Mais tandis que nous songeons au present, Hugo nous devance dans l'avenir.
Paris n'est
plus; « la plaine immense et brune » s'elargit an pied du monument.
Et
(le son sommet a si haut » - nous savons que l'Arc, enorme dans ''ima-
gination du poke, n'a, en realite, que 50 metres, le quart des gratte-ciel am&
ricains - la 1 campagne » se change e en abime ».
L'hyperbole, procede
habituel, est manifeste, et cependant cette image amplifiee ne nous choque
pas, l'arc devenant le symbole d'une gloire vraiment extraordinaire.
Les deux derniers vers de cette premiere strophe completent la vision,
achevent, aux yeux du mecontent, ''oeuvre imparfaite.
Et id nous parta-
gerions presque son avis; l'aigle imperial, pose sur ce socle, l'airain que les
ans vertdegrisent mule a la pierre qui noircit, nous semblerait le digne couronnement de cet ensemble harmonieux.
L'idee n'a rien de saugrenu
esthetiquement et logiquement elle se peut soutenir.
Sans doute des diffi-
cultes d'ordre technique ou financier, en ont empeche la realisation.
Les 446 vers du poeme dont nous venons d'etudier la premiere strophe
sont divises en neuf groupes; chacun, au point de vue prosodique, offre un aspect different; le poke a, visiblement, pour eviler la monotonie, varie
autant qu'il le pouvait, les rythmes et l'agencement des rimes.
Le premier
groupe se compose de 11 strophes de six vers.
Les strophes impairer sont
formees d'alexandrins commencant par deux rimes feminines suivies -
doree, demesuree - puis deux rimes masculines, au troisieme et au sixieme
vers - serein, airain -embrassent les deux feminines-abime et sublime-.
C'es six alexandrins sont reguliers; la cesure, toute classique, y tombe apres
la sixieme syllabe.
Hugo est déjà passé maitre, la facture ferme de ces vers
correspond a, la majeste du theme, a la splendeur des images.
La deuxieme strophe, pareille d'ailleurs a toutes les autres strophes paires,
se presente a nous de facon fres differente.
Deux alexandrins a rimes femi-
Trois strophes de six vers, échantillon prélevé sur cette masse, nous suffiront pour caractériser l'ensemble, pour étudier la pensée et l'art du poète.
La première évoque «l'arche démesurée~, telle qu'elle se présente encore à nos yeux, et aussi telle que la rêve le poète, surmontée d'un aigle.
La seconde est consacrée à l'épopée napoléonienne et à l'homme qui la réalisa.
La troisième est une vision anticipée : l'arc changé par les siècles en une ruine colossale.
.
..
Le poète s'adresse à l'Arc de Triomphe.
C'est là une « convention :poé tique~ , un droit qu'il s'octroie, de parler ainsi aux « objets inanimes », auxquels il prête « une âme ».
En deux vers, il décrit le monument au cou cher du soleil.
Choix artistique, preuve d'un goût sûr.
De fait, c'est sous cet aspect que l'Arc revêt son maximum de splendeur.
Deux traits habiles fixent aussitôt nos idées.
Déjà le soleil est très bas; seul le «front~ de l'édi fice est encore baigné des rayons du couchant qui le « dorent ~, tandis que le vaste cintre « s'emplit d'azur céleste ~.
Vision nette, frappante, aisée
à reconstituer, pour peu que l'on ait contemplé l'édifice en réalité ou en image.
Et c'est « au loin » qu'il offre son maximum de beauté, que ses proportions se dégagent le mieux; de près, il écrase, le détail absorbe l'attention.
Aucune exagération, aucune déformation dans ces deux pre miers vers : c'est le réel vu par un œil exercé.
Dans les deux suivants, déjà le visionnaire intervient; ce n'est déjà plus la réalité pure.
Le gigantesque, le démesuré, l'abyssal hantent le cerveau de Victor Hugo.
Après le bel alexandrin aux épithètes parfaitement justi
fiables :
Toi qui lèves si haut ton front large et serein ...
voici le vers qui anticipe, qui grossit.
Du haut de l'Arc, ce n'est pas preci sément la campagne que l'on aperçoit - à moins que l'on ne donne ce nom au bois de Boulogne - c'est surtout la ville, ce sont les avenues qui partent comme de longs rayons de ce centre merveilleux.
Mais tandis que nous songeons au présent, Hugo nous devance dans l'avenir.
Paris n'est plus; «la plaine immense et brune~ s'élargit au pied du monument.
Et ae son sommet « si haut » - nous savons que l'Arc, énorme dans l'ima gination du poète, n'a, en réalité, que 50 mètres, le quart des gratte-ciel amé ricains - la « campagne » se change « en abîme ~.
L'hyperbole, procédé habituel, est manifeste, et cependant cette image amplifiée ne nous choque pas, l'arc devenant le symbole d'une gloire vraiment extraordinaire.
Les deux derniers vers de cette première strophe complètent la vision, achèvent, aux yeux du mécontent, l'œuvre imparfaite.
Et ici nous parta gerions presque son avis; l'aigle impérial, posé sur ce socle, l'airain que les ans vertdegrisent marié à la pierre qui noircit, nous semblerait le digne couronnement de cet ensemble harmonieux.
L'idée n'a rien de saugrenu : esthétiquement et logiquement elle se peut soutenir.
Sans doute des diffi cultés d'ordre technique ou financier, en ont emJ?êché la réalisation.
Les 446 vers du poème dont nous venons d'etudier la première strophe sont divisés en neuf groupes; chacun, au point de vue prosodique, offre un aspect différent; le poète a, visiblement, pour éviter la monotonie, varié autant qu'il le pouvait, les rythmes et l'agencement des rimes.
Le premier groupe se compose de 11 strophes de six vers.
Les strophes impaires sont formées d'alexandrins commençant par deux rimes féminines suivies - dorée, démesurée - puis deux rimes masculines, au troisième et au sixième vers- serein, airain -embrassent les deux féminines-abîme et sublime-.
Ces six alexandrins sont réguliers; la césure, toute classique, y tombe après la sixième syllabe.
Hugo est déjà passé maître, la facture ferme de ces vers correspQnd à la majesté du thème, à la splendeur des images .
.
.
.
La deuxième strophe, pareille d'ailleurs à toutes les autres strophes paires, se présente à nous de façon très différente.
Deux alexandrins à rimes fémi-.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Voix INTÉRIEURES (les), de V. Hugo
- VOIX INTÉRIEURES (Les) de Victor Hugo : Fiche de lecture
- Les Voix intérieures de HUGO (Résumé & Analyse)
- Vous expliquerez cette phrase d'une lettre de Victor Hugo après la publication des Voix intérieures (1837) en l'appliquant soit à Victor Hugo seul, soit à d'autres écrivains, romantiques ou non : « Il vient une certaine heure dans la vie ou, l'horizon s'agrandissant sans cesse, un homme se sent trop petit pour continuer de parler en son nom. Il crée alors, poète, philosophe ou penseur, une figure dans laquelle il se personnifie ou s'incarne; c'est encore l'homme, ce n'est plus le moi.
- Commentaire de "Demain, des l'aube" de Victor Hugo