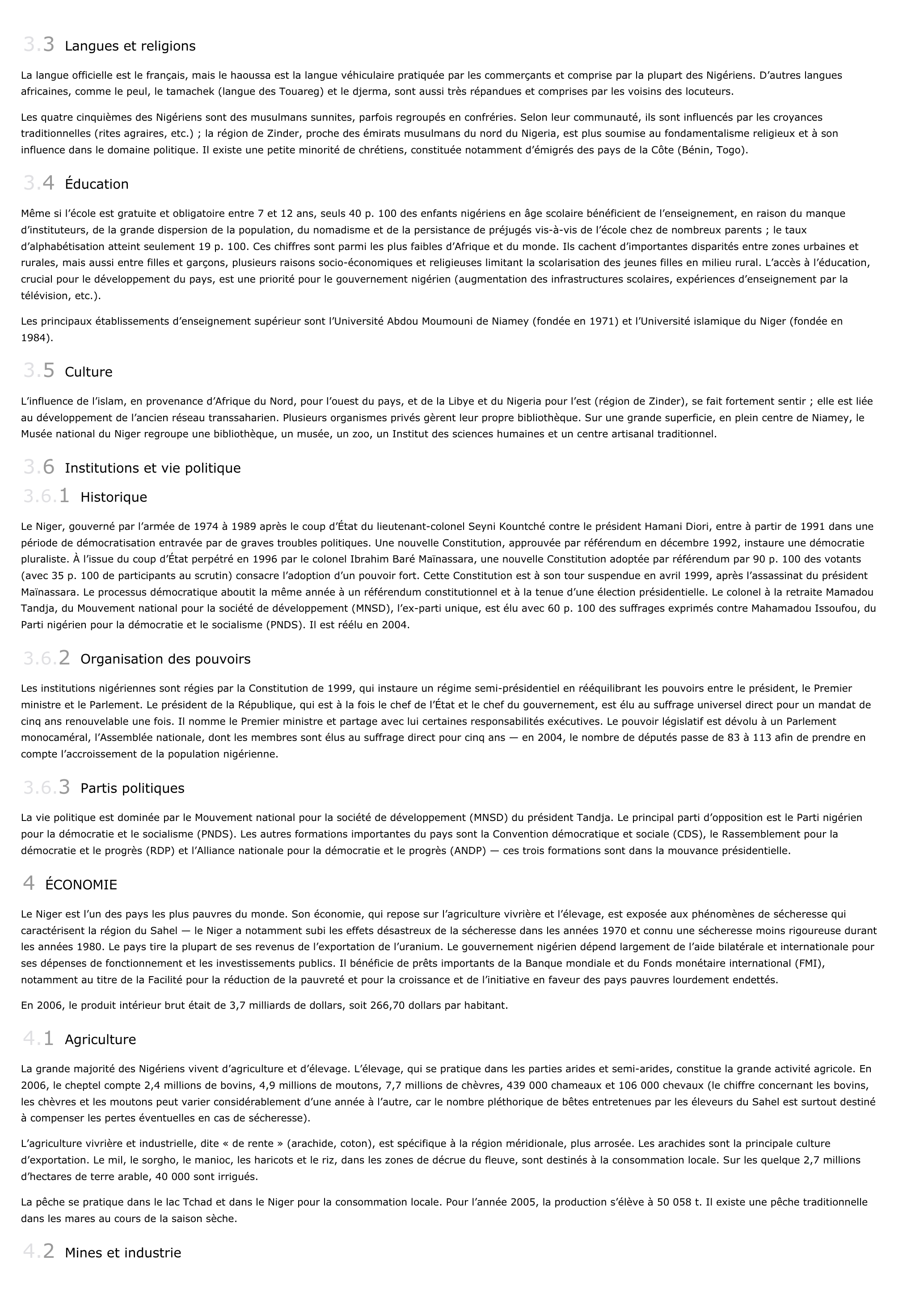Niger.
Publié le 15/04/2013
Extrait du document


«
3.3 Langues et religions
La langue officielle est le français, mais le haoussa est la langue véhiculaire pratiquée par les commerçants et comprise par la plupart des Nigériens.
D’autres languesafricaines, comme le peul, le tamachek (langue des Touareg) et le djerma, sont aussi très répandues et comprises par les voisins des locuteurs.
Les quatre cinquièmes des Nigériens sont des musulmans sunnites, parfois regroupés en confréries.
Selon leur communauté, ils sont influencés par les croyancestraditionnelles (rites agraires, etc.) ; la région de Zinder, proche des émirats musulmans du nord du Nigeria, est plus soumise au fondamentalisme religieux et à soninfluence dans le domaine politique.
Il existe une petite minorité de chrétiens, constituée notamment d’émigrés des pays de la Côte (Bénin, Togo).
3.4 Éducation
Même si l’école est gratuite et obligatoire entre 7 et 12 ans, seuls 40 p.
100 des enfants nigériens en âge scolaire bénéficient de l’enseignement, en raison du manqued’instituteurs, de la grande dispersion de la population, du nomadisme et de la persistance de préjugés vis-à-vis de l’école chez de nombreux parents ; le tauxd’alphabétisation atteint seulement 19 p.
100.
Ces chiffres sont parmi les plus faibles d’Afrique et du monde.
Ils cachent d’importantes disparités entre zones urbaines etrurales, mais aussi entre filles et garçons, plusieurs raisons socio-économiques et religieuses limitant la scolarisation des jeunes filles en milieu rural.
L’accès à l’éducation,crucial pour le développement du pays, est une priorité pour le gouvernement nigérien (augmentation des infrastructures scolaires, expériences d’enseignement par latélévision, etc.).
Les principaux établissements d’enseignement supérieur sont l’Université Abdou Moumouni de Niamey (fondée en 1971) et l’Université islamique du Niger (fondée en1984).
3.5 Culture
L’influence de l’islam, en provenance d’Afrique du Nord, pour l’ouest du pays, et de la Libye et du Nigeria pour l’est (région de Zinder), se fait fortement sentir ; elle est liéeau développement de l’ancien réseau transsaharien.
Plusieurs organismes privés gèrent leur propre bibliothèque.
Sur une grande superficie, en plein centre de Niamey, leMusée national du Niger regroupe une bibliothèque, un musée, un zoo, un Institut des sciences humaines et un centre artisanal traditionnel.
3.6 Institutions et vie politique
3.6. 1 Historique
Le Niger, gouverné par l’armée de 1974 à 1989 après le coup d’État du lieutenant-colonel Seyni Kountché contre le président Hamani Diori, entre à partir de 1991 dans unepériode de démocratisation entravée par de graves troubles politiques.
Une nouvelle Constitution, approuvée par référendum en décembre 1992, instaure une démocratiepluraliste.
À l’issue du coup d’État perpétré en 1996 par le colonel Ibrahim Baré Maïnassara, une nouvelle Constitution adoptée par référendum par 90 p.
100 des votants(avec 35 p.
100 de participants au scrutin) consacre l’adoption d’un pouvoir fort.
Cette Constitution est à son tour suspendue en avril 1999, après l’assassinat du présidentMaïnassara.
Le processus démocratique aboutit la même année à un référendum constitutionnel et à la tenue d’une élection présidentielle.
Le colonel à la retraite MamadouTandja, du Mouvement national pour la société de développement (MNSD), l’ex-parti unique, est élu avec 60 p.
100 des suffrages exprimés contre Mahamadou Issoufou, duParti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS).
Il est réélu en 2004.
3.6. 2 Organisation des pouvoirs
Les institutions nigériennes sont régies par la Constitution de 1999, qui instaure un régime semi-présidentiel en rééquilibrant les pouvoirs entre le président, le Premierministre et le Parlement.
Le président de la République, qui est à la fois le chef de l’État et le chef du gouvernement, est élu au suffrage universel direct pour un mandat decinq ans renouvelable une fois.
Il nomme le Premier ministre et partage avec lui certaines responsabilités exécutives.
Le pouvoir législatif est dévolu à un Parlementmonocaméral, l’Assemblée nationale, dont les membres sont élus au suffrage direct pour cinq ans — en 2004, le nombre de députés passe de 83 à 113 afin de prendre encompte l’accroissement de la population nigérienne.
3.6. 3 Partis politiques
La vie politique est dominée par le Mouvement national pour la société de développement (MNSD) du président Tandja.
Le principal parti d’opposition est le Parti nigérienpour la démocratie et le socialisme (PNDS).
Les autres formations importantes du pays sont la Convention démocratique et sociale (CDS), le Rassemblement pour ladémocratie et le progrès (RDP) et l’Alliance nationale pour la démocratie et le progrès (ANDP) — ces trois formations sont dans la mouvance présidentielle.
4 ÉCONOMIE
Le Niger est l’un des pays les plus pauvres du monde.
Son économie, qui repose sur l’agriculture vivrière et l’élevage, est exposée aux phénomènes de sécheresse quicaractérisent la région du Sahel — le Niger a notamment subi les effets désastreux de la sécheresse dans les années 1970 et connu une sécheresse moins rigoureuse durantles années 1980.
Le pays tire la plupart de ses revenus de l’exportation de l’uranium.
Le gouvernement nigérien dépend largement de l’aide bilatérale et internationale pourses dépenses de fonctionnement et les investissements publics.
Il bénéficie de prêts importants de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI),notamment au titre de la Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance et de l’initiative en faveur des pays pauvres lourdement endettés.
En 2006, le produit intérieur brut était de 3,7 milliards de dollars, soit 266,70 dollars par habitant.
4.1 Agriculture
La grande majorité des Nigériens vivent d’agriculture et d’élevage.
L’élevage, qui se pratique dans les parties arides et semi-arides, constitue la grande activité agricole.
En2006, le cheptel compte 2,4 millions de bovins, 4,9 millions de moutons, 7,7 millions de chèvres, 439 000 chameaux et 106 000 chevaux (le chiffre concernant les bovins,les chèvres et les moutons peut varier considérablement d’une année à l’autre, car le nombre pléthorique de bêtes entretenues par les éleveurs du Sahel est surtout destinéà compenser les pertes éventuelles en cas de sécheresse).
L’agriculture vivrière et industrielle, dite « de rente » (arachide, coton), est spécifique à la région méridionale, plus arrosée.
Les arachides sont la principale cultured’exportation.
Le mil, le sorgho, le manioc, les haricots et le riz, dans les zones de décrue du fleuve, sont destinés à la consommation locale.
Sur les quelque 2,7 millionsd’hectares de terre arable, 40 000 sont irrigués.
La pêche se pratique dans le lac Tchad et dans le Niger pour la consommation locale.
Pour l’année 2005, la production s’élève à 50 058 t.
Il existe une pêche traditionnelledans les mares au cours de la saison sèche.
4.2 Mines et industrie.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Niger tamquam corvus
- Jacques SAVARY des BRÛLONS (1657-1716) L'esclavage est un négoce où les hommes sont les marchands d'autres hommes Nègres : peuples d'Afrique, dont le pays a son étendue des deux côtés du fleuve Niger.
- Niger (« fleuve des Noirs »), grand fleuve d'Afrique occidentale, long de 4 200 km.
- Niger.
- Republik Niger - geographie.