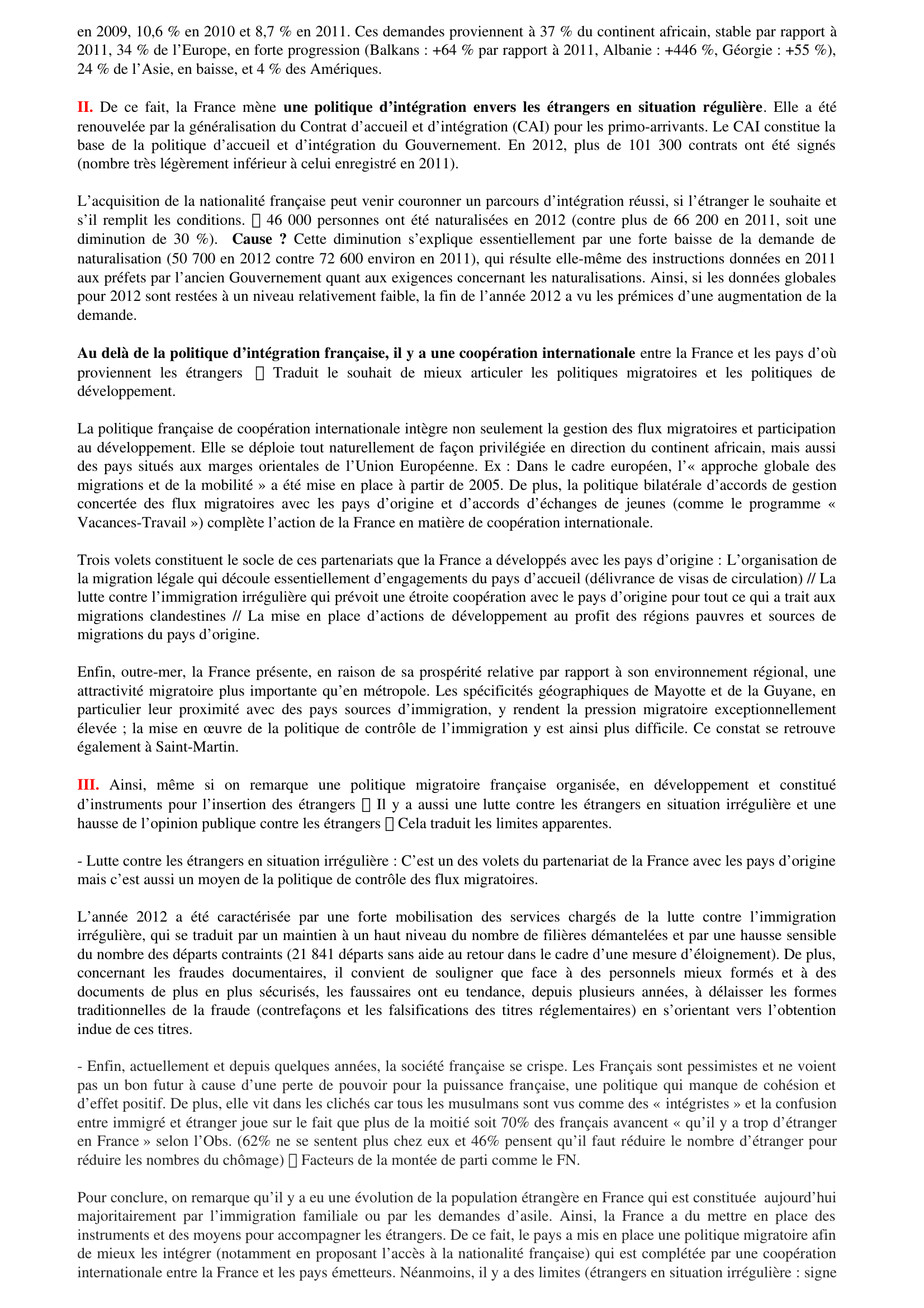Les étrangers en France aujourd’hui
Publié le 04/10/2015
Extrait du document
...
Les étrangers en France aujourd’hui
Dans la vie de tous les jours, on confond généralement un immigré et un étranger à Pourtant, ce n’est pas la même chose : Immigré à résidant en France, née étrangère à l’étranger. Peut avoir acquis la nationalité française une fois installée en France, mais elle reste immigrée. 40 % des immigrés sont français. // Etranger à vit en France mais qui n’a pas la nationalité française. En revanche, il peut être né en France : 15 % des étrangers sont dans ce cas. (13 ans, demande de nationalité parentale sinon à 16 ans de lui même).
Néanmoins, ces deux notions sont reliés car il faut qu’il y ait de l’immigration en provenance des autres pays que la France vers ce dernier pour que ces arrivants qui n’ont pas la nationalité française constituent les étrangers. De ce fait, on peut se demander : « Quel est la place des étrangers en France aujourd’hui ? «. Pour répondre à cette question, on traitera dans une 1ère partie …
I. L’évolution de la population étrangère en France, accompagnée par la mise en place de moyens et d’instruments juridiques
II. La politique d’intégration et d’accès à la nationalité française aidée par une coopération internationale
III. Néanmoins, on observe des limites car il y a le développement d’étrangers en situation irrégulière voire même un paradoxe car le gouvernement tend vers une insertion des étrangers alors que l’opinion publique tend vers un rejet de plus en plus prononcé
«
en 2009, 10,6 % en 2010 et 8,7 % en 2011. Ces demandes proviennent à 37 % du continent africain, stable par rapport à
2011, 34 % de l’Europe, en forte progression (Balkans : +64 % par rapport
à 2011, Albanie : +446 %, G éorgie : +55 %),
24 % de l’Asie, en baisse, et 4 % des Am
ériques.
II.
De ce fait, la France m
ène une politique d’int égration envers les étrangers en situation r éguli ère .
Elle a été
renouvel
ée par la g énéralisation du Contrat d’accueil et d’int égration (CAI) pour les primoarrivants. Le CAI constitue la
base de la politique d’accueil et d’int
égration du Gouvernement.
En 2012, plus de 101 300 contrats ont été sign és
(nombre tr
ès légèrement inf érieur à celui enregistr é en 2011).
L’acquisition de la nationalit
é fran çaise peut venir couronner un parcours d’int égration r éussi, si l’ étranger le souhaite et
s’il remplit les conditions.
46 000 personnes ont
été naturalis ées en 2012 (contre plus de 66 200 en 2011, soit une
diminution de 30 %).
Cause ? Cette diminution s’explique essentiellement par une forte baisse de la demande de
naturalisation (50 700 en 2012 contre 72 600 environ en 2011), qui r
ésulte ellem ême des instructions donn ées en 2011
aux pr
éfets par l’ancien Gouvernement quant aux exigences concernant les naturalisations. Ainsi, si les donn ées globales
pour 2012 sont rest
ées à un niveau relativement faible, la fin de l’ann ée 2012 a vu les pr émices d’une augmentation de la
demande.
Au del
à de la politique d’int égration fran çaise, il y a une coop ération internationale entre la France et les pays d’o ù
proviennent les
étrangers Traduit le souhait de mieux articuler les politiques migratoires et les politiques de
d
éveloppement.
La politique fran
çaise de coop ération internationale int ègre non seulement la gestion des flux migratoires et participation
au d
éveloppement. Elle se d éploie tout naturellement de fa çon privil égiée en direction du continent africain, mais aussi
des pays situ
és aux marges orientales de l’Union Europ éenne.
Ex : Dans le cadre europ éen, l’« approche globale des
migrations et de la mobilit
é » a été mise en place à partir de 2005. De plus, la politique bilat érale d’accords de gestion
concert
ée des flux migratoires avec les pays d’origine et d’accords d’ échanges de jeunes (comme le programme «
VacancesTravail ») compl
ète l’action de la France en mati ère de coop ération internationale.
Trois volets constituent le socle de ces partenariats que la France a d
évelopp és avec les pays d’origine : L’organisation de
la migration l
égale qui d écoule essentiellement d’engagements du pays d’accueil (d élivrance de visas de circulation) // La
lutte contre l’immigration irr
éguli ère qui pr évoit une étroite coop ération avec le pays d’origine pour tout ce qui a trait aux
migrations clandestines // La mise en place d’actions de d
éveloppement au profit des r égions pauvres et sources de
migrations du pays d’origine.
Enfin, outremer, la France pr
ésente, en raison de sa prosp érité relative par rapport à son environnement r égional, une
attractivit
é migratoire plus importante qu’en m étropole. Les sp écificit és g éographiques de Mayotte et de la Guyane, en
particulier leur proximit
é avec des pays sources d’immigration, y rendent la pression migratoire exceptionnellement
é
lev ée ; la mise en œuvre de la politique de contr ôle de l’immigration y est ainsi plus difficile. Ce constat se retrouve
é
galement à SaintMartin.
III.
Ainsi, m
ême si on remarque une politique migratoire fran çaise organis ée, en d éveloppement et constitu é
d’instruments pour l’insertion des
étrangers Il y a aussi une lutte contre les étrangers en situation irr éguli ère et une
hausse de l’opinion publique contre les
étrangers Cela traduit les limites apparentes.
Lutte contre les
étrangers en situation irr éguli ère : C’est un des volets du partenariat de la France avec les pays d’origine
mais c’est aussi un moyen de la politique de contr
ôle des flux migratoires.
L’ann
ée 2012 a été caract érisée par une forte mobilisation des services charg és de la lutte contre l’immigration
irr
éguli ère, qui se traduit par un maintien à un haut niveau du nombre de fili ères d émantel ées et par une hausse sensible
du nombre des d
éparts contraints (21 841 d éparts sans aide au retour dans le cadre d’une mesure d’ éloignement). De plus,
concernant les fraudes documentaires, il convient de souligner que face
à des personnels mieux form és et à des
documents de plus en plus s
écuris és, les faussaires ont eu tendance, depuis plusieurs ann ées, à délaisser les formes
traditionnelles de la fraude (contrefa
çons et les falsifications des titres r églementaires) en s’orientant vers l’obtention
indue de ces titres.
Enfin, actuellement et depuis quelques ann
ées, la soci été fran çaise se crispe. Les Fran çais sont pessimistes et ne voient
pas un bon futur
à cause d’une perte de pouvoir pour la puissance fran çaise, une politique qui manque de coh ésion et
d’effet positif. De plus, elle vit dans les clich
és car tous les musulmans sont vus comme des « int égristes » et la confusion
entre immigr
é et étranger joue sur le fait que plus de la moiti é soit 70% des fran çais avancent « qu’il y a trop d’ étranger
en France » selon l’Obs. (62% ne se sentent plus chez eux et 46% pensent qu’il faut r
éduire le nombre d’ étranger pour
r
éduire les nombres du ch ômage) Facteurs de la mont ée de parti comme le FN.
Pour conclure, on remarque qu’il y a eu une
évolution de la population étrang ère en France qui est constitu ée aujourd’hui
majoritairement par l’immigration familiale ou par les demandes d’asile.
Ainsi, la France a du mettre en place des
instruments et des moyens pour accompagner les
étrangers. De ce fait, le pays a mis en place une politique migratoire afin
de mieux les int
égrer (notamment en proposant l’acc ès à la nationalit é fran çaise) qui est compl étée par une coop ération
internationale entre la France et les pays
émetteurs. N éanmoins, il y a des limites ( étrangers en situation irr éguli ère : signe.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- statut des étrangers en France (politique & socièté).
- statut des étrangers en France (cours de droit pénal).
- Comment les étrangers imposés mposés en France ?
- Quelle nationalité en cas de naissance en France de parents étrangers ?
- La monarchie absolue en France face aux modèles étrangers, à la veille de la Révolution