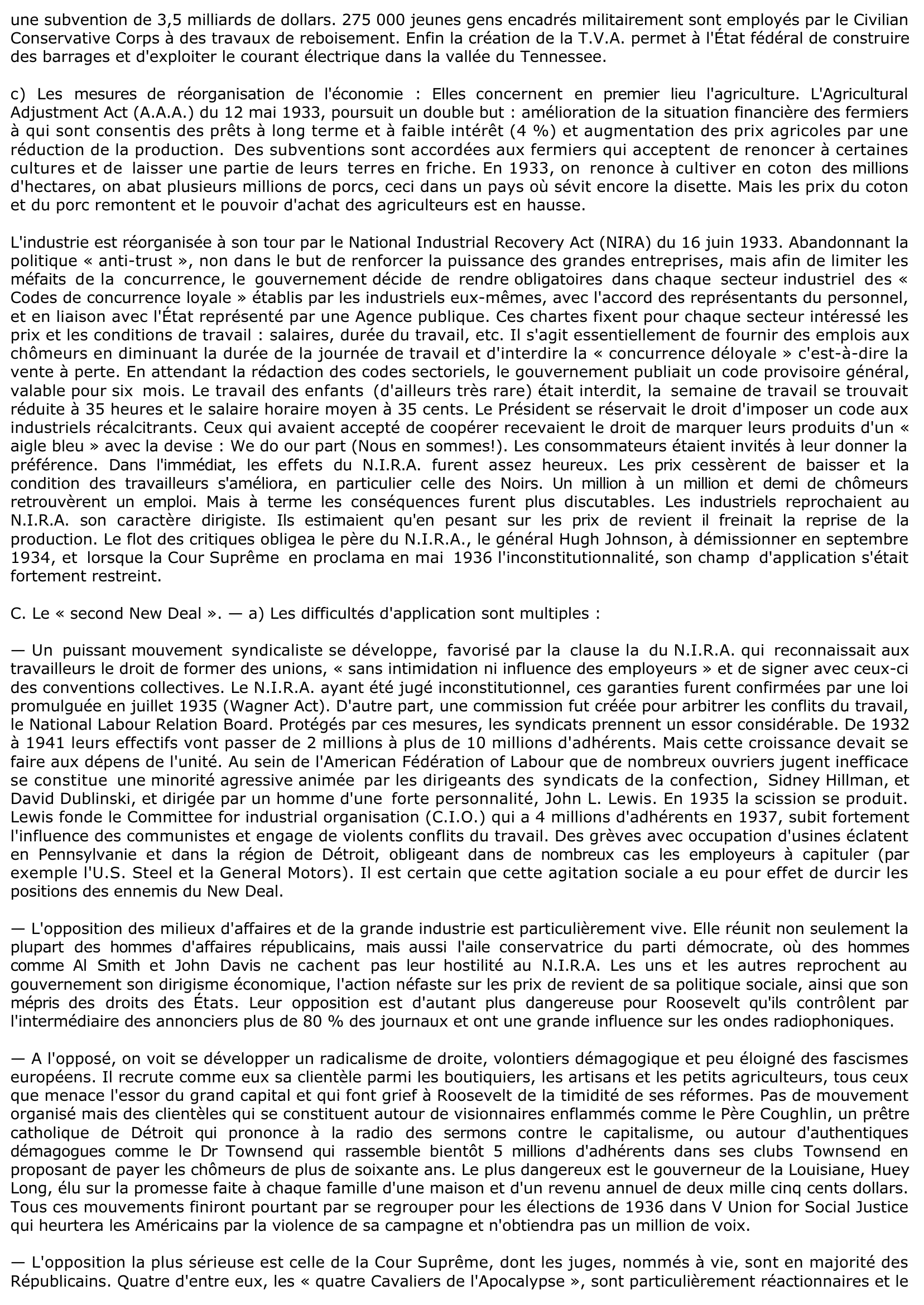Les États-Unis de 1929 à 1941 (histoire)
Publié le 11/04/2011
Extrait du document

I - L'échec des Républicains A. La crise s'aggrave de 1929 à 1932. — Le nombre des chômeurs est passé de 3 millions à 12 millions, ce qui représente, avec leurs familles, une trentaine de millions de personnes plongées dans la misère et abandonnées à la générosité des sociétés de bienfaisance et aux initiatives des autorités locales. Le nombre des mariages et des naissances diminue de 30 % environ, alors que celui des décès et principalement des suicides atteint des records. Des bandes d'ouvriers parcourent les campagnes à la recherche d'un emploi à la journée. A New York, où l'on vend des pommes à l'unité au coin des rues, des centaines de chantiers de construction sont à l'abandon, des gratte-ciel restent inachevés, symboles de l'élan brisé d'une civilisation. Un profond mécontentement se manifeste devant l'incurie de l'administration républicaine et l'entêtement aveugle de Hoover, qui refuse toute atteinte sérieuse au principe du laisser-faire. La colère grandit, avec la répression des premiers troubles dans la rue, par exemple lorsque le président envoie des chars et des mitrailleuses contre les vétérans de la Grande guerre, qui ont organisé une marche sur Washington, pour protester contre le retard apporté au paiement du bonus (prime du combattant).

«
une subvention de 3,5 milliards de dollars.
275 000 jeunes gens encadrés militairement sont employés par le CivilianConservative Corps à des travaux de reboisement.
Enfin la création de la T.V.A.
permet à l'État fédéral de construiredes barrages et d'exploiter le courant électrique dans la vallée du Tennessee.
c) Les mesures de réorganisation de l'économie : Elles concernent en premier lieu l'agriculture.
L'AgriculturalAdjustment Act (A.A.A.) du 12 mai 1933, poursuit un double but : amélioration de la situation financière des fermiersà qui sont consentis des prêts à long terme et à faible intérêt (4 %) et augmentation des prix agricoles par uneréduction de la production.
Des subventions sont accordées aux fermiers qui acceptent de renoncer à certainescultures et de laisser une partie de leurs terres en friche.
En 1933, on renonce à cultiver en coton des millionsd'hectares, on abat plusieurs millions de porcs, ceci dans un pays où sévit encore la disette.
Mais les prix du cotonet du porc remontent et le pouvoir d'achat des agriculteurs est en hausse.
L'industrie est réorganisée à son tour par le National Industrial Recovery Act (NIRA) du 16 juin 1933.
Abandonnant lapolitique « anti-trust », non dans le but de renforcer la puissance des grandes entreprises, mais afin de limiter lesméfaits de la concurrence, le gouvernement décide de rendre obligatoires dans chaque secteur industriel des «Codes de concurrence loyale » établis par les industriels eux-mêmes, avec l'accord des représentants du personnel,et en liaison avec l'État représenté par une Agence publique.
Ces chartes fixent pour chaque secteur intéressé lesprix et les conditions de travail : salaires, durée du travail, etc.
Il s'agit essentiellement de fournir des emplois auxchômeurs en diminuant la durée de la journée de travail et d'interdire la « concurrence déloyale » c'est-à-dire lavente à perte.
En attendant la rédaction des codes sectoriels, le gouvernement publiait un code provisoire général,valable pour six mois.
Le travail des enfants (d'ailleurs très rare) était interdit, la semaine de travail se trouvaitréduite à 35 heures et le salaire horaire moyen à 35 cents.
Le Président se réservait le droit d'imposer un code auxindustriels récalcitrants.
Ceux qui avaient accepté de coopérer recevaient le droit de marquer leurs produits d'un «aigle bleu » avec la devise : We do our part (Nous en sommes!).
Les consommateurs étaient invités à leur donner lapréférence.
Dans l'immédiat, les effets du N.I.R.A.
furent assez heureux.
Les prix cessèrent de baisser et lacondition des travailleurs s'améliora, en particulier celle des Noirs.
Un million à un million et demi de chômeursretrouvèrent un emploi.
Mais à terme les conséquences furent plus discutables.
Les industriels reprochaient auN.I.R.A.
son caractère dirigiste.
Ils estimaient qu'en pesant sur les prix de revient il freinait la reprise de laproduction.
Le flot des critiques obligea le père du N.I.R.A., le général Hugh Johnson, à démissionner en septembre1934, et lorsque la Cour Suprême en proclama en mai 1936 l'inconstitutionnalité, son champ d'application s'étaitfortement restreint.
C.
Le « second New Deal ».
— a) Les difficultés d'application sont multiples :
— Un puissant mouvement syndicaliste se développe, favorisé par la clause la du N.I.R.A.
qui reconnaissait auxtravailleurs le droit de former des unions, « sans intimidation ni influence des employeurs » et de signer avec ceux-cides conventions collectives.
Le N.I.R.A.
ayant été jugé inconstitutionnel, ces garanties furent confirmées par une loipromulguée en juillet 1935 (Wagner Act).
D'autre part, une commission fut créée pour arbitrer les conflits du travail,le National Labour Relation Board.
Protégés par ces mesures, les syndicats prennent un essor considérable.
De 1932à 1941 leurs effectifs vont passer de 2 millions à plus de 10 millions d'adhérents.
Mais cette croissance devait sefaire aux dépens de l'unité.
Au sein de l'American Fédération of Labour que de nombreux ouvriers jugent inefficacese constitue une minorité agressive animée par les dirigeants des syndicats de la confection, Sidney Hillman, etDavid Dublinski, et dirigée par un homme d'une forte personnalité, John L.
Lewis.
En 1935 la scission se produit.Lewis fonde le Committee for industrial organisation (C.I.O.) qui a 4 millions d'adhérents en 1937, subit fortementl'influence des communistes et engage de violents conflits du travail.
Des grèves avec occupation d'usines éclatenten Pennsylvanie et dans la région de Détroit, obligeant dans de nombreux cas les employeurs à capituler (parexemple l'U.S.
Steel et la General Motors).
Il est certain que cette agitation sociale a eu pour effet de durcir lespositions des ennemis du New Deal.
— L'opposition des milieux d'affaires et de la grande industrie est particulièrement vive.
Elle réunit non seulement laplupart des hommes d'affaires républicains, mais aussi l'aile conservatrice du parti démocrate, où des hommescomme Al Smith et John Davis ne cachent pas leur hostilité au N.I.R.A.
Les uns et les autres reprochent augouvernement son dirigisme économique, l'action néfaste sur les prix de revient de sa politique sociale, ainsi que sonmépris des droits des États.
Leur opposition est d'autant plus dangereuse pour Roosevelt qu'ils contrôlent parl'intermédiaire des annonciers plus de 80 % des journaux et ont une grande influence sur les ondes radiophoniques.
— A l'opposé, on voit se développer un radicalisme de droite, volontiers démagogique et peu éloigné des fascismeseuropéens.
Il recrute comme eux sa clientèle parmi les boutiquiers, les artisans et les petits agriculteurs, tous ceuxque menace l'essor du grand capital et qui font grief à Roosevelt de la timidité de ses réformes.
Pas de mouvementorganisé mais des clientèles qui se constituent autour de visionnaires enflammés comme le Père Coughlin, un prêtrecatholique de Détroit qui prononce à la radio des sermons contre le capitalisme, ou autour d'authentiquesdémagogues comme le Dr Townsend qui rassemble bientôt 5 millions d'adhérents dans ses clubs Townsend enproposant de payer les chômeurs de plus de soixante ans.
Le plus dangereux est le gouverneur de la Louisiane, HueyLong, élu sur la promesse faite à chaque famille d'une maison et d'un revenu annuel de deux mille cinq cents dollars.Tous ces mouvements finiront pourtant par se regrouper pour les élections de 1936 dans V Union for Social Justicequi heurtera les Américains par la violence de sa campagne et n'obtiendra pas un million de voix.
— L'opposition la plus sérieuse est celle de la Cour Suprême, dont les juges, nommés à vie, sont en majorité desRépublicains.
Quatre d'entre eux, les « quatre Cavaliers de l'Apocalypse », sont particulièrement réactionnaires et le.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Les États-Unis face à la crise de 1929 à 1941. Histoire
- Les États-Unis face à la crise de 1929 à 1941 ? (Histoire)
- Herbert Hoover par Roger Heacock Écrivain, Genève Herbert Hoover, trente et unième Président des États-Unis, est souvent représenté comme victime de l'histoire, impuissant, de par son conservatisme politique, à sortir son pays du marasme économique dans lequel il avait sombré en 1929.
- ÉTATS-UNIS DE LA PROSPÉRITÉ, ÉTATS-UNIS DE LA CRISE de 1929 (Histoire)
- LES ÉTATS-UNIS DANS L'ENTRE-DEUX-GUERRES : Les États-Unis dans la crise économique (1929-1939). HISTOIRE