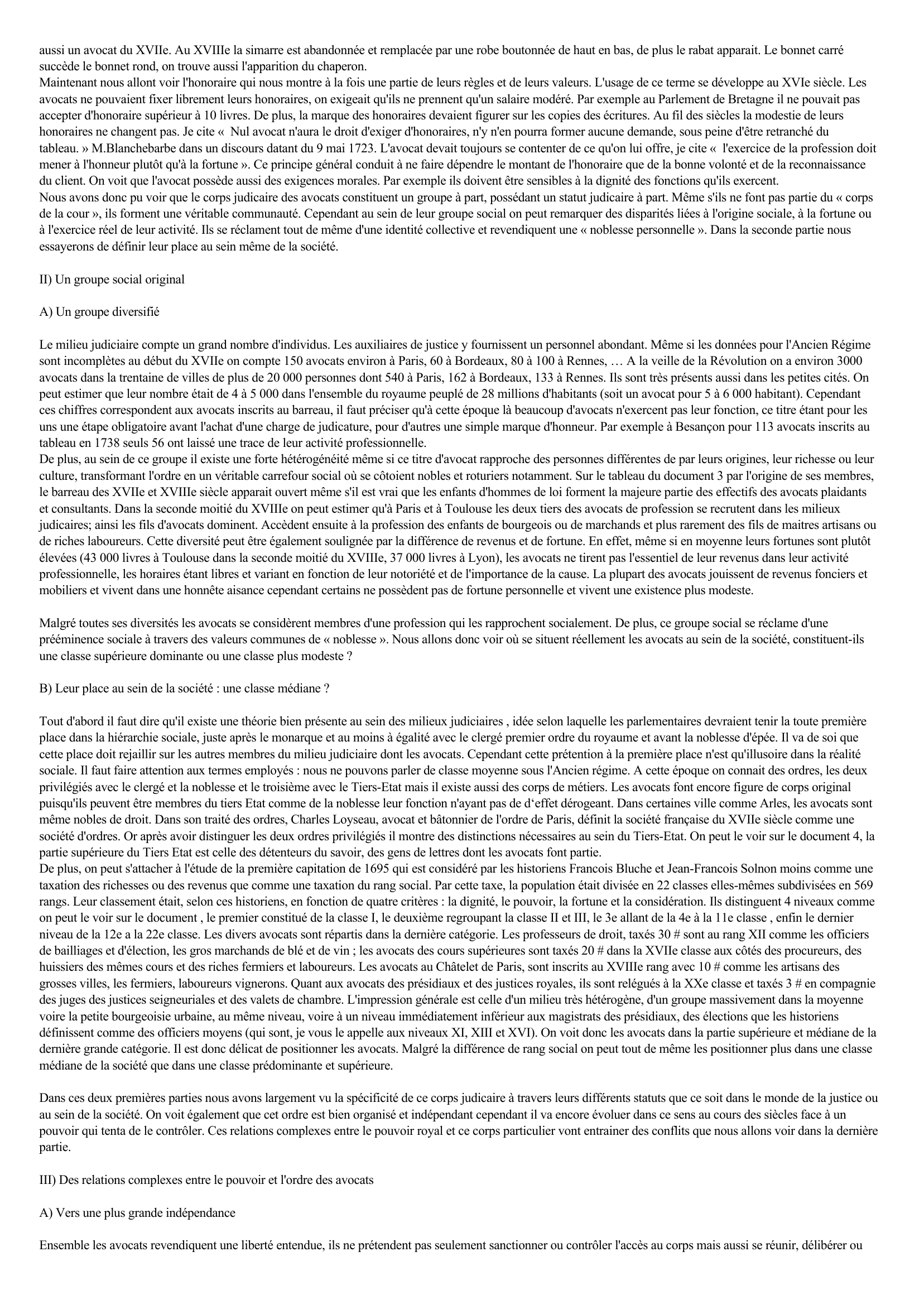Les Avocats sous l'ancien Régime
Publié le 17/08/2012
Extrait du document
L’activité des avocats est contrôlée par les Parlements notamment au travers de l’élaboration de nombreuses ordonnances qui régissent certains aspects de leur profession. Les ordonnances sont lues à chaque audience de rentrée en cour de justice et prêtent serment de les respecter. Les avocats ont longtemps étaient placés sous la dépendance disciplinaire des parlements qui disposent de moyens de coercition comme l’amende, la suspension, la privation de postuler ou l’emprisonnement. Les parlements réglementent aussi les écritures et les plaidoyers des avocats dont-ils exigent « brièveté et netteté « et tentent de contrôler leurs honoraires. Dans les juridictions inférieurs ils sont soumis pareillement à une réglementation et sont même taxés s’ils ne se plient pas à certains usages : par exemple dans certains tribunaux ils ne peuvent pas parler pendant que le juge prononce un jugement sous peine de 10 livres d’amende. Cette tutelle des parlements et des cours royales tend à s’atténuer au cours du XVIIIe siècle comme nous l’avons vu plus haut. Le document 5 , est un exemple de ce contrôle des parlements sur les avocats. Une des grandes crises entre le pouvoir et le corps des avocats est la grande grève de 1602. A plusieurs reprises avait édicté la nécessité pour les avocats de signer leurs écritures, l’ordonnance de Blois de mai 1579 rappelle cette obligation en y ajoutant celle de mentionner les honoraires. Les avocats prennent assez mal cette disposition car ils y voient une méfiance autant qu’une atteinte à leur honneur et leur indépendance. Le parlement s’était alors bien gardé d’appliquer ce texte. Cependant l’arrêt de Parlement du 11 mai 1602 rallume le feu en rappelant l’obligation édictée par l’ordonnance de Blois. Les avocats se réunissent, délibèrent et en cortège vont remettre leur démission au greffe, détenteur du Tableau. Cette réaction est capitale, c’est une manifestation unanime, spontanée mais surtout une manifestation de force. Cependant il ne faut pas penser que les avocats et les Parlements étaient ennemis, la plupart
«
aussi un avocat du XVIIe.
Au XVIIIe la simarre est abandonnée et remplacée par une robe boutonnée de haut en bas, de plus le rabat apparait.
Le bonnet carrésuccède le bonnet rond, on trouve aussi l'apparition du chaperon.Maintenant nous allont voir l'honoraire qui nous montre à la fois une partie de leurs règles et de leurs valeurs.
L'usage de ce terme se développe au XVIe siècle.
Lesavocats ne pouvaient fixer librement leurs honoraires, on exigeait qu'ils ne prennent qu'un salaire modéré.
Par exemple au Parlement de Bretagne il ne pouvait pasaccepter d'honoraire supérieur à 10 livres.
De plus, la marque des honoraires devaient figurer sur les copies des écritures.
Au fil des siècles la modestie de leurshonoraires ne changent pas.
Je cite « Nul avocat n'aura le droit d'exiger d'honoraires, n'y n'en pourra former aucune demande, sous peine d'être retranché dutableau.
» M.Blanchebarbe dans un discours datant du 9 mai 1723.
L'avocat devait toujours se contenter de ce qu'on lui offre, je cite « l'exercice de la profession doitmener à l'honneur plutôt qu'à la fortune ».
Ce principe général conduit à ne faire dépendre le montant de l'honoraire que de la bonne volonté et de la reconnaissancedu client.
On voit que l'avocat possède aussi des exigences morales.
Par exemple ils doivent être sensibles à la dignité des fonctions qu'ils exercent.Nous avons donc pu voir que le corps judicaire des avocats constituent un groupe à part, possédant un statut judicaire à part.
Même s'ils ne font pas partie du « corpsde la cour », ils forment une véritable communauté.
Cependant au sein de leur groupe social on peut remarquer des disparités liées à l'origine sociale, à la fortune ouà l'exercice réel de leur activité.
Ils se réclament tout de même d'une identité collective et revendiquent une « noblesse personnelle ».
Dans la seconde partie nousessayerons de définir leur place au sein même de la société.
II) Un groupe social original
A) Un groupe diversifié
Le milieu judiciaire compte un grand nombre d'individus.
Les auxiliaires de justice y fournissent un personnel abondant.
Même si les données pour l'Ancien Régimesont incomplètes au début du XVIIe on compte 150 avocats environ à Paris, 60 à Bordeaux, 80 à 100 à Rennes, … A la veille de la Révolution on a environ 3000avocats dans la trentaine de villes de plus de 20 000 personnes dont 540 à Paris, 162 à Bordeaux, 133 à Rennes.
Ils sont très présents aussi dans les petites cités.
Onpeut estimer que leur nombre était de 4 à 5 000 dans l'ensemble du royaume peuplé de 28 millions d'habitants (soit un avocat pour 5 à 6 000 habitant).
Cependantces chiffres correspondent aux avocats inscrits au barreau, il faut préciser qu'à cette époque là beaucoup d'avocats n'exercent pas leur fonction, ce titre étant pour lesuns une étape obligatoire avant l'achat d'une charge de judicature, pour d'autres une simple marque d'honneur.
Par exemple à Besançon pour 113 avocats inscrits autableau en 1738 seuls 56 ont laissé une trace de leur activité professionnelle.De plus, au sein de ce groupe il existe une forte hétérogénéité même si ce titre d'avocat rapproche des personnes différentes de par leurs origines, leur richesse ou leurculture, transformant l'ordre en un véritable carrefour social où se côtoient nobles et roturiers notamment.
Sur le tableau du document 3 par l'origine de ses membres,le barreau des XVIIe et XVIIIe siècle apparait ouvert même s'il est vrai que les enfants d'hommes de loi forment la majeure partie des effectifs des avocats plaidantset consultants.
Dans la seconde moitié du XVIIIe on peut estimer qu'à Paris et à Toulouse les deux tiers des avocats de profession se recrutent dans les milieuxjudicaires; ainsi les fils d'avocats dominent.
Accèdent ensuite à la profession des enfants de bourgeois ou de marchands et plus rarement des fils de maitres artisans oude riches laboureurs.
Cette diversité peut être également soulignée par la différence de revenus et de fortune.
En effet, même si en moyenne leurs fortunes sont plutôtélevées (43 000 livres à Toulouse dans la seconde moitié du XVIIIe, 37 000 livres à Lyon), les avocats ne tirent pas l'essentiel de leur revenus dans leur activitéprofessionnelle, les horaires étant libres et variant en fonction de leur notoriété et de l'importance de la cause.
La plupart des avocats jouissent de revenus fonciers etmobiliers et vivent dans une honnête aisance cependant certains ne possèdent pas de fortune personnelle et vivent une existence plus modeste.
Malgré toutes ses diversités les avocats se considèrent membres d'une profession qui les rapprochent socialement.
De plus, ce groupe social se réclame d'uneprééminence sociale à travers des valeurs communes de « noblesse ».
Nous allons donc voir où se situent réellement les avocats au sein de la société, constituent-ilsune classe supérieure dominante ou une classe plus modeste ?
B) Leur place au sein de la société : une classe médiane ?
Tout d'abord il faut dire qu'il existe une théorie bien présente au sein des milieux judiciaires , idée selon laquelle les parlementaires devraient tenir la toute premièreplace dans la hiérarchie sociale, juste après le monarque et au moins à égalité avec le clergé premier ordre du royaume et avant la noblesse d'épée.
Il va de soi quecette place doit rejaillir sur les autres membres du milieu judiciaire dont les avocats.
Cependant cette prétention à la première place n'est qu'illusoire dans la réalitésociale.
Il faut faire attention aux termes employés : nous ne pouvons parler de classe moyenne sous l'Ancien régime.
A cette époque on connait des ordres, les deuxprivilégiés avec le clergé et la noblesse et le troisième avec le Tiers-Etat mais il existe aussi des corps de métiers.
Les avocats font encore figure de corps originalpuisqu'ils peuvent être membres du tiers Etat comme de la noblesse leur fonction n'ayant pas de d‘effet dérogeant.
Dans certaines ville comme Arles, les avocats sontmême nobles de droit.
Dans son traité des ordres, Charles Loyseau, avocat et bâtonnier de l'ordre de Paris, définit la société française du XVIIe siècle comme unesociété d'ordres.
Or après avoir distinguer les deux ordres privilégiés il montre des distinctions nécessaires au sein du Tiers-Etat.
On peut le voir sur le document 4, lapartie supérieure du Tiers Etat est celle des détenteurs du savoir, des gens de lettres dont les avocats font partie.De plus, on peut s'attacher à l'étude de la première capitation de 1695 qui est considéré par les historiens Francois Bluche et Jean-Francois Solnon moins comme unetaxation des richesses ou des revenus que comme une taxation du rang social.
Par cette taxe, la population était divisée en 22 classes elles-mêmes subdivisées en 569rangs.
Leur classement était, selon ces historiens, en fonction de quatre critères : la dignité, le pouvoir, la fortune et la considération.
Ils distinguent 4 niveaux commeon peut le voir sur le document , le premier constitué de la classe I, le deuxième regroupant la classe II et III, le 3e allant de la 4e à la 11e classe , enfin le dernierniveau de la 12e a la 22e classe.
Les divers avocats sont répartis dans la dernière catégorie.
Les professeurs de droit, taxés 30 # sont au rang XII comme les officiersde bailliages et d'élection, les gros marchands de blé et de vin ; les avocats des cours supérieures sont taxés 20 # dans la XVIIe classe aux côtés des procureurs, deshuissiers des mêmes cours et des riches fermiers et laboureurs.
Les avocats au Châtelet de Paris, sont inscrits au XVIIIe rang avec 10 # comme les artisans desgrosses villes, les fermiers, laboureurs vignerons.
Quant aux avocats des présidiaux et des justices royales, ils sont relégués à la XXe classe et taxés 3 # en compagniedes juges des justices seigneuriales et des valets de chambre.
L'impression générale est celle d'un milieu très hétérogène, d'un groupe massivement dans la moyennevoire la petite bourgeoisie urbaine, au même niveau, voire à un niveau immédiatement inférieur aux magistrats des présidiaux, des élections que les historiensdéfinissent comme des officiers moyens (qui sont, je vous le appelle aux niveaux XI, XIII et XVI).
On voit donc les avocats dans la partie supérieure et médiane de ladernière grande catégorie.
Il est donc délicat de positionner les avocats.
Malgré la différence de rang social on peut tout de même les positionner plus dans une classemédiane de la société que dans une classe prédominante et supérieure.
Dans ces deux premières parties nous avons largement vu la spécificité de ce corps judicaire à travers leurs différents statuts que ce soit dans le monde de la justice ouau sein de la société.
On voit également que cet ordre est bien organisé et indépendant cependant il va encore évoluer dans ce sens au cours des siècles face à unpouvoir qui tenta de le contrôler.
Ces relations complexes entre le pouvoir royal et ce corps particulier vont entrainer des conflits que nous allons voir dans la dernièrepartie.
III) Des relations complexes entre le pouvoir et l'ordre des avocats
A) Vers une plus grande indépendance
Ensemble les avocats revendiquent une liberté entendue, ils ne prétendent pas seulement sanctionner ou contrôler l'accès au corps mais aussi se réunir, délibérer ou.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Être chrétien en France sous l’ancien régime
- ANCIEN RÉGIME ET LA Révolution (L’) - Alexis de Tocqueville (résumé et analyse)
- ANCIEN RÉGIME ET LA RÉVOLUTION (L’), Tocqueville
- Taille Impôt de l'Ancien Régime.
- La France de l'ancien régime par Victor-E.