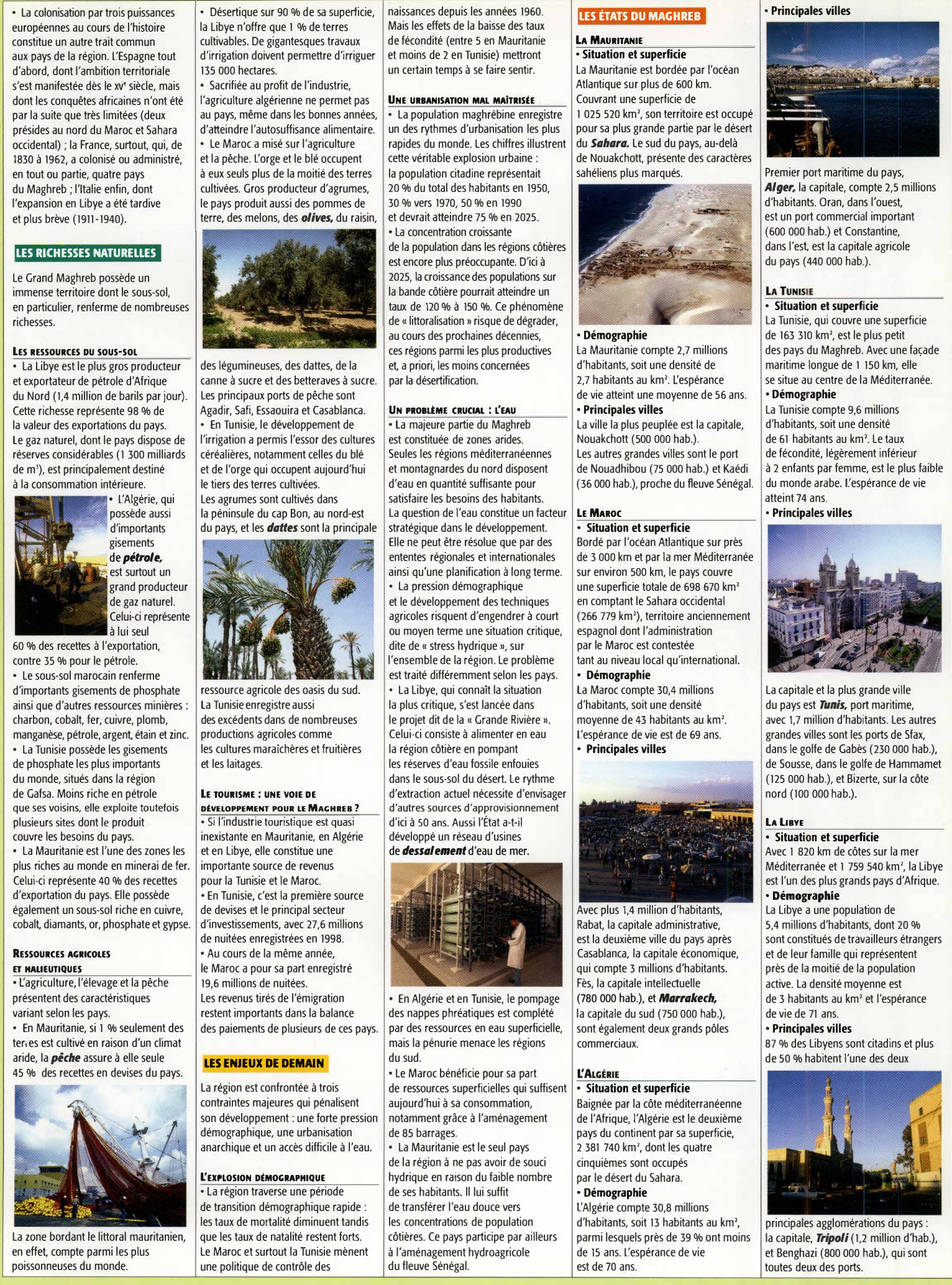Le Grand Maghreb
Publié le 30/12/2018
Extrait du document
UNE RÉGION D'AFRIQUE PROCHE DE L'EUROPE
Le terme de « Maghreb » désigne traditionnellement le groupe de pays d'Afrique du Nord que forment le Maroc, l'Algérie et la Tunisie auxquels on ajoute parfois, dans le cadre d'un « Grand Maghreb », les deux pays situés aux extrémités orientale et occidentale de ce bloc : la Mauritanie et la Libye. Depuis 1989, ces cinq États sont regroupés au sein de l'Union du Maghreb arabe (UMA). Ce Grand Maghreb s'étend sur une superficie de plus de 6 millions de km2. Délimités au nord par la mer Méditerranée, au sud par le Sahara, à Test par le désert de Libye et à l'ouest par l'Atlantique, ces cinq pays s'étendent sur plus de 4 000 km d'ouest en est. Le Maghreb compte près de 80 millions d'habitants dont plus des trois quarts vivent en Algérie et au Maroc.
UN MILIEU NATUREL HOMOGÈNE
Le Maghreb doit son homogénéité à la présence d'un massif montagneux unique, l'Atlas, d'un vaste désert, le Sahara, et de climats méditerranéen, près des côtes, et aride dans le désert, qui déterminent un système hygrométrique particulier.
Le système de l'Atlas
• Le nord du Maghreb est occupé par le massif de l'Atlas, qui est formé de plusieurs chaînes parallèles. Celles-ci s'étirent sur 2 400 km et forment une barrière entre la côte méditerranéenne et le Sahara. L'Atlas culmine au Djebel Toubkal (4165 m), au Maroc.
• Au Maroc, le Haut Atlas est séparé du Moyen Atlas, au nord, par l'oued Moulouya, et de l'Anti-Atlas, au sud, par l'oued Sous.
• En Algérie, l'Atlas tellien et l'Atlas saharien, plus au sud, prolongé
à l'est par les Aurès, encadrent les Hauts Plateaux.
• En Tunisie, les monts
de la Medjerda et de Tébessa marquent la fin du système atlasique.
Le Sahara
• Dans le sud du Maghreb s'étend le Sahara qui couvre la quasi-totalité de la Mauritanie et de la Libye, 80 % de l'Algérie, 65 % du Maroc et près de 50 % de la Tunisie. Le plus vaste désert du monde présente une alternance de cuvettes et de plateaux ; il est émaillé de quelques formations montagneuses d'origine volcanique : le Hoggar, dans le sud algérien, et le Tibesti, à cheval sur la frontière de la Libye et du Tchad.
Hygrométrie et climat
• De nombreux oueds qui grossissent après les orages descendent de ces montagnes, les uns s'écoulant vers la Méditerranée, les autres vers le Sahara. Ils arrosent les plaines côtières étroites et fertiles et les hauts plateaux semi-arides de l'intérieur des terres.
• Désertique sur 90 °/o de sa superficie, la Libye n'offre que 1 % de terres cultivables. De gigantesques travaux d'irrigation doivent permettre d'irriguer 135 000 hectares.
• Sacrifiée au profit de l'industrie, l'agriculture algérienne ne permet pas au pays, même dans les bonnes années, d'atteindre l’autosuffisance alimentaire.
• Le Maroc a misé sur l'agriculture et la pêche. L'orge et le blé occupent
à eux seuls plus de la moitié des terres cultivées. Gros producteur d'agrumes, le pays produit aussi des pommes de terre, des melons, des olives, du raisin,
des légumineuses, des dattes, de la canne à sucre et des betteraves à sucre. Les principaux ports de pêche sont Agadir, Safi, Essaouira et Casablanca.
• En Tunisie, le développement de l'irrigation a permis l'essor des cultures céréalières, notamment celles du blé et de l'orge qui occupent aujourd'hui le tiers des terres cultivées.
Les agrumes sont cultivés dans la péninsule du cap Bon, au nord-est du pays, et les dattes sont la principale
ressource agricole des oasis du sud. La Tunisie enregistre aussi des excédents dans de nombreuses productions agricoles comme les cultures maraîchères et fruitières et les laitages.
Le tourisme : une voie de
DÉVELOPPEMENT POUR LE MAGHREB ?
• Si l'industrie touristique est quasi inexistante en Mauritanie, en Algérie et en Libye, elle constitue une importante source de revenus pour la Tunisie et le Maroc.
• En Tunisie, c'est la première source de devises et le principal secteur d'investissements, avec 27,6 millions de nuitées enregistrées en 1998.
• Au cours de la même année,
le Maroc a pour sa part enregistré 19,6 millions de nuitées.
Les revenus tirés de l'émigration restent importants dans la balance des paiements de plusieurs de ces pays.
LES ENJEUX DE DEMAIN
La région est confrontée à trois contraintes majeures qui pénalisent son développement : une forte pression démographique, une urbanisation anarchique et un accès difficile à l'eau.
L'explosion démographique
• La région traverse une période de transition démographique rapide : les taux de mortalité diminuent tandis que les taux de natalité restent forts. Le Maroc et surtout la Tunisie mènent une politique de contrôle des
naissances depuis les années 1960. Mais les effets de la baisse des taux de fécondité (entre 5 en Mauritanie et moins de 2 en Tunisie) mettront un certain temps à se faire sentir.
Une urbanisation mal maîtrisée
• La population maghrébine enregistre un des rythmes d'urbanisation les plus rapides du monde. Les chiffres illustrent cette véritable explosion urbaine :
la population citadine représentait 20 % du total des habitants en 1950, 30 % vers 1970, 50 % en 1990 et devrait atteindre 75 % en 2025.
• La concentration croissante
de la population dans les régions côtières est encore plus préoccupante. D'ici à 2025, la croissance des populations sur la bande côtière pourrait atteindre un taux de 120 % à 150 %. Ce phénomène de « littoralisation » risque de dégrader, au cours des prochaines décennies, ces régions parmi les plus productives et, a priori, les moins concernées par la désertification.
Un problème crucial : l'eau
• La majeure partie du Maghreb est constituée de zones arides.
Seules les régions méditerranéennes et montagnardes du nord disposent d'eau en quantité suffisante pour satisfaire les besoins des habitants.
La question de l'eau constitue un facteur stratégique dans le développement. Elle ne peut être résolue que par des ententes régionales et internationales ainsi qu'une planification à long terme.
• La pression démographique
et le développement des techniques agricoles risquent d'engendrer à court ou moyen terme une situation critique, dite de « stress hydrique », sur l'ensemble de la région. Le problème est traité différemment selon les pays.
• La Libye, qui connaît la situation la plus critique, s'est lancée dans
le projet dit de la « Grande Rivière ». Celui-ci consiste à alimenter en eau la région côtière en pompant les réserves d'eau fossile enfouies dans le sous-sol du désert. Le rythme d'extraction actuel nécessite d’envisager d'autres sources d'approvisionnement d'ici à 50 ans. Aussi l'État a-t-il développé un réseau d'usines de dessalement d'eau de mer.
«
•
La colonisation par trois puissances
européennes au cours de l'histoire
constitue un autre trait commun
aux pays de la région.
t:Espagne tout
d'abord, dont l'ambition territoriale
s'est manifestée dès le xv• siècle, mais
dont les conquêtes africaines n'ont été
par la suite que très limitées (deux
présides au nord du Maroc et Sahara
occidental) ; la France, surtout, qui, de
1830 à 1962, a colonisé ou administré,
en tout ou partie, quatre pays
du Maghreb ; l'Italie enfin, dont
l'expansion en Libye a été tardive
et plus brève (1911-1940).
LES RICHESSES NATURELLES
Le Grand Maghreb possède un
immense territoire dont le sous-sol,
en particulier, renferme de nombreuses
richesses.
LES RESSOURCES DU SOUS-SOL
• La Libye est le plus gros producteur
et exportateur de pétrole d'Afrique
du Nord (1,4 million de barils par jour).
Cette richesse représente 98% de
la valeur des exportations du pays.
Le gaz naturel, dont le pays dispose de
réserves considérables (1 300 milliards
de m'), est principalement destiné
à la consommation intérieure.
t:Aigérie, qui
possède aussi
d'importants
gisements
de pétrole,
est surtout un
grand producteur
de gaz naturel.
Celui-ci représente
à lui seul
60% des recettes à l'exportation,
contre 35 % pour le pétrole.
• Le sous-sol marocain renferme
d'importants gisements de phosphate
ainsi que d'autres ressources minières:
charbon, cobalt, fer, cuivre, plomb,
manganèse, pétrole, argen� étain et zinc.
• La Tunisie possède les gisements
de phosphate les plus importants
du monde, situés dans la région
de Gafsa.
Moins riche en pétrole
que ses voisins, elle exploite toutefois
pl usi eurs sites dont le produit
couvre les besoins du pays.
• La Mauritanie est l'une des zones les
plus riches au monde en minerai de fer.
Celui-ci représente 40 % des recettes
d'exportation du pays.
Elle possède
également un sous-sol riche en cuivre,
cabal� diamants, or, phosphate et gypse.
RESSOURCES AGRICOLES
ET HALIEUTIQUES
• t:agriculture, l'élevage et la pêche
présentent des caractéristiques
variant selon les pays.
• En Mauritanie, si 1 % seulement des
ter, es est cultivé en raison d'un climat
aride, la pêche assure à elle seule
45 % des recettes en devises du pays.
La zone bordant le littoral mauritanien,
en elfe� compte parmi les plus
poissonneuses du monde.
•
Désertique sur 90 % de sa superficie,
la Libye n'offre que 1 % de terres
cultivables.
De gigantesques travaux
d'irrigation doivent permettre d'irriguer
135 000 hectares.
• Sacrifiée au profit de l'industrie,
l'agriculture algérienne ne permet pas
au pays, même dans les bonnes années,
d'atteindre l'autosuffisance alimentaire.
• Le Maroc a misé sur l'agriculture
et la pêche.
t:orge et le blé occupent
à eux seuls plus de la moitié des terres
cultivées.
Gros producteur d'agrumes,
le pays produit aussi des pommes de
terre, des melons, des olives, du raisin,
des légumineuses, des dattes, de la
canne à sucre et des betteraves à sucre.
Les principaux ports de pêche sont
Agadir, Safi, Essaouira et Casablanca.
• En Tunisie, le développement de
l'irrigation a permis l'essor des cultures
céréalières, notamment celles du blé
et de l'orge qui occupent aujourd'hui
le tiers des terres cultivées.
Les agrumes sont cultivés dans
la péninsule du cap Bon, au nord-est
du pays, et les dattes sont la principale
ressource agricole des oasis du sud.
La Tunisie enregistre aussi
des excédents dans de nombreuses
productions agricoles comme
les cultures maraîchères et fruitières
et les laitages.
LE TOURISME ; UNE VOIE DE
D!VELOPPEMENT POUR LE MAGHREB ?
• Si l'indu strie touristique est quasi
inexistante en Mauritanie, en Algérie
et en Libye, elle constitue une
importante source de revenus
pour la Tunisie et le Maroc.
• En Tunisie, c'est la première source
de devises et le principal secteur
d'investissements, avec 27,6 millions
de nuitées enregistrées en 1998.
• Au cours de la même année,
le Maroc a pour sa part enregistré
19,6 millions de nuitées.
Les revenus tirés de l'émigration
restent importants dans la balance
des paiements de plusieurs de ces pays.
LES ENJEUX DE DEMAIN
La région est confrontée à trois
contraintes majeures qui pénalisent
son développement : une forte pression
démographique, une urbanisation
anarchique et un accès difficile à l'eau.
L'EXPLOSION DÉMOGRAPHIQUE
• La région traverse une période
de transition démographique rapide :
les taux de mortalité diminuent tandis
que les taux de natalité restent forts.
Le Maroc et surtout la Tunisie mènent
une politique de contrôle des naissances
depuis les années 1960.
Mais les effets de la baisse des taux
de fécondité (entre 5 en Mauritanie
et moins de 2 en Tunisie) mettront
un certain temps à se faire sentir.
UNE URBANISATION MAL MAiTRISÉE
• La population maghrébine enregistre
un des rythmes d'urbanisation les plus
rapides du monde.
Les chiffres illustrent
cette véritable explosion urbaine :
la population citadine représentait
20 % du total des habitants en 1950,
30% vers 1970, 50% en 1990
et devrait atteindre 75 % en 2025.
• La concentration croissante
de la population dans les régions côtières
est encore plus préoccupante.
D'ici à
2025, la croissance des populations sur
la bande côtière pourrait atteindre un
taux de 120% à 150 %.
Ce phénomène
de« littoralisation » risque de dégrader,
au cours des prochaines décennies,
ces régions parmi les plus productives
e� a priori, les moins concernées
par la désertification.
UN PROBLÈME CRUCIAL ; L'EAU
• La majeure partie du Maghreb
est constituée de zones arides.
Seules les régions méditerranéennes
et montagnardes du nord disposent
d'eau en quantité suffisante pour
satisfaire les besoins des habitants.
La question de l'eau constitue un facteur
stratégique dans le développement.
Elle ne peut être résolue que par des
ententes régionales et internationales
ainsi qu'une planification à long terme.
• La pression démographique
et le développement des techniques
agricoles risquent d'engendrer à court
ou moyen terme une situation critique,
dite de « stress hydrique », sur
l'ensemble de la région.
Le problème
est traité différemment selon les pays.
• La Libye, qui connaît la situation
la plus critique, s'est lancée dans
le projet dit de la « Grande Rivière ».
Celui-ci consiste à alimenter en eau
la région côtière en pompant
les réserves d'eau fossile enfouies
dans le sous-sol du désert.
Le rythme
d'extraction actuel nécessite d'envisager
d'autres sources d'approvisionnement
d'ici à 50 ans.
Aussi l'État a-t-il
développé un réseau d'usines
de dessalement d'eau de mer.
• En Algérie et en Tunisie, le pompage
des nappes phréatiques est complété
par des ressources en eau superficielle,
mais la pénurie menace les régions
du sud.
• Le Maroc bénéficie pour sa part
de ressources superficielles qui suffisent
aujourd'hui à sa consommation,
notamment grâce à l'aménagement
de 85 barrages.
• La Mauritanie est le seul pays
de la région à ne pas avoir de souci
hydrique en raison du faible nombre
de ses habitants.
li lui suffit
de transférer l'eau douce vers
les concentrations de population
côtières.
Ce pays participe par ailleurs
à l'aménagement hydroagricole
du fleuve Sénégal.
LES
ÉTATS DU MAGHREB
LA MAURITANIE
• Situation et superficie
La Mauritanie est bordée par l'océan
Atlantique sur plus de 600 km.
Couvrant une superficie de
1 025 520 krn', son territoire est occupé
pour sa plus grande partie par le désert
du Sahara_ Le sud du pays, au-delà
de Nouakchott, présente des caractères
sahéliens plus marqués.
• Démographie
La Mauritanie cornpte 2,7 millions
d'habitants, soit une densité de
2,7 habitants au km'.
t:espérance
de vie atteint une moyenne de 56 ans.
• Principales villes
La ville la plus peuplée est la capitale,
Nouakchott (500 000 hab.).
Les autres grandes villes sont le port
de Nouadhibou (75 000 hab.) et Kaédi
(36 ooo hab.), proche du fleuve Sénégal.
LE MAROC
• Situation et superficie
Bordé par l'océan Atlantique sur près
de 3 000 krn et par la mer Méditerranée
sur environ 500 km, le pays couvre
une superficie totale de 698 670 km'
en comptant le Sahara occidental
(266 779 km'), territoire anciennement
espagnol dont l'administration
par le Maroc est contestée
tant au niveau local qu'international.
• Démographie
La Maroc compte 30,4 millions
d'habitants, soit une densité
moyenne de 43 habitants au km'.
t:espérance de vie est de 69 ans.
• Principales villes
Avec plus 1,4 million d'habitants,
Rabat, la capitale administrative,
est la deuxième ville du pays après
Casablanca, la capitale économique,
qui compte 3 millions d'habitants.
Fès, la capitale intellectuelle
(780 ooo hab.), et Marrakech,
la capitale du sud (750 000 hab.),
sont également deux grands pôles
commerciaux.
• Situation et superficie
Baignée par la côte méditerranéenne
de l'Afrique, l'Algérie est le deuxième
pays du continent par sa superficie,
2 381 740 km', dont les quatre
cinquièmes sont occupés
par le désert du Sahara.
• Démographie
t:Aigérie compte 30,8 millions
d'habitants, soit 13 habitants au km',
parmi lesquels près de 39 % ont moins
de 15 ans.
t:espérance de vie
est de 70 ans.
•
Principales villes
Premier port maritime du pays,
Alger, la capitale, compte 2,5 millions
d'habitants.
Oran, dans l'ouest,
est un port commerci al important
(600 000 hab.) et Constantine,
dans l'est est la capitale agricole
du pays (440 000 hab.).
• Situation et superf icie
La Tunisie, qui couvre une superficie
de 163 310 km', est le plus petit
des pays du Maghreb.
Avec une façade
maritime longue de 1 150 km, elle
se situe au centre de la Méditerranée.
• Démog raphie
La Tunisie compte 9,6 millions
d'habitants, soit une densité
de 61 habitants au km'.
Le taux
de fécondité, légèrement inférieur
à 2 enfants par femme, est le plus faible
du monde arabe.
t:espérance de vie
atteint 74 ans.
• Principales villes
La capitale et la plus grande ville
du pays est Tunis, port maritime,
avec 1,7 million d'habitants .
Les autres
grandes villes sont les ports de Sfax,
dans le golfe de Gabès (230 000 hab.),
de Sousse, dans le golfe de Hammamet
(125 000 hab.), et Bizerte, sur la côte
nord (100 ooo hab.).
LA LIBYE
• Situat ion et superficie
Avec 1 820 km de côtes sur la mer
Méditerranée et 1 759 540 km', la Libye
est l'un des plus grands pays d'Afrique.
• Démographie
La Libye a une population de
5,4 millions d'habitants, dont 20%
sont constitués de travailleurs étrangers
et de leur famille qui représentent
près de la moitié de la population
active.
La densité moyenne est
de 3 habitants au km' et l'espérance
de vie de 71 ans.
• Principales villes
87 % des Libyens sont citadins et plus
de 50 % habitent l'une des deux
principales agglomérations du pays :
la capitale, Tripoli (1,2 million d'hab.),
et Benghazi (800 000 hab.), qui sont
toutes deux des ports..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Le Grand Maghreb (Travaux Personnels Encadrés – Géographie - Enseignements Pratiques Interdisciplinaires)
- Grand Oral: Le nombre d’or
- « Le grand dessein de l'éducation, c'est l'action, pas la connaissance » Spencer
- Grand oral hggsp les ZEE EN ARCTIQUE
- Grand Oral – Svt Quels sont les conséquences de la prise d’un produit dopants sur l’organisme : exemple du Trenbolone