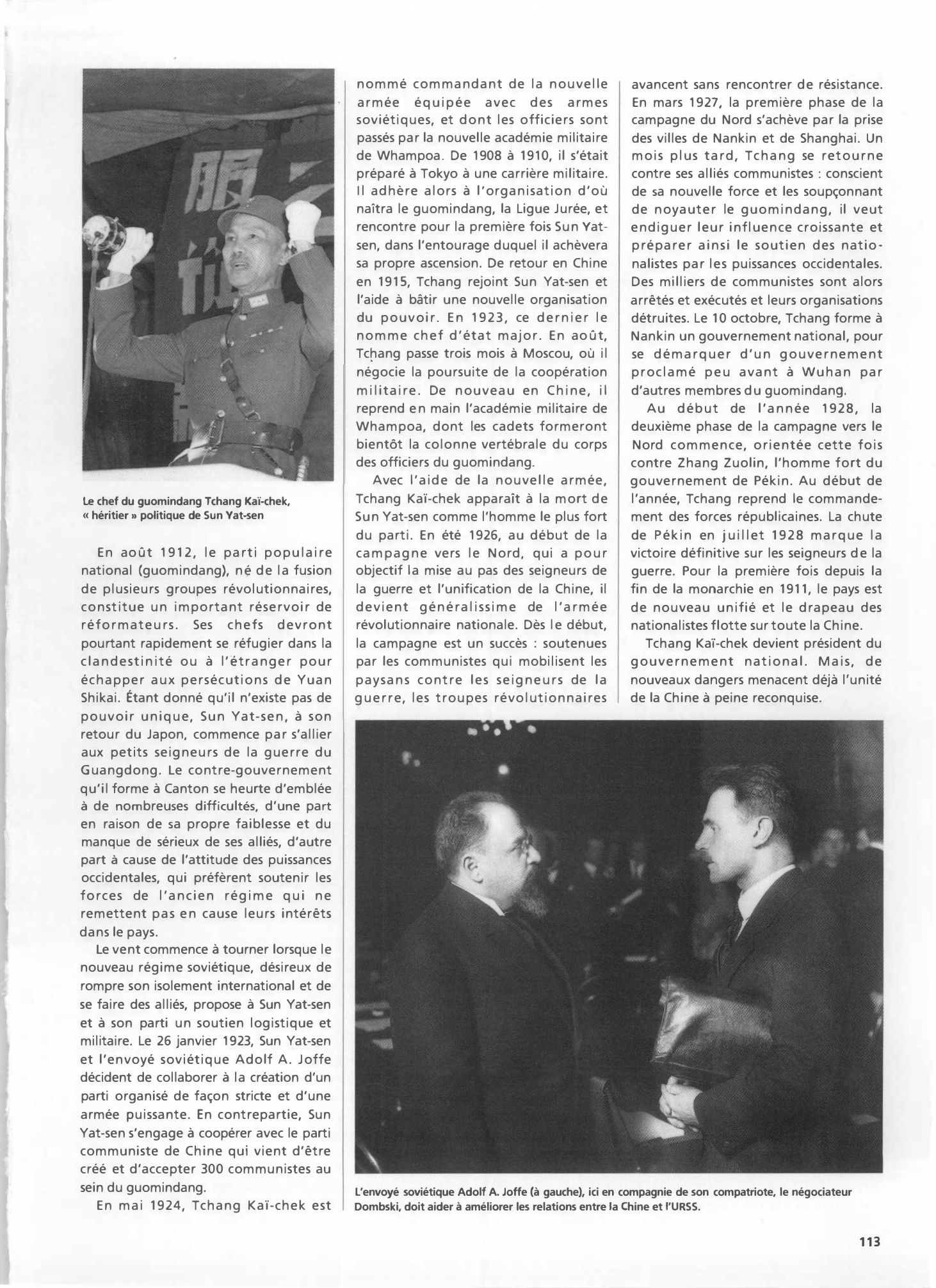Le déclin de la Chine et le combat du guomindang pour la reconstruction de l'unité nationale
Publié le 24/03/2019
Extrait du document

Le 12 mars 1925, le père de la république chinoise, le révolutionnaire et homme d'État Sun Yat-sen, meurt à Pékin. À l'article de la mort, Sun fait le voyage de Canton à Pékin pour y participer à une conférence réunissant différents << seigneurs de la guerre », pour parler des possibilités d'une union pacifique de la Chine. La conférence échoue : l'heure de l'unité de la Chine n'a pas sonné.
Le 12 février 1912, la Chine assiste à la fin d'une époque : le souverain Pu Yi, qui est encore un enfant, abdique. Il ne s'agit pas seulement de la fin de règne d'une dynastie, mais aussi de celle de la monarchie, en place, hormis quelques interruptions, depuis la fondation de l'Empire en 221 av. J.-C. La Chine est désormais une république.
Immédiatement après l'abdication de Pu Yi, le général Yuan Shikai est élu président provisoire à Nankin. Le 10 mars 1912, il entre dans ses nouvelles fonctions à Pékin. Yuan Shikai a la confiance de l'ancienne dynastie, dont certains membres occupent des postes de hauts fonctionnaires, et en même temps la sympathie de certains révolutionnaires, les instigateurs de l'insurrection du 10 octobre 1911. De nombreux Chinois le pensent capables de réunir le pays divisé au plan politique et spirituel, et de mener avec succès les réformes nécessaires, tout autant que de s'opposer aux puissances étrangères et de reconstruire l'unité de la Chine. Yuan Shikai lui ayant promis de maintenir la république, Sun Yat-sen, président provisoire, se retire de ses fonctions le 1\" janvier 1912 en faveur de Yuan.
Or ses espoirs ne sont pas exaucés. Yuan ne réconcilie pas les partisans de l'ancien régime et les défenseurs de la république, ne résiste pas non plus aux puissances étrangères : alors qu'il se dresse contre les partisans de la révolution et de la république, dissout le parlement et se prépare à restaurer la monarchie, il doit capituler face à la pression des puissances étrangères et accepter même les « 21 requêtes » du Japon, qui menacent de transformer la Chine en un protectorat de ce « petit État insulaire ».
Ayant provoqué la déception des Chinois, Yuan voit monter la résistance autour de lui. La province du Yunnan proclame son indépendance, suivie bientôt de deux autres provinces du Sud. La guerre civile menace de nouveau d'éclater, entraînant la division du pays. Or la Chine semble avoir une fois encore
de la chance : Yuan Shikai meurt le 16 juin 1916. Mais il s'avère rapidement qu'avec lui meurt la possible unité de la Chine. Plus personne ne dispose de suffisamment de pouvoir et d'autorité politique pour défendre avec succès l'unité à l'intérieur et à l'extérieur. Le pays se fractionne en différentes régions, souvent gouvernées par des militaires les « seigneurs de la guerre », qui sont généralement des officiers de l'armée de Yuan Shikai.

«
le
chef du guomindang Tchang Kaï-chek,
« héritier» politique de Sun Vat-sen
En août 1912, le parti populaire
national (guomindang), né de la fusion
de plusieurs groupes révolutionnaires,
constitue un important réservoir de
réformateurs.
Ses chefs devront
pourtant rapidement se réfugier dans la
clandestinité ou à l'étr anger pour
échapper aux persécutions de Yuan
Shikai.
Étant donné qu'il n'existe pas de
pouvoir unique, Sun Yat-sen, à son
retour du Japon, commence par s'allier
aux petits seigneurs de la guerre du
Guangdong.
Le contre-gouvernement
qu'il forme à Canton se heurte d'emblée
à de nombreuses difficultés, d'une part
en raison de sa propre faiblesse et du
manque de sérieux de ses alliés, d'autre
part à cause de l'attitude des puissances
occidentales, qui préfèrent soutenir les
forces de l'ancien régime qui ne
remettent pas en cause leurs intérêts
dans le pays.
Le vent commence à tourner lorsque le
nouveau régime soviétique, désireux de
rompre son isolement international et de
se faire des alliés, propose à Sun Yat-sen
et à son parti un soutien logistique et
militaire.
Le 26 janvier 1923, Sun Yat-sen
et l'envoyé soviétique Adolf A.
Joffe
décident de collaborer à la création d'un
parti organisé de façon stricte et d'une
armée puissante.
En contrepartie, Sun
Yat-sen s'engage à coopérer avec le parti
communiste de Chine qui vient d'être
créé et d'accepter 300 communistes au
sein du guomindang.
En mai 1924, Tchang Kaï-chek est nommé
commandant de la nouvelle
armée équipée avec des armes
soviétiques, et dont les officiers sont
passés par la nouvelle académie militaire
de Whampoa.
De 1908 à 1910, il s'était
préparé à Tokyo à une carrière militaire.
Il adhère alors à l'or ganisation d'où
naîtra le guomindang, la Ligue Jurée, et
rencontre pour la première fois Sun Vat
sen, dans l'entourage duquel il achèvera
sa propre ascension.
De retour en Chine
en 1915, Tchang rejoint Sun Yat-sen et
l'aide à bâtir une nouvelle organisation
du pouvoir.
En 1923, ce dernier le
nomme chef d'état major.
En août,
Tchang passe trois mois à Moscou, où il
négocie la poursuite de la coopération
militaire.
De nouveau en Chine, il
reprend en main l'académie militaire de
Whampoa, dont les cadets formeront
bientôt la colonne vertébrale du corps
des officiers du guomindang.
Avec l'aide de la nouvelle armée,
Tchang Kaï-chek apparaît à la mort de
Sun Y at-sen comme l'homme le plus fort
du parti.
En été 1926, au début de la
campagne vers le Nord, qui a pour
objectif la mise au pas des seigneurs de
la guerre et l'unification de la Chine, il
devient généralissime de l'armée
révolutionnaire nationale.
Dès le début,
la campagne est un succès : soutenues
par les communistes qui mobilisent les
paysans contre les seigneurs de la
guerre, les troupes révolutionnaires avancent
sans rencontrer de résistance.
En mars 1927, la première phase de la
campagne du Nord s'achève par la prise
des villes de Nankin et de Shanghai.
Un
mois plus tard, Tchang se retourne
contre ses alliés communistes : conscient
de sa nouvelle force et les soupçonnant
de noyauter le guomindang, il veut
endiguer leur influence croissante et
préparer ainsi le soutien des natio
nalistes par les puissances occidentales.
Des milliers de communistes sont alors
arrêtés et exécutés et leurs organisations
détruites.
Le 10 octobre, Tchang forme à
Nankin un gouvernement national, pour
se démarquer d'un gouvernement
proclamé peu avant à Wuhan par
d'autres membres du guomindang.
Au début de l'année 1928, la
deuxième phase de la campagne vers le
Nord commence, orientée cette fois
contre Zhang Zuolin, l'homme fort du
gouvernement de Pékin.
Au début de
l'année, Tchang reprend le commande
ment des forces républicaines.
La chute
de Pékin en juillet 1928 marque la
victoire définitive sur les seigneurs de la
guerre.
Pour la première fois depuis la
fin de la monarchie en 1911, le pays est
de nouveau unifié et le drapeau des
nationalistes flotte sur toute la Chine.
Tchang Kaï-chek devient président du
gouvernement national.
Mais, de
nouveaux dangers menacent déjà l'unité
de la Chine à peine reconquise.
l'envoyé soviétique Adolf A.
Joffe (à gauche), ici en compagnie de son compatriote, le négociateur
Dombski, doit aider à améliorer les relations entre la Chine et l'URSS.
113.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'unité nationale dans la Constitution de 1958
- État récent, partie de l'héritage bourguignon, la Belgique, sans unité géographique, sans vrai relief, sans frontières naturelles, a dû forger son unité nationale.
- Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale [GIGN] 1 PRÉSENTATION Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale [GIGN], unité d'élite de la gendarmerie nationale.
- Le combat du guomindang
- De Gaulle et l'unité nationale