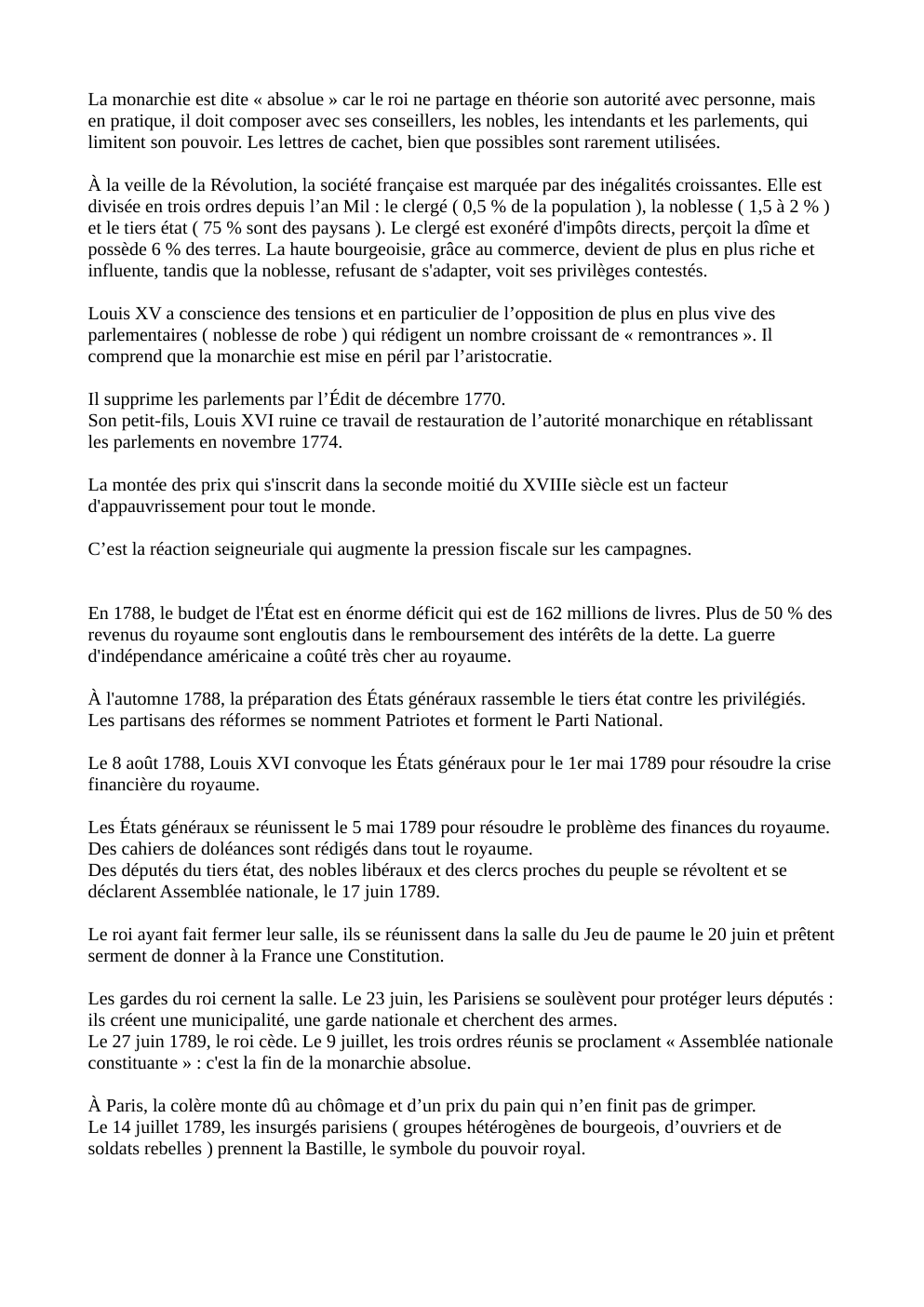La Révolution et l'Empire
Publié le 02/03/2025
Extrait du document
«
La monarchie est dite « absolue » car le roi ne partage en théorie son autorité avec personne, mais
en pratique, il doit composer avec ses conseillers, les nobles, les intendants et les parlements, qui
limitent son pouvoir.
Les lettres de cachet, bien que possibles sont rarement utilisées.
À la veille de la Révolution, la société française est marquée par des inégalités croissantes.
Elle est
divisée en trois ordres depuis l’an Mil : le clergé ( 0,5 % de la population ), la noblesse ( 1,5 à 2 % )
et le tiers état ( 75 % sont des paysans ).
Le clergé est exonéré d'impôts directs, perçoit la dîme et
possède 6 % des terres.
La haute bourgeoisie, grâce au commerce, devient de plus en plus riche et
influente, tandis que la noblesse, refusant de s'adapter, voit ses privilèges contestés.
Louis XV a conscience des tensions et en particulier de l’opposition de plus en plus vive des
parlementaires ( noblesse de robe ) qui rédigent un nombre croissant de « remontrances ».
Il
comprend que la monarchie est mise en péril par l’aristocratie.
Il supprime les parlements par l’Édit de décembre 1770.
Son petit-fils, Louis XVI ruine ce travail de restauration de l’autorité monarchique en rétablissant
les parlements en novembre 1774.
La montée des prix qui s'inscrit dans la seconde moitié du XVIIIe siècle est un facteur
d'appauvrissement pour tout le monde.
C’est la réaction seigneuriale qui augmente la pression fiscale sur les campagnes.
En 1788, le budget de l'État est en énorme déficit qui est de 162 millions de livres.
Plus de 50 % des
revenus du royaume sont engloutis dans le remboursement des intérêts de la dette.
La guerre
d'indépendance américaine a coûté très cher au royaume.
À l'automne 1788, la préparation des États généraux rassemble le tiers état contre les privilégiés.
Les partisans des réformes se nomment Patriotes et forment le Parti National.
Le 8 août 1788, Louis XVI convoque les États généraux pour le 1er mai 1789 pour résoudre la crise
financière du royaume.
Les États généraux se réunissent le 5 mai 1789 pour résoudre le problème des finances du royaume.
Des cahiers de doléances sont rédigés dans tout le royaume.
Des députés du tiers état, des nobles libéraux et des clercs proches du peuple se révoltent et se
déclarent Assemblée nationale, le 17 juin 1789.
Le roi ayant fait fermer leur salle, ils se réunissent dans la salle du Jeu de paume le 20 juin et prêtent
serment de donner à la France une Constitution.
Les gardes du roi cernent la salle.
Le 23 juin, les Parisiens se soulèvent pour protéger leurs députés :
ils créent une municipalité, une garde nationale et cherchent des armes.
Le 27 juin 1789, le roi cède.
Le 9 juillet, les trois ordres réunis se proclament « Assemblée nationale
constituante » : c'est la fin de la monarchie absolue.
À Paris, la colère monte dû au chômage et d’un prix du pain qui n’en finit pas de grimper.
Le 14 juillet 1789, les insurgés parisiens ( groupes hétérogènes de bourgeois, d’ouvriers et de
soldats rebelles ) prennent la Bastille, le symbole du pouvoir royal.
La Révolution gagne le reste du royaume : les grandes villes françaises suivent l'exemple de Paris,
comme le pillage de l’hôtel de ville de Strasbourg, le 21 juillet 1789.
Puis « la grande peur » gagne les campagnes.
Des rumeurs qui poussent les paysans à lutter contre
des pillards envoyé par les nobles.
Ils dérigent ensuite leur colère vers les nobles, pillant parfois les
châteaux et réclamant « les terriers.
»
Avec les députés de la noblesse et du clergé, ils votent l'abolition des privilèges dans la nuit du 4
août 1789 : c'est la fin de la société d'ordres.
Le vote de l’abolition des privilèges intervient dans en
urgence pour éteindre l’incendie d’une « prise de la Bastille » des campagnes française.
Le 5
octobre 1789, contraint et forcé, Louis XVI valide le vote du 4 août.
Le 21 décembre 1789, une loi est votée afin de mettre en vente l’ensemble des biens du clergé.
Dans le même temps, une nouvelle monnaie papier voit le jour.
Ces billets sont assignés
( gagés ) sur la vente des biens du clergé.
On va donc les appeler les Assignats.
La suppression de la fiscalité d’Ancien Régime
qui se déroule de 1789 à 1791 amène à la mise en place d’un nouveau système présenté comme
universel et égalitaire.
En réalité, la pression de la guerre aboutit à la mise en place d’une fiscalité
brutale et invasive.
Le 21 octobre 1790, l’assemblée nationale décide que le drapeau national sera désormais blanc avec
un quartier bleu, un blanc et un autre rouge.
Le blanc est alors associé à la France et non au roi.
Les députés qui composent l’Assemblée nationale constituante souhaitent
majoritairement conserver le régime monarchique, une fois devenu constitutionnel.
La Constitution de 1791 est basée sur la séparation des pouvoirs entre le roi et l'Assemblée, élue au
suffrage censitaire indirect.
Le roi garde le pouvoir exécutif et un droit de veto suspensif.
Il peut suspendre une loi pendant 4
ans.
En tentant de fuir le royaume en juin 1791, Louis XVI perd la confiance du peuple parisien, tout
comme l'Assemblée lorsqu'elle tente de protéger le roi.
Le 20 avril 1792, la France entre en guerre contre une coalition de monarchies européennes
composée autour du Saint-Empire.
Le 25 avril 1792, Claude Joseph Rouget de Lisle, officier français compose un chant de marche
pour l’armée du Rhin.
Il deviendra La Marseillaise.
Le 25 juillet 1792, le général prussien Charles-Guillaume-Ferdinand duc de Brunswick adresse une
proclamation au peuple de Paris.
Il menace les Parisiens de lourdes représailles si la famille royale
est mal traitée.
À Paris.
Les Sans-culottes enfiévrés, trouvent la justice trop clémente.
Du 3 au 6 septembre 1792,
ce sont les massacres de septembre.
Ils forcent l’entrée des prisons parisiennes et massacrent les nobles et les ecclésiastiques qu’ils y
trouvent.
La Convention proclame en effet l’abolition de la royauté, le 21 septembre 1792 après la victoire
française de Valmy.
Le 25 septembre 1792, la Première République est proclamée.
La nouvelle assemblée, la Convention, est composée de bourgeois républicains.
Les Brissotins sont
des républicains modérés.
Ils siègent à droite de l’assemblée.
Les Montagnards sont les plus
révolutionnaires.
Ils siègent à gauche à l’assemblée.
Entre ces deux groupes, une masse de députés
indécis forme ce que l’on appelle « le marais ».
De septembre 1792 à mai 1793, les Brissotins sont au pouvoir.
Le 3 décembre 1792, Maximilien de
Robespierre fait un discours enflammé dans lequel il déclare : « Louis doit mourir parce qu’il faut
que la patrie vive ».
Le 21 janvier 1793, Louis XVI est guillotiné sur la place de la Révolution.
Les défaites militaires du
printemps 1793 vont amener à la chute des Brissotins.
Leurs chefs sont arrêtés le 2 juin 1793.
À partir de juillet 1793, les Montagnards disposent du pouvoir et établissent un gouvernement
révolutionnaire dirigé par un groupe d’une dizaine de membres élus par la
Convention : le Comité de salut public.
Le 10 octobre 1793, la constitution est suspendue.
Ce groupe est dominé par deux fortes
personnalités : Louis Antoine de Saint-Just et Maximilien de Robespierre.
Les libertés fondamentales et la Constitution sont suspendues et tous ceux qui contestent la
Révolution ou les décisions de l'Assemblée sont jugés par le Comité de salut public et exécutés.
Entre avril 1794 et le 9 thermidor, ce sont les mois de la « Grande Terreur ».
1.400 personnes sont
guillotinées à Paris en juin et juillet soit plus qu’au cours des 14 mois précédents.
Du 5 septembre 1793 au 27 juillet 1794, la Terreur a entrainé l’arrestation de 500 000
personne et l’assassinat d’environ 40 000 sur l’ensemble du territoire français.
Pres de Toulon, un très jeune capitaine issu de l’arme de l’artillerie et d’origine corse va réussir à
déloger les Anglais : Napoléon Bonaparte.
La Terreur ne se justifie plus après la victoire française de Fleurus en juin 1794.
Le 28 juillet 1794, épouvantés par les excès de la Terreur, les adversaires de Robespierre à la
Convention parviennent à faire voter contre lui mais aussi contre Saint-Just, un décret d’accusation.
Le lendemain, les deux hommes sont condamnés sans procès et guillotinés dans la foulée.
De véritables massacres sont effectués.
Jean-Baptiste Carrier à Nantes fait noyer dans la
Loire ( « La baignoire nationale » ) des milliers de suspects dont de nombreux prêtres
réfractaires entre novembre 1793 et février 1794.
Le 22 août 1795, la Convention adopte une nouvelle constitution.
Le Directoire est né, il doit empêcher toute forme de pouvoir personnel.
Enfin, le Directoire est fragilisé par une corruption qui touche de nombreux acteurs politiques et qui
aggrave les inégalités.
De nouveaux riches, essentiellement dans les grandes villes, se font connaître par leurs
extravagances.
Le 9 novembre 1799, Bonaparte tente et réussit un coup d’État.
C’est la fin du Directoire, le 11 novembre 1799 le Consulat est né.
Bonaparte mène une politique de....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L'Europe centrale au temps de la Révolution et de l'Empire par F.
- La Révolution et l'Empire par François Furet De ce que la Révolution française a des causes, il ne s'ensuit pas que son histoire tient tout entière dans ces causes.
- Les Temps Modernes LE MOUVEMENT DES LUMIÈRES, LA RÉVOLUTION ET LE PREMIER EMPIRE : L'ASPIRATION A LA LIBERTÉ ET A L'ÉGALITÉ I.
- Les Temps Modernes LE MOUVEMENT DES LUMIÈRES, LA RÉVOLUTION ET LE PREMIER EMPIRE : L'ASPIRATION A LA LIBERTÉ ET A L'ÉGALITÉ Les Lumières sont un mouvement qui traverse tout le 18ème mais qui n'est pas limité à la France, même si les plus grands philosophes sont français.
- Dupont de l'Étang (Pierre Antoine , comte), 1765-1840, né à Chabanais (Charente), général français qui s'illustra sous la Révolution et l'Empire à Valmy, à Marengo, à Ulm, à Friedland, mais fut destitué pour avoir signé la capitulation de Bailén lors de la guerre d'Espagne (1808).