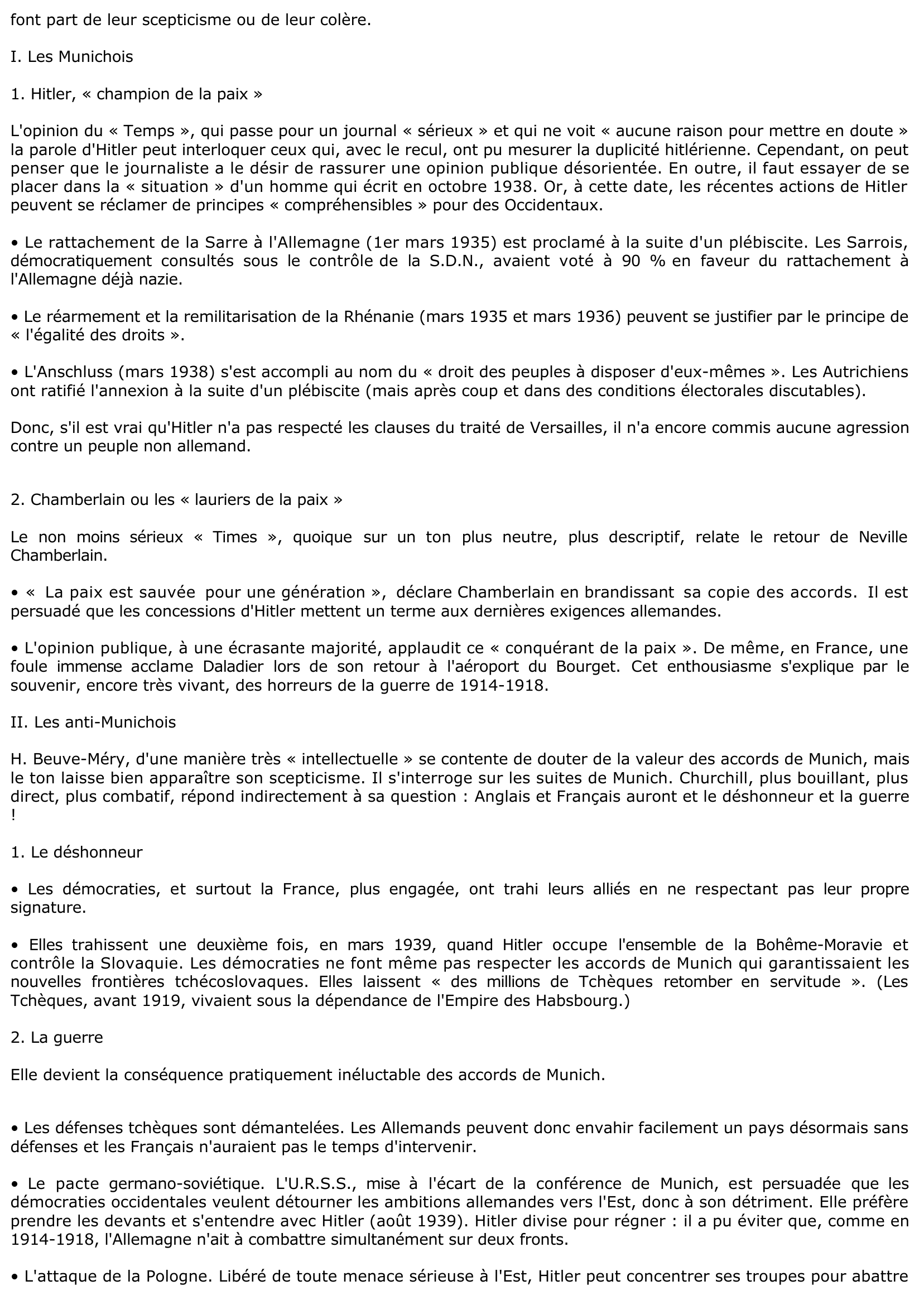La crise de Munich (29-30 septembre 1938) - Histoire
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
Document n° 1
H. Beuve-Méry, journaliste et écrivain, fondateur du « Monde « au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, écrit en octobre 1938 :
« La France vient de manquer à la face du Monde à des promesses mille fois répétées, et répétées par tous. Elle Ta fait pour sauver la paix. L'intention est louable et l'excuse plus que suffisante. Mais à une condition : que la paix soit effectivement assurée. Si demain des millions de Tchèques retombent en servitude, si le maintien de la paix apparaît comme plus onéreux encore qu'il n'était hier, la France aura trahi, purement et simplement. Et l'échec politique s'aggravera du déshonneur. «
Document n° 2
Churchill, au lendemain de Munich :
« Français et Anglais avaient le choix entre le déshonneur ou la guerre, ils ont choisi le déshonneur et ils auront la guerre. «
Document n° 3
Le journal « Le Temps « écrivait pour sa part : « M. Hitler s'est souvent, en public et dans le privé, posé en champion de la paix... On n'a aucune raison de mettre sa parole en doute. «
Document n° 4
Le journal londonien « Times « publiait le 1er octobre 1938 : « Aucun conquérant revenant d'une victoire remportée sur le champ de bataille n'est revenu paré de plus de lauriers que M. Chamberlain hier à son retour de Munich. «
Questions :
1. Rappeler en quelques lignes quel était l'enjeu de la crise de Munich.
2. Quel état d'esprit traduisent les documents 3 et 4 ? Comment l'expliquez-vous ?
3. Pourquoi H. Beuve-Méry et Churchill parlent-ils de déshonneur ? L'avenir leur donnera-t-il raison ?
analyse du sujet
• Sujet fort classique, un des plus fréquemment proposés chaque année, sous des formes variées. Un tel sujet ne demande qu'une connaissance des principaux faits de politique internationale entre 1935 et 1939.
• Seule l'analyse des textes 3 et 4 exige du candidat une certaine subtilité. Il faut éviter de juger trop sévèrement les journalistes de l'époque. Ils ne font que reprendre une opinion très largement répandue et partagent un espoir que chacun exprimait sans doute avec d'autant plus de conviction qu'il en sentait la fragilité.
«
font part de leur scepticisme ou de leur colère.
I.
Les Munichois
1.
Hitler, « champion de la paix »
L'opinion du « Temps », qui passe pour un journal « sérieux » et qui ne voit « aucune raison pour mettre en doute »la parole d'Hitler peut interloquer ceux qui, avec le recul, ont pu mesurer la duplicité hitlérienne.
Cependant, on peutpenser que le journaliste a le désir de rassurer une opinion publique désorientée.
En outre, il faut essayer de seplacer dans la « situation » d'un homme qui écrit en octobre 1938.
Or, à cette date, les récentes actions de Hitlerpeuvent se réclamer de principes « compréhensibles » pour des Occidentaux.
• Le rattachement de la Sarre à l'Allemagne (1er mars 1935) est proclamé à la suite d'un plébiscite.
Les Sarrois,démocratiquement consultés sous le contrôle de la S.D.N., avaient voté à 90 % en faveur du rattachement àl'Allemagne déjà nazie.
• Le réarmement et la remilitarisation de la Rhénanie (mars 1935 et mars 1936) peuvent se justifier par le principe de« l'égalité des droits ».
• L'Anschluss (mars 1938) s'est accompli au nom du « droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ».
Les Autrichiensont ratifié l'annexion à la suite d'un plébiscite (mais après coup et dans des conditions électorales discutables).
Donc, s'il est vrai qu'Hitler n'a pas respecté les clauses du traité de Versailles, il n'a encore commis aucune agressioncontre un peuple non allemand.
2.
Chamberlain ou les « lauriers de la paix »
Le non moins sérieux « Times », quoique sur un ton plus neutre, plus descriptif, relate le retour de NevilleChamberlain.
• « La paix est sauvée pour une génération », déclare Chamberlain en brandissant sa copie des accords.
Il estpersuadé que les concessions d'Hitler mettent un terme aux dernières exigences allemandes.
• L'opinion publique, à une écrasante majorité, applaudit ce « conquérant de la paix ».
De même, en France, unefoule immense acclame Daladier lors de son retour à l'aéroport du Bourget.
Cet enthousiasme s'explique par lesouvenir, encore très vivant, des horreurs de la guerre de 1914-1918.
II.
Les anti-Munichois
H.
Beuve-Méry, d'une manière très « intellectuelle » se contente de douter de la valeur des accords de Munich, maisle ton laisse bien apparaître son scepticisme.
Il s'interroge sur les suites de Munich.
Churchill, plus bouillant, plusdirect, plus combatif, répond indirectement à sa question : Anglais et Français auront et le déshonneur et la guerre!
1.
Le déshonneur
• Les démocraties, et surtout la France, plus engagée, ont trahi leurs alliés en ne respectant pas leur propresignature.
• Elles trahissent une deuxième fois, en mars 1939, quand Hitler occupe l'ensemble de la Bohême-Moravie etcontrôle la Slovaquie.
Les démocraties ne font même pas respecter les accords de Munich qui garantissaient lesnouvelles frontières tchécoslovaques.
Elles laissent « des millions de Tchèques retomber en servitude ».
(LesTchèques, avant 1919, vivaient sous la dépendance de l'Empire des Habsbourg.)
2.
La guerre
Elle devient la conséquence pratiquement inéluctable des accords de Munich.
• Les défenses tchèques sont démantelées.
Les Allemands peuvent donc envahir facilement un pays désormais sansdéfenses et les Français n'auraient pas le temps d'intervenir.
• Le pacte germano-soviétique.
L'U.R.S.S., mise à l'écart de la conférence de Munich, est persuadée que lesdémocraties occidentales veulent détourner les ambitions allemandes vers l'Est, donc à son détriment.
Elle préfèreprendre les devants et s'entendre avec Hitler (août 1939).
Hitler divise pour régner : il a pu éviter que, comme en1914-1918, l'Allemagne n'ait à combattre simultanément sur deux fronts.
• L'attaque de la Pologne.
Libéré de toute menace sérieuse à l'Est, Hitler peut concentrer ses troupes pour abattre.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- MUNICH (29 et 30 septembre 1938) (histoire).
- MUNICH (29 et 30 septembre 1938) - Histoire
- 1938 Septembre dans le monde (histoire chronologique)
- 29-30 septembre 1938: Les accords de Munich
- Les accords de Munich (29-30 septembre 1938)