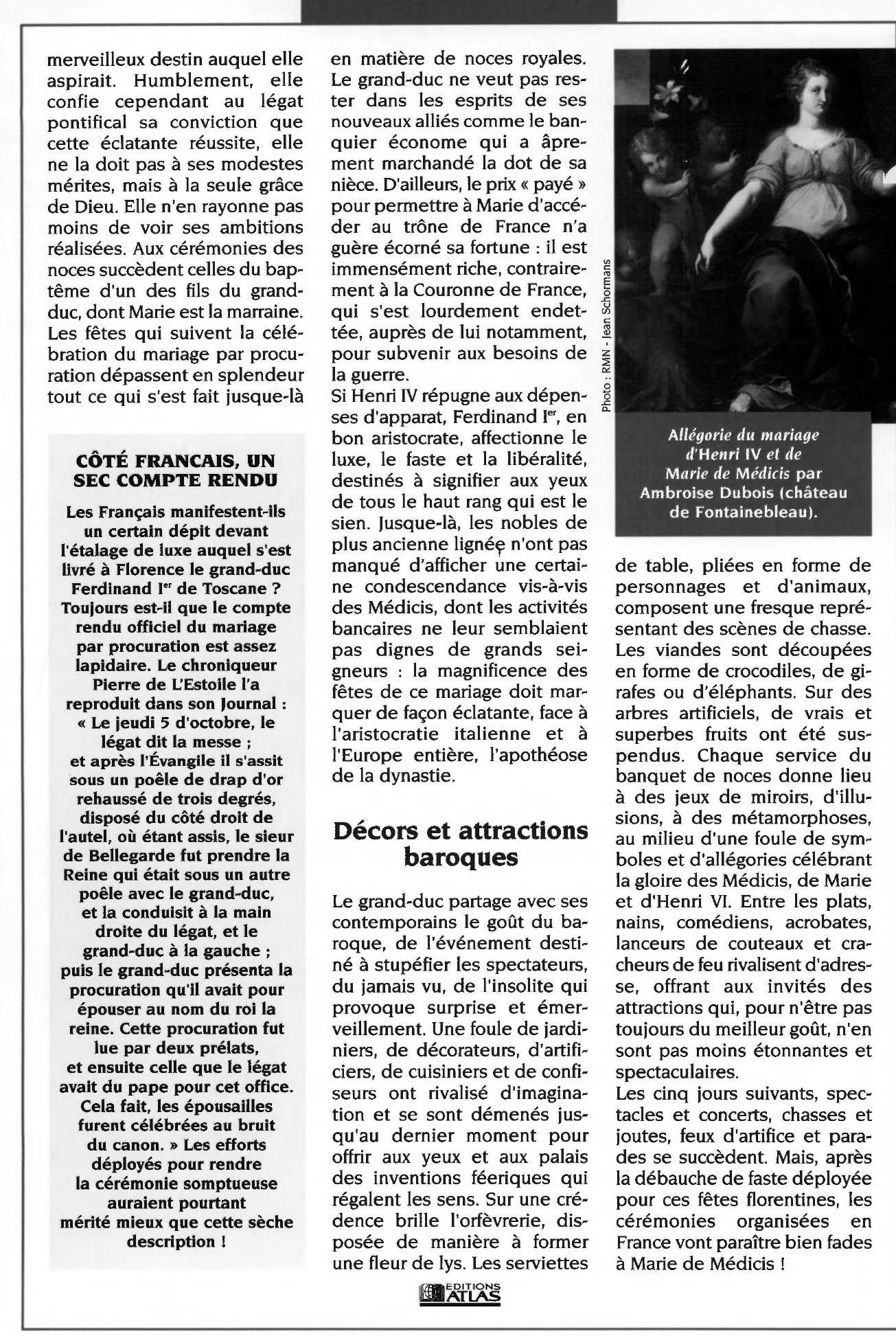Henri IV et Marie de Médicis : Le mariage de Florence
Publié le 25/08/2013
Extrait du document
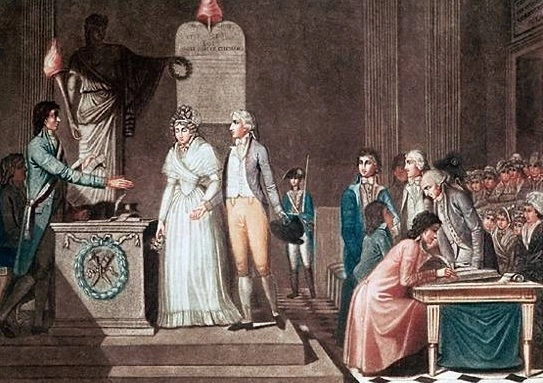
Le protocole n'autorisant pas un roi de France à aller chercher sa promise, c'est par procuration que Marie de Médicis va épouser Henri IV le 5 octobre 1600 à Florence.
L'oncle de la mariée, le grand-duc Ferdinand ler de Toscane, donnera pour l'occasion des fêtes extraordinaires, telles qu'on n'en a jamais vues jusque-là.
A près de longues négocia-ri fions, le contrat de mariage d'Henri IV et de Marie de Médicis, la nièce du grand-duc Ferdinand Ier de Toscane, a enfin été signé, le 25 avril 1600. Il s'ensuit des échanges de présents et de correspondance, mais le protocole veut qu'un souverain ne se rende pas chez sa future femme pour l'épouser : elle doit lui être amenée déjà mariée par procuration. Le Béarnais envoie donc à Florence une brillante représentation composée des plus éminents gentilshommes de la Cour, conduits par son grand écuyer, messire Roger de Bellegarde.
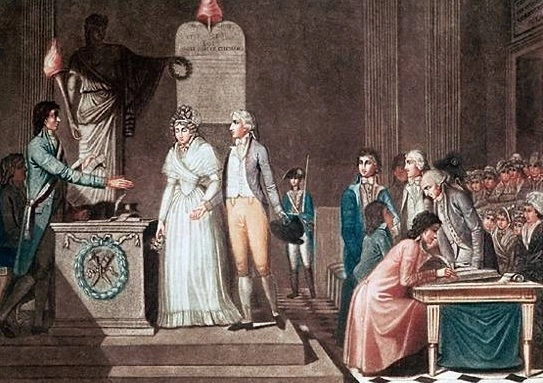
«
merveilleux destin auquel elle
aspirait .
Humblement, elle
confie cependant au légat
pontifical sa conviction que
cette éclatante réussite, elle
ne la doit pas à ses modestes
mérites, mais à la seule grâce
de Dieu .
Elle n'en rayonne pas
moins de voir ses ambitions
réalisées.
Aux cérémonies des
noces succèdent celles du bap
tême d'un des fils du grand
duc , dont Marie est la marraine.
Les fêtes
qui suivent la célé
bration du mariage par procu
ration dépassent en splendeur
tout ce qui s'est fait jusque-là
CÔTÉ FRANCAIS, UN
SEC COMPTE RENDU
Les Français manifestent-ils
un
certain dépit devant
l'étalage de luxe auquel s'est livré à Florence le grand -duc
Ferdinand l°' de Toscane ? Toujours est-il que le compte
rendu officiel du mariage
par procuration est assez
lapidaire.
Le chroniqueur Pierre de L'Estoile l'a
reproduit dans son Journal : « Le jeudi 5 d' octobre, le
légat dit la messe ; et après l'Évangile il s'assit ·sous un poêle de drap d'or
rehaussé de trois degrés,
disposé du côté droit de l'autel, où étant assis, le sieur
de Bellegarde fut prendre la
Reine qui était sous un autre poêle avec le grand-duc,
et la conduisit à la main droite du légat, et le
grand-duc à la gauche ;
puis le
grand-duc présenta la
procuration qu'il avait pour
épouser au nom du roi la
reine.
Cette procuration fut
lue par deux prélats ,
et ensuite celle que le légat
avait du pape pour cet office.
Cela fait,
les épousailles
furent célébrées au bruit
du canon.
» Les efforts
déployés pour rendre
la cérémonie somptueuse
auraient pourtant
mérité mieux que cette sèche description !
en matière de noces royales.
Le
grand-duc ne veut pas res
ter dans les esprits de ses
nouveaux alliés comme le ban
quier économe qui a âpre
ment marchandé la dot de sa
nièce.
D'ailleurs, le prix « payé »
pour permettre à Marie d'accé
der au trône de France n'a
guère écorné sa fortune : il est
immensément riche, contraire- ~ E ment à la Couronne de France , o ii qui s'est lourdement endet- ';;
tée, auprès de lui notamment, ~
pour subvenir aux besoins de ~
la guerre.
"' 0 Si Henri IV répugne aux dépen- ]
ses d'apparat, Ferdinand 1e r, en o..
bon aristocrate, affectionne le
luxe, le faste et la libéralité,
destinés à signifier aux yeux
de tous le haut rang qui est le
sien .
Jusque-là, les nobles de
plus ancienne lignér n'ont pas
manqué d'afficher une certai
ne condescendance vis-à-vis
des Médicis, dont les activités
bancaires ne leur semblaient
pas dignes de grands sei
gneurs : la magnificence des
fêtes de ce mariage doit mar
quer de façon éclatante, face à
l'aristocratie italienne et à
l'Europe entière , l'apothéose
de la dynastie .
Décors et attractions
baroques
Le grand-duc partage avec ses
contemporains le goût du ba
roque , de l'événement desti
né à stupéfier les spectateurs,
du jamais vu, de l'insolite qui
provoque surprise et émer
veillement .
Une foule de jardi
niers, de décorateurs, d'artifi
ciers, de cuisiniers et de confi
seurs ont rivalisé d'imagina
tion et se sont démenés jus
qu'au dernier moment pour
offrir aux yeux et aux palais
des inventions féeriques qui
régalent les sens .
Sur une cré
dence brille l'orfèvrerie, dis
posée de manière à former
une fleur de lys.
Les serviettes
~ED ITIONS llilal ATLAS
de table, pliées en forme de
personnages et d'animaux,
composent une fresque repré
sentant des scènes de chasse .
Les
viandes sont découpées
en forme de crocodiles, de gi
rafes ou d 'éléphants.
Sur des
arbres artificiels, de vrais et
superbes fruits ont été sus
pendus.
Chaque service du
banquet de noces donne lieu
à des jeux de miroirs, d'illu
sions, à des métamorphoses,
au milieu d'une foule de sym
boles et d'allégories célébrant
la gloire des Médicis, de Marie
et d'Henri VI.
Entre les plats,
nains,
comédiens, acrobates,
lanceurs
de couteaux et cra
cheurs de feu rivalisent d'adres
se, offrant aux invités des
attractions qui, pour n'être pas
toujours du meilleur goût, n'en
sont pas moins étonnantes et
spectaculaires.
Les
cinq jours suivants, spec
tacles et concerts, chasses et
joutes, feux d'artifice et para
des se succèdent.
Mais, après
la
débauche de faste déployée
pour ces fêtes florentines, les
ceremonies organisées en
France vont paraître bien fades
à
Marie de Médicis !.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- 1600 Bénédiction du mariage d'Henri IV et de Marie de Médicis.
- CONCINI, dit le Maréchal d'Ancre (1575-1617) Né en Toscane, il suit Marie de Médicis lors de son mariage avec Henri IV et épouse Léonora Galigaï, soeur de lait de la reine.
- 1600 Bénédiction du mariage d'Henri IV et de Marie de Médicis.
- CONCINI, dit le Maréchal d'Ancre (1575-1617) Né en Toscane, il suit Marie de Médicis lors de son mariage avec Henri IV et épouse Léonora Galigaï, s?
- Le mariage d'Henri IV et de Marie de Médicis Un mariage de raison.