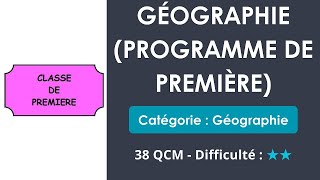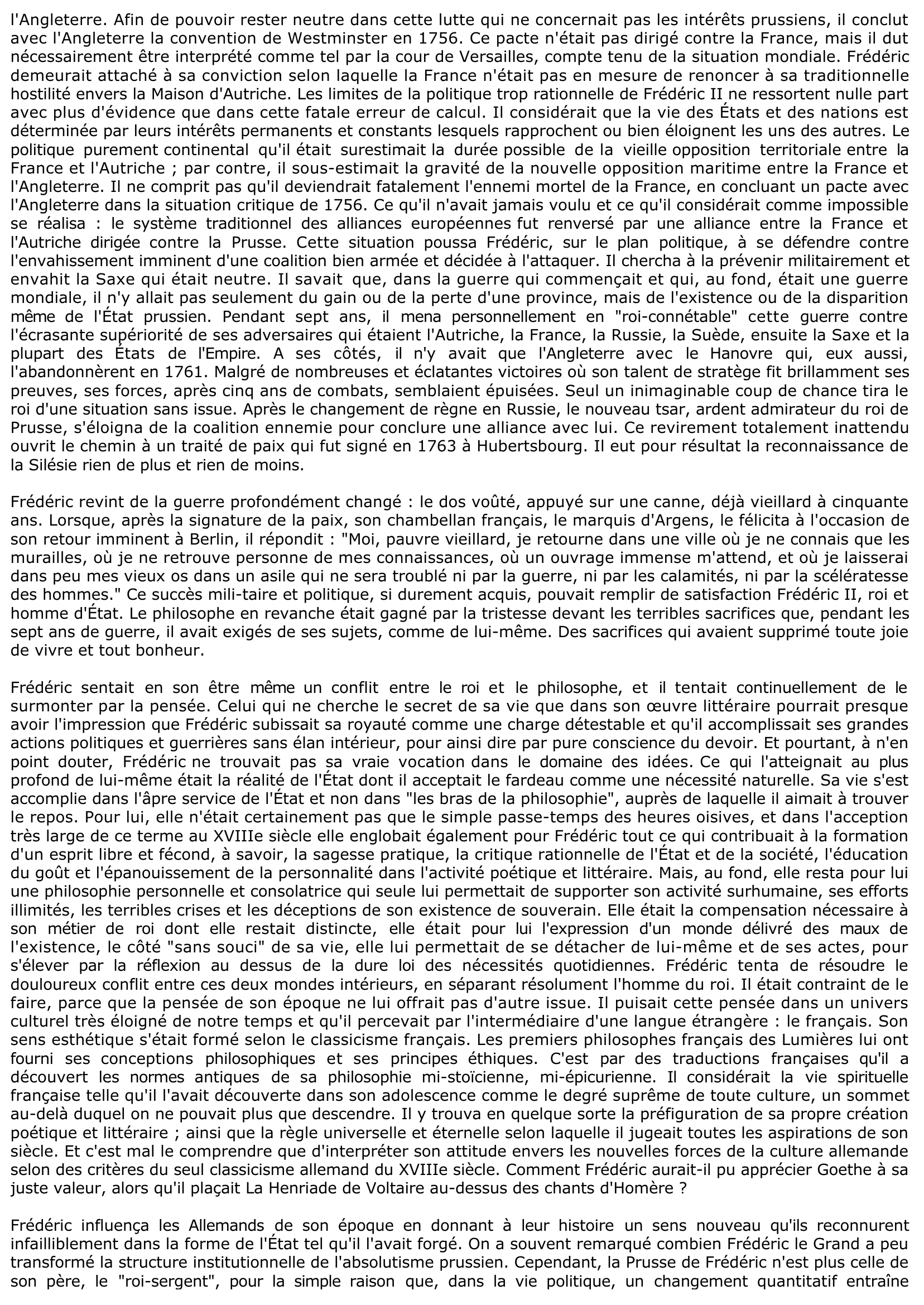Frédéric II le Grand (Histoire)
Publié le 22/02/2012
Extrait du document


«
l'Angleterre.
Afin de pouvoir rester neutre dans cette lutte qui ne concernait pas les intérêts prussiens, il conclutavec l'Angleterre la convention de Westminster en 1756.
Ce pacte n'était pas dirigé contre la France, mais il dutnécessairement être interprété comme tel par la cour de Versailles, compte tenu de la situation mondiale.
Frédéricdemeurait attaché à sa conviction selon laquelle la France n'était pas en mesure de renoncer à sa traditionnellehostilité envers la Maison d'Autriche.
Les limites de la politique trop rationnelle de Frédéric II ne ressortent nulle partavec plus d'évidence que dans cette fatale erreur de calcul.
Il considérait que la vie des États et des nations estdéterminée par leurs intérêts permanents et constants lesquels rapprochent ou bien éloignent les uns des autres.
Lepolitique purement continental qu'il était surestimait la durée possible de la vieille opposition territoriale entre laFrance et l'Autriche ; par contre, il sous-estimait la gravité de la nouvelle opposition maritime entre la France etl'Angleterre.
Il ne comprit pas qu'il deviendrait fatalement l'ennemi mortel de la France, en concluant un pacte avecl'Angleterre dans la situation critique de 1756.
Ce qu'il n'avait jamais voulu et ce qu'il considérait comme impossiblese réalisa : le système traditionnel des alliances européennes fut renversé par une alliance entre la France etl'Autriche dirigée contre la Prusse.
Cette situation poussa Frédéric, sur le plan politique, à se défendre contrel'envahissement imminent d'une coalition bien armée et décidée à l'attaquer.
Il chercha à la prévenir militairement etenvahit la Saxe qui était neutre.
Il savait que, dans la guerre qui commençait et qui, au fond, était une guerremondiale, il n'y allait pas seulement du gain ou de la perte d'une province, mais de l'existence ou de la disparitionmême de l'État prussien.
Pendant sept ans, il mena personnellement en "roi-connétable" cette guerre contrel'écrasante supériorité de ses adversaires qui étaient l'Autriche, la France, la Russie, la Suède, ensuite la Saxe et laplupart des États de l'Empire.
A ses côtés, il n'y avait que l'Angleterre avec le Hanovre qui, eux aussi,l'abandonnèrent en 1761.
Malgré de nombreuses et éclatantes victoires où son talent de stratège fit brillamment sespreuves, ses forces, après cinq ans de combats, semblaient épuisées.
Seul un inimaginable coup de chance tira leroi d'une situation sans issue.
Après le changement de règne en Russie, le nouveau tsar, ardent admirateur du roi dePrusse, s'éloigna de la coalition ennemie pour conclure une alliance avec lui.
Ce revirement totalement inattenduouvrit le chemin à un traité de paix qui fut signé en 1763 à Hubertsbourg.
Il eut pour résultat la reconnaissance dela Silésie rien de plus et rien de moins.
Frédéric revint de la guerre profondément changé : le dos voûté, appuyé sur une canne, déjà vieillard à cinquanteans.
Lorsque, après la signature de la paix, son chambellan français, le marquis d'Argens, le félicita à l'occasion deson retour imminent à Berlin, il répondit : "Moi, pauvre vieillard, je retourne dans une ville où je ne connais que lesmurailles, où je ne retrouve personne de mes connaissances, où un ouvrage immense m'attend, et où je laisseraidans peu mes vieux os dans un asile qui ne sera troublé ni par la guerre, ni par les calamités, ni par la scélératessedes hommes." Ce succès mili-taire et politique, si durement acquis, pouvait remplir de satisfaction Frédéric II, roi ethomme d'État.
Le philosophe en revanche était gagné par la tristesse devant les terribles sacrifices que, pendant lessept ans de guerre, il avait exigés de ses sujets, comme de lui-même.
Des sacrifices qui avaient supprimé toute joiede vivre et tout bonheur.
Frédéric sentait en son être même un conflit entre le roi et le philosophe, et il tentait continuellement de lesurmonter par la pensée.
Celui qui ne cherche le secret de sa vie que dans son œuvre littéraire pourrait presqueavoir l'impression que Frédéric subissait sa royauté comme une charge détestable et qu'il accomplissait ses grandesactions politiques et guerrières sans élan intérieur, pour ainsi dire par pure conscience du devoir.
Et pourtant, à n'enpoint douter, Frédéric ne trouvait pas sa vraie vocation dans le domaine des idées.
Ce qui l'atteignait au plusprofond de lui-même était la réalité de l'État dont il acceptait le fardeau comme une nécessité naturelle.
Sa vie s'estaccomplie dans l'âpre service de l'État et non dans "les bras de la philosophie", auprès de laquelle il aimait à trouverle repos.
Pour lui, elle n'était certainement pas que le simple passe-temps des heures oisives, et dans l'acceptiontrès large de ce terme au XVIIIe siècle elle englobait également pour Frédéric tout ce qui contribuait à la formationd'un esprit libre et fécond, à savoir, la sagesse pratique, la critique rationnelle de l'État et de la société, l'éducationdu goût et l'épanouissement de la personnalité dans l'activité poétique et littéraire.
Mais, au fond, elle resta pour luiune philosophie personnelle et consolatrice qui seule lui permettait de supporter son activité surhumaine, ses effortsillimités, les terribles crises et les déceptions de son existence de souverain.
Elle était la compensation nécessaire àson métier de roi dont elle restait distincte, elle était pour lui l'expression d'un monde délivré des maux del'existence, le côté "sans souci" de sa vie, elle lui permettait de se détacher de lui-même et de ses actes, pours'élever par la réflexion au dessus de la dure loi des nécessités quotidiennes.
Frédéric tenta de résoudre ledouloureux conflit entre ces deux mondes intérieurs, en séparant résolument l'homme du roi.
Il était contraint de lefaire, parce que la pensée de son époque ne lui offrait pas d'autre issue.
Il puisait cette pensée dans un universculturel très éloigné de notre temps et qu'il percevait par l'intermédiaire d'une langue étrangère : le français.
Sonsens esthétique s'était formé selon le classicisme français.
Les premiers philosophes français des Lumières lui ontfourni ses conceptions philosophiques et ses principes éthiques.
C'est par des traductions françaises qu'il adécouvert les normes antiques de sa philosophie mi-stoïcienne, mi-épicurienne.
Il considérait la vie spirituellefrançaise telle qu'il l'avait découverte dans son adolescence comme le degré suprême de toute culture, un sommetau-delà duquel on ne pouvait plus que descendre.
Il y trouva en quelque sorte la préfiguration de sa propre créationpoétique et littéraire ; ainsi que la règle universelle et éternelle selon laquelle il jugeait toutes les aspirations de sonsiècle.
Et c'est mal le comprendre que d'interpréter son attitude envers les nouvelles forces de la culture allemandeselon des critères du seul classicisme allemand du XVIIIe siècle.
Comment Frédéric aurait-il pu apprécier Goethe à sajuste valeur, alors qu'il plaçait La Henriade de Voltaire au-dessus des chants d'Homère ?
Frédéric influença les Allemands de son époque en donnant à leur histoire un sens nouveau qu'ils reconnurentinfailliblement dans la forme de l'État tel qu'il l'avait forgé.
On a souvent remarqué combien Frédéric le Grand a peutransformé la structure institutionnelle de l'absolutisme prussien.
Cependant, la Prusse de Frédéric n'est plus celle deson père, le "roi-sergent", pour la simple raison que, dans la vie politique, un changement quantitatif entraîne.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- HISTOIRE DE FRÉDÉRIC LE GRAND (résumé) de Thomas Carlyle
- HISTOIRE DE L’EMPIRE DE RUSSIE SOUS PIERRE LE GRAND. (résumé)
- ÉLECTEUR DE BRANDEBOURG Frédéric-Guillaume, dit le grand Électeur
- DAI-NIHON-SHI [Histoire du Grand Japon]. (résumé & analyse)
- Grand oral du bac : FRÉDÉRIC CHOPIN