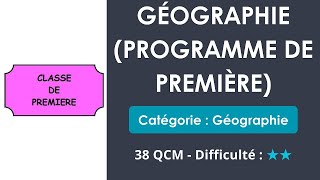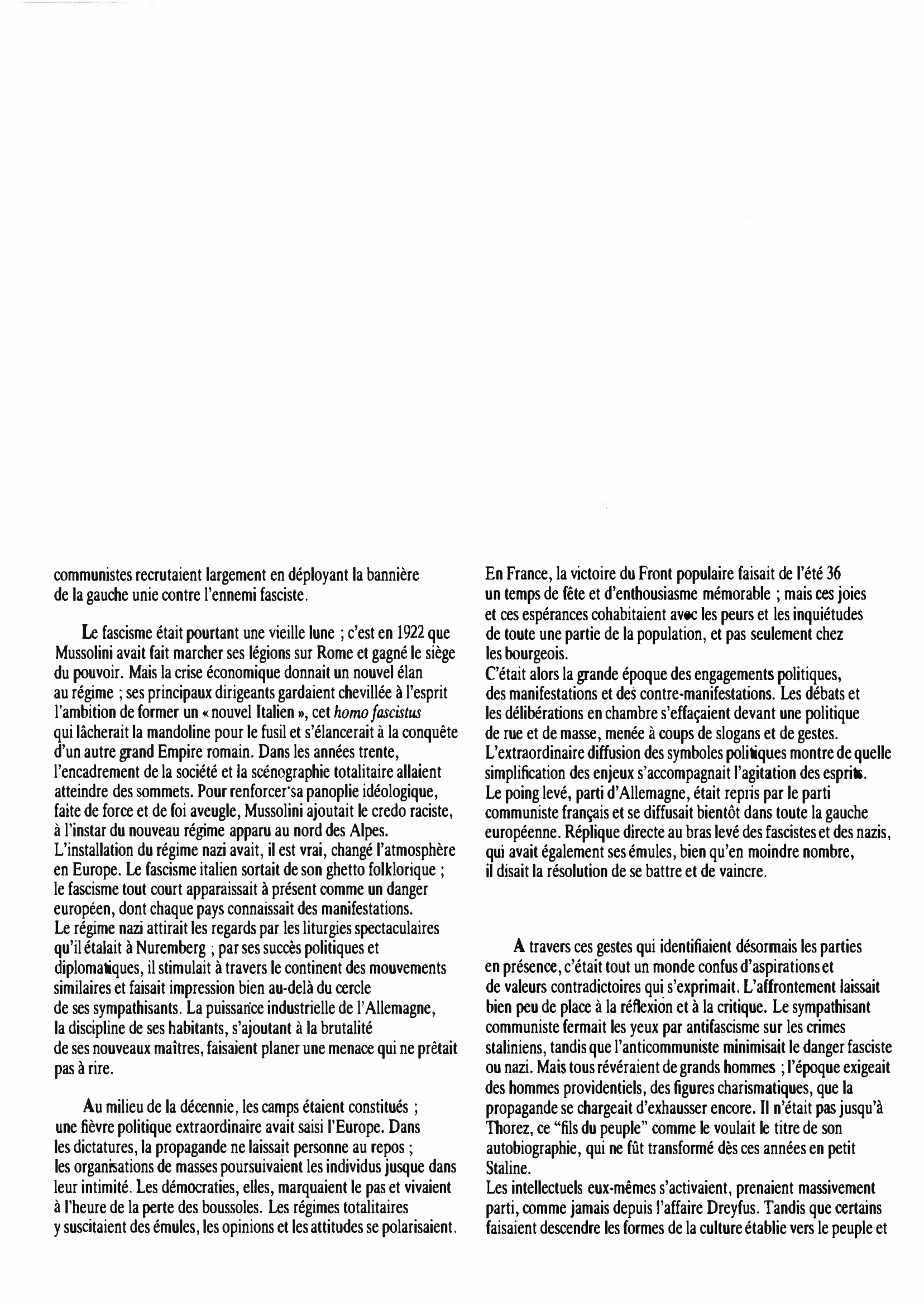Entre chien et loup, les années trente... de 1930 à 1939 : Histoire
Publié le 17/12/2018
Extrait du document

Entre chien et loup, les années trente...
Les années trente exercent une attraction qui ne faiblit pas. Notre époque de paix et de prospérité aurait-elle besoin d’un repoussoir, aurait-elle comme la nostalgie fascinée d’un temps qui fut d’amertume et de désolation, mais tout autant de passion ? Ou bien se retoume-t-on vers lui mû par une sourde inquiétude, parce qu’il a montré la fragilité de nos sociétés, les démons tapis au cœur de la civilisation occidentale, la course au suicide de tout un continent ? Cette décennie fut cruelle, qui vit les belles années de l’après-guerre s’effacer devant la crise, puis céder la place aux dressages totalitaires, aux fièvres politiques, aux angoisses d’un nouvel avant-guerre.
On l’annonçait depuis des décennies, sinon depuis un siècle : de récession en récession, la fin du capitalisme mûrissait. Mais à la fin des années vingt, le drame dépassa toutes les représentations. Le capitalisme connut la plus violente crise de son existence et nulle révolution ne s’ensuivit. Le spectacle était pourtant hallucinant de violence et d’ampleur. Des millions d’hommes avaient une fois déjà quitté leur travail : c’était une quinzaine d’années auparavant, pour répondre à l’ordre de mobilisation. Cette fois, à nouveau par millions, ils étaient jetés sur le pavé, mais ni l’armée ni la vie civile ne les attendaient : ils étaient démobilisés au beau milieu d’une impasse.
On peine à se représenter le drame qu’infligea la grande crise à des foules de personnes, tous ces gens à qui l’on avait inculqué la valeur du travail et qui se trouvaient soudain inutiles et dépourvus du nécessaire. Les allocations étaient rares et limitées ; avoir le souci du lendemain, gagner le pain pour sa famille étaient des expressions qui avaient leur plein sens. L’influence de cette épreuve sur les mentalités allait être durable. Compter ses sous, penser à l’avenir, regarder à la dépense, voilà des maximes qui dirigeraient la conduite des générations de la crise, avant que la grande prospérité des années cinquante et surtout soixante ne les use sans retour.
Mais sur le moment, la victime principale de la crise fut peut-être la foi en l’ascension sociale. L’idée était relativement neuve ; la Révolution française l’avait mise à l’ordre du jour plus d’un siècle auparavant, mais elle venait seulement de gagner l’ensemble d’une Europe où l’Ancien Régime avait tenu de solides bastions jusqu’à la Grande Guerre et ses bouleversements. La société divisée en corps et castes, la société du sang et de la naissance avaient fait leur temps ; l’espoir s’installait de voir ses enfants monter d’un échelon ou deux. La grande crise faisait soudain paraître vain cet espoir et rendait l’avenir amer, alors que le souvenir des massacres de la Grande Guerre noircissait encore le passé. Comment le libéralisme aurait-il pu en sortir indemne ? On le vit littéralement se déprécier, on vit ses défenseurs baisser la voix, ou crier dans le désert. Le libre-échange avait animé la planète de la plus belle circulation de richesses ; il répandait à présent le chômage jusque dans les recoins de la terre. L’interventionnisme ne pouvait que marquer des points : l’État devait être non seulement veilleur de nuit, mais encore banquier, entrepreneur, tuteur, protecteur et, pourquoi pas ?, dresseur des corps et des âmes.
Les régimes totalitaires s'y dirigeaient à grands pas, au nom des solutions les plus opposées. À l’est de l’Europe, le régime soviétique avait réussi, contre toute attente, à survivre depuis la fin de la guerre ; il prenait au tournant des années trente un visage de fer. L’édification des hauts fourneaux se payait de la collectivisation des campagnes ; le pouvoir d’un homme se bâtissait à grand renfort de goulags. Le stalinisme triomphait, fondé sur la peur permanente et l’éloge du chef infaillible. Paradoxalement, alors que ses victimes se comptaient par millions en URSS, le bolchevisme gagnait au milieu des années trente, à l’ouest du continent, une popularité sans précédent ; après avoir passé une décennie à combattre leurs voisins socialistes, les partis

«
communistes
recrutaient largement en déployant la bannière
de la gauche unie contre l'ennemi fasciste.
Le fascisme était pourtant une vieille lune ; c'est en 1922 que
Mussolini avait fait marcher ses légions sur Rome et gagné le siège
du pouvoir.
Mais la crise économique donnait un nouvel élan
au régime ; ses principaux dirigeants gardaient chevillée à l'esprit
l'ambition de former un« nouvel Italien», cet homo fascistus
qui lâcherait la mandoline pour le fusil et s'élancerait à la conquête
d'un autre grand Empire romain.
Dans les années trente,
l'encadrement de la société et la scénographie totalitaire allaient
atteindre des sommets.
Pour renforcer'Sa panoplie idéologique,
faite de force et de foi aveugle, Mussolini ajoutait le credo raciste,
à l'instar du nouveau régime apparu au nord des Alpes.
L'installation du régime nazi avait, il est vrai, changé l'atmosphère
en Europe.
Le fascisme italien sortait de son ghetto folklorique ;
le fascisme tout court apparaissait à présent comme un danger
européen, dont chaque pays connaissait des manifestations.
Le régime nazi attirait les regards par les liturgies spectaculaires
qu'il étalait à Nuremberg ; par ses succès politiques et
diplomatiques, il stimulait à travers le continent des mouvements
similaires et faisait impression bien au-delà du cercle
de ses sympathisants.
La puissance industrielle de l'Allemagne,
la discipline de ses habitants, s'ajoutant à la brutalité
de ses nouveaux maîtres, faisaient planer une menace qui ne prêtait
pas à rire.
Au milieu de la décennie, les camps étaient constitués ;
une fièvre politique extraordinaire avait saisi l'Europe.
Dans
les dictatures, la propagande ne laissait personne au repos ;
les organisations de masses poursuivaient les individus jusque dans
leur intimité.
Les démocraties, elles, marquaient le pas et vivaient
à l'heure de la perte des boussoles.
Les régimes totalitaires
y suscitaient des émules, les opinions et les attitudes se polarisaient.
En
France, la victoire du Front populaire faisait de l'été 36
un temps de fête et d'enthousiasme mémorable ; mais ces joies
et ces espérances cohabitaient avec les peurs et les inquiétudes
de toute une partie de la population, et pas seulement chez
les bourgeois.
C'était alors la grande époque des engagements politiques,
des manifestations et des contre-manifestations.
Les débats et
les délibérations en chambre s'effaçaient devant une politique
de rue et de masse, menée à coups de slogans et de gestes.
L'extraordinaire diffusion des symboles politiques montre de quelle
simplification des enjeux s'accompagnait l'agitation des esprits.
Le poing levé, parti d'Allemagne, était repris par le parti
communiste français et se diffusait bientôt dans toute la gauche
européenne.
Réplique directe au bras levé des fascistes et des nazis,
qui avait également ses émules, bien qu'en moindre nombre,
il disait la résolution de se battre et de vaincre.
A travers ces gestes qui identifiaient désormais les parties
en présence, c'était tout un monde confus d'aspirations et
de valeurs contradictoires qui s'exprimait.
L'affrontement laissait
bien peu de place à la réflexion et à la critique.
Le sympathisant
communiste fermait les yeux par antifascisme sur les crimes
staliniens, tandis que l'anticommuniste minimisait le danger fasciste
ou nazi.
Mais tous révéraient de grands hommes ; l'époque exigeait
des hommes providentiels, des figures charismatiques, que la
propagande se chargeait d'exhausser encore.
Il n'était pas jusqu'à
Thorez, ce "fils du peuple" comme le voulait le titre de son
autobiographie, qui ne fût transformé dès ces années en petit
Staline.
Les intellectuels eux-mêmes s'activaient, prenaient massivement
parti, comme jamais depuis l'affaire Dreyfus.
Tandis que certains
faisaient descendre les formes de la culture établie vers le peuple et.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Arts primitifs de 1930 à 1939 : Histoire
- LA Danse de 1930 à 1939 : Histoire
- Cinémas de 1930 à 1939 : Histoire
- Jazz de 1930 à 1939 : Histoire
- Théâtres de 1930 à 1939 : Histoire