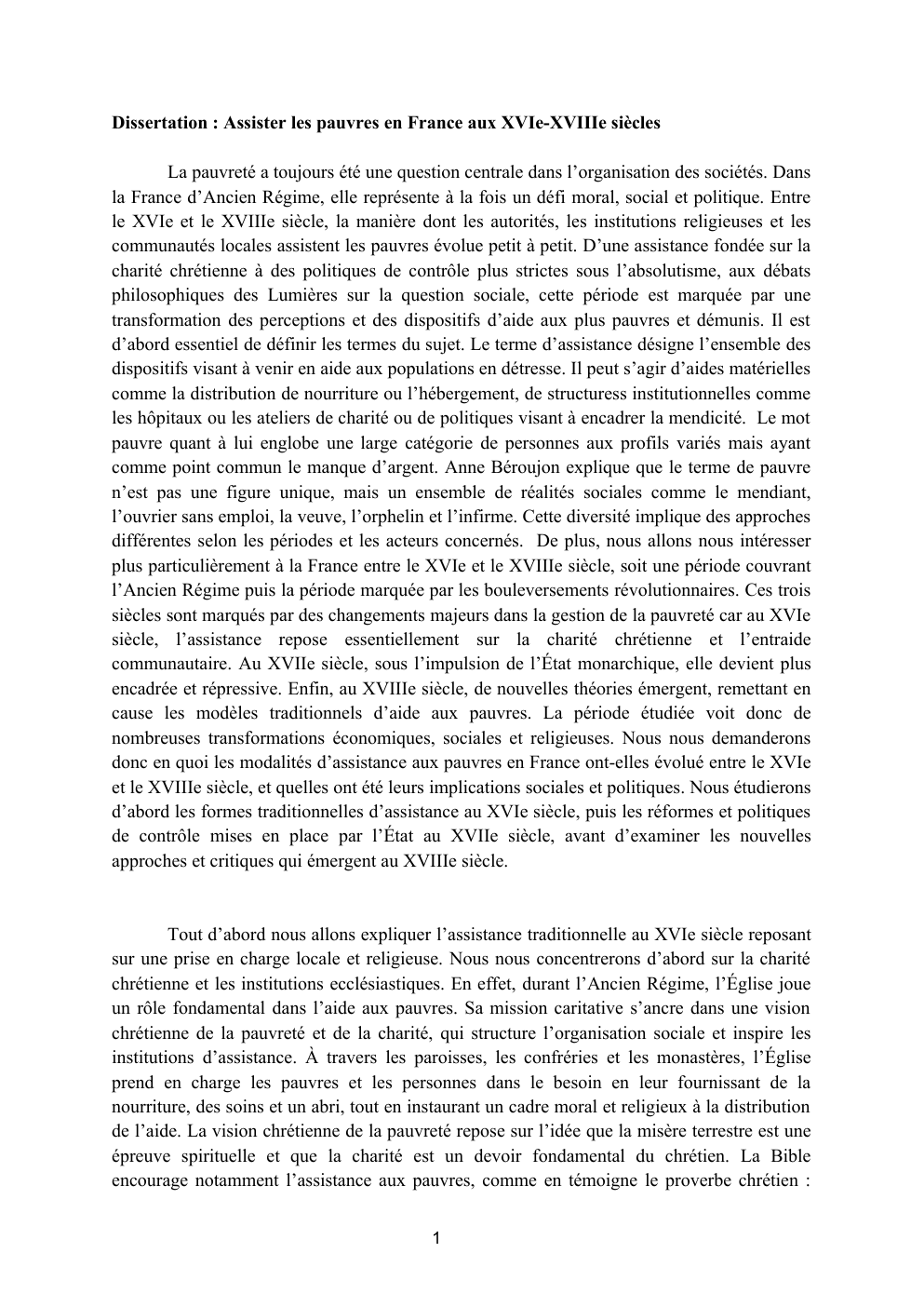Dissertation : Assister les pauvres en France aux XVIe-XVIIIe siècles
Publié le 24/03/2025
Extrait du document
«
Dissertation : Assister les pauvres en France aux XVIe-XVIIIe siècles
La pauvreté a toujours été une question centrale dans l’organisation des sociétés.
Dans
la France d’Ancien Régime, elle représente à la fois un défi moral, social et politique.
Entre
le XVIe et le XVIIIe siècle, la manière dont les autorités, les institutions religieuses et les
communautés locales assistent les pauvres évolue petit à petit.
D’une assistance fondée sur la
charité chrétienne à des politiques de contrôle plus strictes sous l’absolutisme, aux débats
philosophiques des Lumières sur la question sociale, cette période est marquée par une
transformation des perceptions et des dispositifs d’aide aux plus pauvres et démunis.
Il est
d’abord essentiel de définir les termes du sujet.
Le terme d’assistance désigne l’ensemble des
dispositifs visant à venir en aide aux populations en détresse.
Il peut s’agir d’aides matérielles
comme la distribution de nourriture ou l’hébergement, de structuress institutionnelles comme
les hôpitaux ou les ateliers de charité ou de politiques visant à encadrer la mendicité.
Le mot
pauvre quant à lui englobe une large catégorie de personnes aux profils variés mais ayant
comme point commun le manque d’argent.
Anne Béroujon explique que le terme de pauvre
n’est pas une figure unique, mais un ensemble de réalités sociales comme le mendiant,
l’ouvrier sans emploi, la veuve, l’orphelin et l’infirme.
Cette diversité implique des approches
différentes selon les périodes et les acteurs concernés.
De plus, nous allons nous intéresser
plus particulièrement à la France entre le XVIe et le XVIIIe siècle, soit une période couvrant
l’Ancien Régime puis la période marquée par les bouleversements révolutionnaires.
Ces trois
siècles sont marqués par des changements majeurs dans la gestion de la pauvreté car au XVIe
siècle, l’assistance repose essentiellement sur la charité chrétienne et l’entraide
communautaire.
Au XVIIe siècle, sous l’impulsion de l’État monarchique, elle devient plus
encadrée et répressive.
Enfin, au XVIIIe siècle, de nouvelles théories émergent, remettant en
cause les modèles traditionnels d’aide aux pauvres.
La période étudiée voit donc de
nombreuses transformations économiques, sociales et religieuses.
Nous nous demanderons
donc en quoi les modalités d’assistance aux pauvres en France ont-elles évolué entre le XVIe
et le XVIIIe siècle, et quelles ont été leurs implications sociales et politiques.
Nous étudierons
d’abord les formes traditionnelles d’assistance au XVIe siècle, puis les réformes et politiques
de contrôle mises en place par l’État au XVIIe siècle, avant d’examiner les nouvelles
approches et critiques qui émergent au XVIIIe siècle.
Tout d’abord nous allons expliquer l’assistance traditionnelle au XVIe siècle reposant
sur une prise en charge locale et religieuse.
Nous nous concentrerons d’abord sur la charité
chrétienne et les institutions ecclésiastiques.
En effet, durant l’Ancien Régime, l’Église joue
un rôle fondamental dans l’aide aux pauvres.
Sa mission caritative s’ancre dans une vision
chrétienne de la pauvreté et de la charité, qui structure l’organisation sociale et inspire les
institutions d’assistance.
À travers les paroisses, les confréries et les monastères, l’Église
prend en charge les pauvres et les personnes dans le besoin en leur fournissant de la
nourriture, des soins et un abri, tout en instaurant un cadre moral et religieux à la distribution
de l’aide.
La vision chrétienne de la pauvreté repose sur l’idée que la misère terrestre est une
épreuve spirituelle et que la charité est un devoir fondamental du chrétien.
La Bible
encourage notamment l’assistance aux pauvres, comme en témoigne le proverbe chrétien :
1
"Donner aux pauvres, c’est prêter à Dieu".
Dans cette perspective, l’aide aux pauvres n’est
donc pas simplement une nécessité sociale, mais aussi un acte religieux permettant au
donateur d’accumuler des mérites en vue de sa propre rédemption.
Ce principe est largement
diffusé par le clergé, qui invite les fidèles à pratiquer la charité sous différentes formes.
Nous
pouvons prendre l’exemple des dons aux pauvres, le financement d’hospices ou encore
l’engagement personnel dans des œuvres de bienfaisance.
Le Concile de Trente en 15451563, qui marque la Contre-Réforme catholique, réaffirme l’importance de la charité comme
devoir chrétien.
L’Église cherche ainsi à renforcer son contrôle sur l’encadrement des
pauvres en réaction aux critiques des protestants, qui dénoncent parfois l’inefficacité des
institutions catholiques dans la gestion de la pauvreté.
De plus, les paroisses jouent un rôle
central dans l’organisation de l’assistance aux pauvres car elles permettent d'assurer une aide
directe sous forme de distribution de nourriture et de vêtements aux plus pauvres.
De plus, les
confréries de charité, associations religieuses laïques, participent activement à cette
assistance.
Composées de notables et d’artisans, elles organisent des collectes et des
distributions, financent des repas et parfois même l’entretien d’hospices ou d’orphelinats.
À
Paris, la Confrérie de la Charité illustre bien cette organisation car elle collecte des fonds et
redistribue des aumônes aux nécessiteux tout en veillant à leur encadrement moral.
Les
monastères et abbayes jouent également un rôle clé dans l’accueil des pauvres.
Ils offrent
aussi un abri temporaire, notamment lors des grandes crises comme les épidémies et famines
qui touchent avant tout les pauvres.
Au-delà des paroisses et des confréries, l’Église encadre
aussi des institutions plus spécialisées dans l’accueil des pauvres, notamment les hospices et
les hôpitaux.
Ces établissements sont destinés à recevoir les plus pauvres, les malades, les
vieillards et les orphelins.
Nous pouvons prendre comme exemple l’Hôtel-Dieu de Lyon, qui
fut fondé au Moyen Âge et est toujours en activité aux XVIe et XVIIe siècles.
Cet
établissement accueillait des malades, leur apportait des soins et leur offrait un hébergement
temporaire.
Il reposait sur des donations de la noblesse et du clergé, qui assuraient son
fonctionnement.
Cependant, ces institutions ont fait face à des difficultés croissantes.
Avec
l’augmentation de la population urbaine et la multiplication des crises économiques, elles
deviennent rapidement surchargées.
Face à cette surcharge, les autorités ecclésiastiques et
municipales tentent donc d’organiser une meilleure répartition des pauvres entre les
différentes institutions.
Néanmoins, les ressources restent limitées, et les épidémies de peste
ou de typhus viennent régulièrement aggraver la situation.
Ainsi, au XVIe siècle, l’assistance
aux pauvres repose essentiellement sur la charité chrétienne, qui structure les pratiques
sociales et les institutions d’aide.
L’Église, à travers ses paroisses, ses confréries et ses
hospices, constitue le principal acteur de cette prise en charge.
Cependant, les limites de cette
organisation commencent à apparaître face à l’augmentation du nombre de pauvres et aux
crises récurrentes.
Nous allons maintenant nous intéresser aux différentes initiatives des municipalités et
des communautés.
En effet, si l’Église fut le le principal acteur de l’assistance aux pauvres
sous l’Ancien Régime, les autorités municipales prennent progressivement une part plus
active dans cette mission.
Face à l’ampleur croissante de la pauvreté et aux limites des
institutions ecclésiastiques, certaines villes mettent en place des structures spécifiques pour
encadrer l’aide aux pauvres.
Ce mouvement, qui commença dès la fin du Moyen Âge, prend
2
une ampleur significative aux XVIe siècle avec la création d’institutions locales destinées à
organiser la redistribution des ressources, limiter la mendicité et financer l’assistance par des
prélèvements obligatoires.
Dans plusieurs grandes villes françaises, les municipalités
établissent des structures administratives destinées à centraliser et à mieux gérer la
distribution des secours.
Nous pouvons prendre pour exemple la création des bureaux des
pauvres, qui apparaissent dès le XVIe siècle et se généralisent progressivement.
Le premier
bureau des pauvres fut fondé à Lyon en 1531, à la suite d’une grande famine qui poussa la
ville à organiser une meilleure prise en charge des pauvres.
Ce modèle fut ensuite repris par
d’autres municipalités, dont Paris en 1544.
Ces bureaux sont chargés de collecter des fonds
auprès des habitants les plus aisés, pour ensuite redistribuer cet argent sous forme d’aides
directes aux personnes dans le besoin.
Le fonctionnement de ces bureaux repose sur une
gestion mixte car ils sont souvent administrés conjointement par des membres du clergé, des
magistrats municipaux et des notables locaux.
Ce mode de gouvernance a permis d’assurer
une certaine transparence et de répondre aux besoins des pauvres tout en évitant une gestion
exclusivement religieuse qui fut perçue parfois comme parfois inefficace.
Cependant, ces
structures ne parviennent pas toujours à couvrir l’ensemble des demandes car la pression
démographique, notamment dans les grandes villes, fait exploser le nombre de personnes
dépendantes de l’assistance publique.
Les bureaux des pauvres sont ainsi souvent débordés, et
leurs ressources insuffisantes entraînent donc des tensions entre les différents acteurs de
l’aide sociale.
Afin de garantir un financement plus stable de l’aide aux pauvres, certaines
municipalités adoptent donc des taxes spécifiques destinées à alimenter les caisses de
l’assistance publique.
L’exemple de Lyon est, encore une fois, révélateur car à partir du XVIe
siècle, la ville instaure une taxe sur les biens des bourgeois les plus aisés, dont le produit est
redistribué via les bureaux des pauvres.
D’autres villes suivent cet exemple en instituant des
impôts locaux pour subvenir aux besoins des indigents.
Par exemple, à Toulouse, une taxe sur
les transactions commerciales est mise en place afin de financer les œuvres de charité.
Ces
prélèvements obligatoires complètent les dons privés, qui restent une source essentielle de
financement pour l’assistance aux pauvres.
Les grandes familles bourgeoises et
aristocratiques participent également à cela en finançant la construction....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- La Place des femmes dans la famille en France entre le XVIe et le XVIIIe siècle
- La Nouvelle-France des XVIIe et XVIIIe siècles, devenue colonie britannique en 1763, puis État confédéré du Québec en 1867, est la plus grande province du Canada, à 80 % francophone.
- Les Jésuites et l’enseignement en France (XVIe-XVIIIe siècle)
- Les paroisses urbaines xvie - XVIIIe siècles.
- Les paroisses urbaines XVIe - XVIIIe siècles