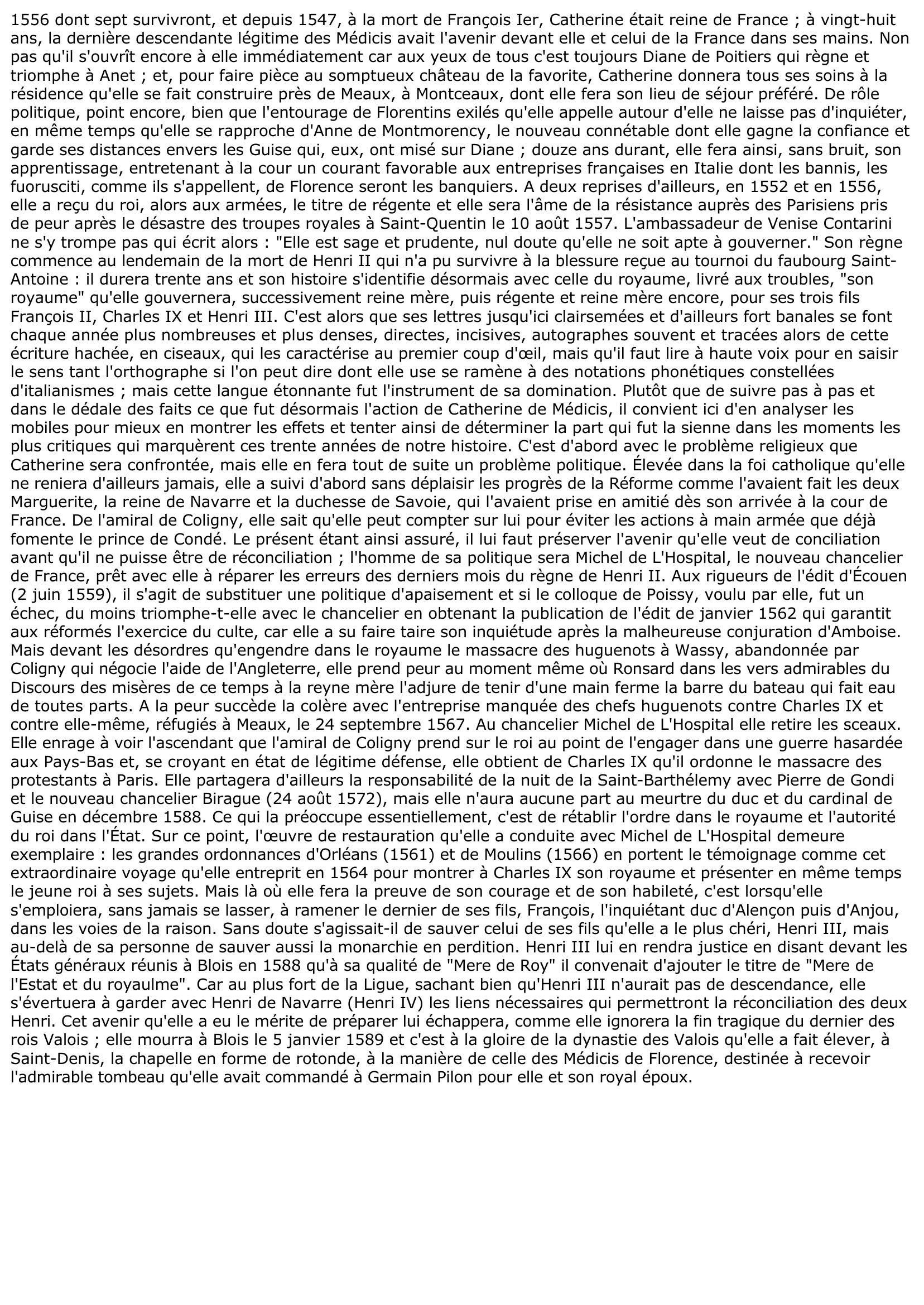Catherine de Médicis
Publié le 22/02/2012
Extrait du document
«
1556 dont sept survivront, et depuis 1547, à la mort de François Ier, Catherine était reine de France ; à vingt-huitans, la dernière descendante légitime des Médicis avait l'avenir devant elle et celui de la France dans ses mains.
Nonpas qu'il s'ouvrît encore à elle immédiatement car aux yeux de tous c'est toujours Diane de Poitiers qui règne ettriomphe à Anet ; et, pour faire pièce au somptueux château de la favorite, Catherine donnera tous ses soins à larésidence qu'elle se fait construire près de Meaux, à Montceaux, dont elle fera son lieu de séjour préféré.
De rôlepolitique, point encore, bien que l'entourage de Florentins exilés qu'elle appelle autour d'elle ne laisse pas d'inquiéter,en même temps qu'elle se rapproche d'Anne de Montmorency, le nouveau connétable dont elle gagne la confiance etgarde ses distances envers les Guise qui, eux, ont misé sur Diane ; douze ans durant, elle fera ainsi, sans bruit, sonapprentissage, entretenant à la cour un courant favorable aux entreprises françaises en Italie dont les bannis, lesfuorusciti, comme ils s'appellent, de Florence seront les banquiers.
A deux reprises d'ailleurs, en 1552 et en 1556,elle a reçu du roi, alors aux armées, le titre de régente et elle sera l'âme de la résistance auprès des Parisiens prisde peur après le désastre des troupes royales à Saint-Quentin le 10 août 1557.
L'ambassadeur de Venise Contarinine s'y trompe pas qui écrit alors : "Elle est sage et prudente, nul doute qu'elle ne soit apte à gouverner." Son règnecommence au lendemain de la mort de Henri II qui n'a pu survivre à la blessure reçue au tournoi du faubourg Saint-Antoine : il durera trente ans et son histoire s'identifie désormais avec celle du royaume, livré aux troubles, "sonroyaume" qu'elle gouvernera, successivement reine mère, puis régente et reine mère encore, pour ses trois filsFrançois II, Charles IX et Henri III.
C'est alors que ses lettres jusqu'ici clairsemées et d'ailleurs fort banales se fontchaque année plus nombreuses et plus denses, directes, incisives, autographes souvent et tracées alors de cetteécriture hachée, en ciseaux, qui les caractérise au premier coup d'œil, mais qu'il faut lire à haute voix pour en saisirle sens tant l'orthographe si l'on peut dire dont elle use se ramène à des notations phonétiques constelléesd'italianismes ; mais cette langue étonnante fut l'instrument de sa domination.
Plutôt que de suivre pas à pas etdans le dédale des faits ce que fut désormais l'action de Catherine de Médicis, il convient ici d'en analyser lesmobiles pour mieux en montrer les effets et tenter ainsi de déterminer la part qui fut la sienne dans les moments lesplus critiques qui marquèrent ces trente années de notre histoire.
C'est d'abord avec le problème religieux queCatherine sera confrontée, mais elle en fera tout de suite un problème politique.
Élevée dans la foi catholique qu'ellene reniera d'ailleurs jamais, elle a suivi d'abord sans déplaisir les progrès de la Réforme comme l'avaient fait les deuxMarguerite, la reine de Navarre et la duchesse de Savoie, qui l'avaient prise en amitié dès son arrivée à la cour deFrance.
De l'amiral de Coligny, elle sait qu'elle peut compter sur lui pour éviter les actions à main armée que déjàfomente le prince de Condé.
Le présent étant ainsi assuré, il lui faut préserver l'avenir qu'elle veut de conciliationavant qu'il ne puisse être de réconciliation ; l'homme de sa politique sera Michel de L'Hospital, le nouveau chancelierde France, prêt avec elle à réparer les erreurs des derniers mois du règne de Henri II.
Aux rigueurs de l'édit d'Écouen(2 juin 1559), il s'agit de substituer une politique d'apaisement et si le colloque de Poissy, voulu par elle, fut unéchec, du moins triomphe-t-elle avec le chancelier en obtenant la publication de l'édit de janvier 1562 qui garantitaux réformés l'exercice du culte, car elle a su faire taire son inquiétude après la malheureuse conjuration d'Amboise.Mais devant les désordres qu'engendre dans le royaume le massacre des huguenots à Wassy, abandonnée parColigny qui négocie l'aide de l'Angleterre, elle prend peur au moment même où Ronsard dans les vers admirables duDiscours des misères de ce temps à la reyne mère l'adjure de tenir d'une main ferme la barre du bateau qui fait eaude toutes parts.
A la peur succède la colère avec l'entreprise manquée des chefs huguenots contre Charles IX etcontre elle-même, réfugiés à Meaux, le 24 septembre 1567.
Au chancelier Michel de L'Hospital elle retire les sceaux.Elle enrage à voir l'ascendant que l'amiral de Coligny prend sur le roi au point de l'engager dans une guerre hasardéeaux Pays-Bas et, se croyant en état de légitime défense, elle obtient de Charles IX qu'il ordonne le massacre desprotestants à Paris.
Elle partagera d'ailleurs la responsabilité de la nuit de la Saint-Barthélemy avec Pierre de Gondiet le nouveau chancelier Birague (24 août 1572), mais elle n'aura aucune part au meurtre du duc et du cardinal deGuise en décembre 1588.
Ce qui la préoccupe essentiellement, c'est de rétablir l'ordre dans le royaume et l'autoritédu roi dans l'État.
Sur ce point, l'œuvre de restauration qu'elle a conduite avec Michel de L'Hospital demeureexemplaire : les grandes ordonnances d'Orléans (1561) et de Moulins (1566) en portent le témoignage comme cetextraordinaire voyage qu'elle entreprit en 1564 pour montrer à Charles IX son royaume et présenter en même tempsle jeune roi à ses sujets.
Mais là où elle fera la preuve de son courage et de son habileté, c'est lorsqu'elles'emploiera, sans jamais se lasser, à ramener le dernier de ses fils, François, l'inquiétant duc d'Alençon puis d'Anjou,dans les voies de la raison.
Sans doute s'agissait-il de sauver celui de ses fils qu'elle a le plus chéri, Henri III, maisau-delà de sa personne de sauver aussi la monarchie en perdition.
Henri III lui en rendra justice en disant devant lesÉtats généraux réunis à Blois en 1588 qu'à sa qualité de "Mere de Roy" il convenait d'ajouter le titre de "Mere del'Estat et du royaulme".
Car au plus fort de la Ligue, sachant bien qu'Henri III n'aurait pas de descendance, elles'évertuera à garder avec Henri de Navarre (Henri IV) les liens nécessaires qui permettront la réconciliation des deuxHenri.
Cet avenir qu'elle a eu le mérite de préparer lui échappera, comme elle ignorera la fin tragique du dernier desrois Valois ; elle mourra à Blois le 5 janvier 1589 et c'est à la gloire de la dynastie des Valois qu'elle a fait élever, àSaint-Denis, la chapelle en forme de rotonde, à la manière de celle des Médicis de Florence, destinée à recevoirl'admirable tombeau qu'elle avait commandé à Germain Pilon pour elle et son royal époux..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- CATHERINE DE MÉDICIS (Sur). d’Honoré de Balzac (résumé & analyse)
- MÉMOIRE ADRESSÉ A CHARLES IX ET A CATHERINE DE MÉDICIS de l’Hospital - résumé, analyse
- Henri III 1551-1589 Successeur de Charles IX sur le trône de France, en 1574, il est le troisième fils d'Henri II et de Catherine de Médicis.
- Catherine de Médicis par Michel François Membre de l'Institut.
- MARGUERITE DE VALOIS, dite la Reine Margot (14 mai 1553-27 mars 1615) Reine de Navarre Fille du roi Henri II et de Catherine de Médicis, elle doit épouser le huguenot Henri de Navarre afin que leur mariage tienne lieu de symbole de réconciliation entre catholiques et protestants.