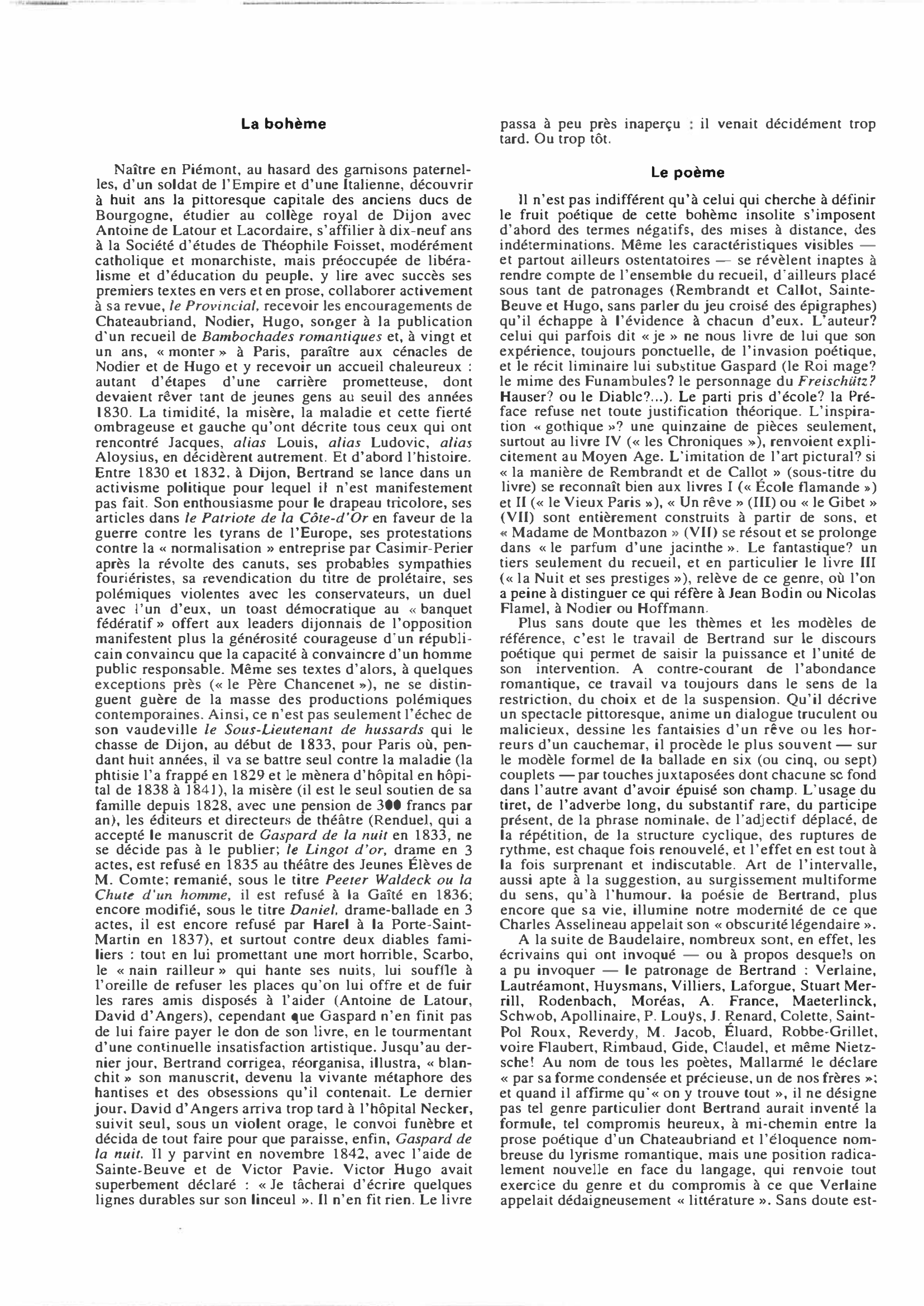BERTRAND Aloysius : sa vie et son oeuvre
Publié le 17/11/2018
Extrait du document
BERTRAND Aloysius, pseudonyme de Jacques Louis Napoléon Bertrand (1807-1841). Écrivain né à Ceva (Piémont), le plus connu sans doute des méconnus de la littérature française du XIXe siècle : 1) comme un de ceux qu’on a coutume de classer parmi les « petits romantiques » (aux côtés de Pétrus Borel ou de Marceline Des-bordes-Valmore); 2) comme un des héros-martyrs de ce qu’on a appelé la « bohème littéraire » (aux côtés d’Hé-gésippe Moreau, de Charles Lassailly, mais aussi de Gérard de Nerval); 3) comme un pionnier de la recherche formelle (qu’on situe dans la lignée de Rémi Belleau, La Fontaine, Joubert et Courier) et de la fraternité des arts (aux côtés de Gautier, Nodier, Hugo), et, à ce titre, comme l’un des initiateurs de l'Art pour l’Art et du symbolisme; 4) comme l’un des créateurs, en France, du poème en prose (avec Alphonse Rabbe, Maurice de Guérin, et avant Baudelaire). Aucune de ces rubriques dans lesquelles l'a tour à tour rangé une critique classificatrice, préoccupée de hiérarchies et de filiations, ne suffit à définir l’originalité de sa présence dans l’histoire littéraire. Car, s’il est romantique, bohème, pionnier et précurseur, c’est à la manière dont il fut dijonnais, sans la moindre fatalité, mais par un choix, par une adoption qu’il a hautement revendiquée, et par une passion dont il ne nous a à peu près rien livré, sinon un maître livre, auquel il travailla toute sa vie et qui ne parut qu’après sa mort, en 1842 : Gaspard de la nuit.
Vouloir retracer la vie d’Aloysius Bertrand a l’air d’une plaisanterie inspirée par un Satan moqueur. C’est imaginer que cette existence s’est, à la manière de tant d'autres, constituée comme la trame même d’une œuvre étendue, ouverte aux suggestions d’une expérience renouvelée (de la vie, de l’amour, du voyage, du monde...), alors qu’elle s’est pour ainsi dire résumée, consumée et évanouie dans un livre sans date. « Romantique raté », « aiglon avorté » ou, suivant la formule de Sainte-Beuve, « grand général tué sous-lieutenant », Bertrand est évidemment étranger à sa propre vie. Les deux seuls portraits qu’on ait de lui en sont un éloquent symbole : l’un est le portrait d’un vivant, l’autre celui d’un mort, mais ils entretiennent d’étranges affinités, ayant été dessinés à quelques jours de distance par David d’Angers, auprès d'un lit d’hôpital. A Paris, on le croit provincial; à Dijon, on le croit parisien, et tel critique le fait, à tort, dijonnais. Partout il échappe, et dans l’écriture même, où s’épuise volontiers la recherche des traces. Mais on n’échappe pas à Satan, ni aux rubriques des dictionnaires.
«
La
bohème
Naître en Piémont, au hasard des garnisons paternel
les, d'un soldat de l'Empire et d'une Italienne, découvrir
à huit ans la pittoresque capitale des anciens ducs de
Bourgogne, étudier au collège royal de Dijon avec
Antoine de Latour et Lacordaire, s'affilier à dix-neuf ans
à la Société d'études de Théophile Foisset, modérément
catholique et monarchiste, mais préoccupée de libéra
lisme et d'éducation du peuple, y lire avec succès ses
premiers textes en vers et en prose, collaborer activement
à sa revue, le Provincial, recevoir les encouragements de
Chateaubriand, Nodier, Hugo, sor.ger à la publication
d'un recueil de Bambochades romantiques et, à vingt et
un ans, « monter>> à Paris, paraître aux cénacles de
Nodier et de Hugo et y recevoir un accueil chaleureux :
autant d'étapes d'une carrière prometteuse, dont
devaient rêver tant de jeunes gens au seuil des années
1830.
La timidité, la misère, la maladie et cette fierté
ombrageuse et gauche qu'ont décrite tous ceux qui ont
rencontré Jacques, alias Louis, alias Ludovic, alias
Aloysius, en décidèrent autrement.
Et d'abord l'histoire.
Entre 1830 et 1832, à Dijon, Bertrand se lance dans un
activisme politique pour lequel il n'est manifestement
pas fait.
Son enthousiasme pour le drapeau tricolore, ses
articles dans le Patriote de la Côte-d'Or en faveur de la
guerre contre les tyrans de l'Europe, ses protestations
contre la « normalisation » entreprise par Casimir-Perier
après la révolte des canuts, ses probables sympathies
fouriéristes, sa revendication du titre de prolétaire, ses
polémiques violentes avec les conservateurs, un duel
avec 1' un d'eux, un toast démocratique au « banquet
fédératif» offert aux leaders dijonnais de l'opposition
manifestent plus la générosité courageuse d'un républi
cain convaincu que la capacité à convaincre d'un homme
public responsable.
Même ses textes d'alors, à quelques
exceptions près ( « le Père Chancenet » ), ne se distin
guent guère de la masse des productions polémiques
contemporaines.
Ainsi, ce n'est pas seulement l'échec de
son vaudeville le Sous-Lieutenant de hussards qui Je
chasse de Dijon, au début de 1833, pour Paris où, pen
dant huit années, il va se battre seul contre la maladie (la
phtisie l'a frappé en 1829 et le mènera d'hôpital en hôpi
tal de 1838 à 1841 ), la misère (il est Je seul soutien de sa
famille depuis 1828, avec une pension de 300 francs par
an), les éditeurs et directeurs de théâtre (Rendue!, qui a
accepté le manuscrit de Gaspard de la nuit en 1833, ne
se décide pas à le publier; le Lingot d'or, dr�me en 3
actes, est refusé en 1835 au théâtre des Jeunes Elèves de
M.
Comte; remanié, sous Je titre Peerer Waldeck ou la
Chwe d'rm homme, il est refusé à la Gaîté en 1836;
encore modifié, sous le titre Daniel, drame-ballade en 3
actes, il est encore refusé par Harel à la Porte-Saint
Martin en 1837), et surtout contre deux diables fami
liers : tout en lui promettant une mort horrible, Scarbo,
le «nain railleur» qui hante ses nuits, lui souffle à
1 'orei Ile de refuser les pl aces qu'on lui offre et de fuir
les rares amis disposés à 1' aider (Antoine de Latour,
David d'Angers), cependant que Gaspard n'en finit pas
de lui faire payer le don de son livre, en le tourmentant
d'une continuelle insatisfaction artistique.
Jusqu'au der
nier jour, Bertrand corrigea, réorganisa, illustra, « blan
chit » son manuscrit, devenu la vivante métaphore des
hantises et des obsessions qu'il contenait.
Le dernier
jour, David d'Angers arriva trop tard à l'hôpital Necker,
suivit seul, sous un violent orage, Je convoi funèbre et
décida de tout faire pour que paraisse, enfin, Gaspard de
la nuit.
Il y parvint en novembre 1842, avec l'aide de
Sainte-Beuve et de Victor Pavie.
Victor Hugo avait
superbement déclaré : «Je tâcherai d'écrire quelques
lignes durables sur son linceul ».
Il n'en fit rien.
Le livre passa
à peu près inaperçu il
venait décidément trop
tard.
Ou trop tôt.
Le poème
Il n'est pas indifférent qu'à celui qui cherche à définir
le fruit poétique de cette bohème insolite s'imposent
d'abord des termes négatifs, des mises à distance, des
indéterminations.
Même les caractéristiques visibles -
et partout ailleurs ostentatoires -se révèlent inaptes à
rendre compte de J'ensemble du recueil, d'ailleurs placé
sous tant de patronages (Rembrandt et Callot, Sainte
Beuve et Hugo, sans parler du jeu croisé des épigraphes)
qu'il échappe à l'évidence à chacun d'eux.
L'auteur?
celui qui parfois dit «je » ne nous livre de lui que son
expérience, toujours ponctuelle, de l'invasion poétique,
et le récit liminaire lui substitue Gaspard (le Roi mage?
le mime des Funambules? le personnage du Freischiitz?
Hauser? ou le Diable? ...
).
Le parti pris d'école? la Pré
face refuse net toute justification théorique.
L'inspira
tion « gothique>>? une quinzaine de pièces seulement,
surtout au livre IV ( « les Chroniques » ), renvoient expli
citement au Moyen Age.
L'imitation de l'art pictural? si
« la manière de Rembrandt et de Callot » (sous-titre du
livre) se reconnaît bien aux livres I (« École flamande >>)
et II ( « le Vieux Paris >> ), « Un rêve >> (III) ou« le Gibet »
(VII) sont entièrement construits à partir de sons, et
« Madame de Montbazon » (VIT) se résout et se prolonge
dans «le parfum d'une jacinthe».
Le fantastique? un
tiers seulement du recueil, et en particulier le livre III
(« la Nuit et ses prestiges »), relève de ce genre, où l'on
a peine à distinguer ce qui réfère à Jean Bodin ou Nicolas
Flamel, à Nodier ou Hoffmann.
Plus sans doute que les thèmes et les modèles de
référence, c'est le travail de Bertrand sur le discours
poétique qui permet de saisir la puissance et l'unité de
son intervention.
A contre-courant de l'abondance
romantique, ce travail va toujours dans Je sens de la
restriction, du choix et de la suspension.
Qu'il décrive
un spectacle pittoresque, anime un dialogue truculent ou
malicieux, dessine les fantaisies d'un rêve ou les hor
reurs d'un cauchemar, il procède le plus souvent- sur
Je modèle formel de la ballade en six (ou cinq, ou sept)
couplets -par touches juxtaposées dont chacune se fond
dans l'autre avant d'avoir épuisé son champ.
L'usage du
tiret, de l'adverbe long, du substantif rare, du participe
présent, de la phrase nominale, de l'adjectif déplacé, de
la répétition, de la structure cyclique, des ruptures de
rythme, est chaque fois renouvelé, et l'effet en est tout à
la fois surprenant et indiscutable.
Art de l'intervalle,
aussi apte à la suggestion, au surgissement multiforme
du sens, qu'à l'humour, la poésie de Bertrand, plus
encore que sa vie, illumine notre modernité de ce que
Charles Asselineau appelait son « obscurité légendaire ».
A la suite de Baudelaire, nombreux sont, en effet, les
écrivains qui ont invoqué -ou à propos desquels on
a pu invoquer -le patronage de Bertrand : Verlaine,
Lautréamont, Huysmans, Villiers, Laforgue, Stuart Mer
rill, Rodenbach, Moréas, A.
France, Maeterlinck,
Schwob, Apollinaire, P.
Louys, J.
Renard, Colette, Saint
Pol Roux, Reverdy, M.
Jacob, Éluard, Robbe-Grillet,
voire Flaubert, Rimbaud, Gide, Claudel, et même Nietz
sche! Au nom de tous les poètes, Mallarmé le déclare
« par sa forme condensée et précieuse, un de nos frères »;
et quand il affirme qu'« on y trouve tout », il ne désigne
pas tel genre particulier dont Bertrand aurait inventé la
formule, tel compromis heureux, à mi-chemin entre la
prose poétique d'un Chateaubriand et l'éloquence nom
breuse du lyrisme romantique, mais une position radica
lement nouvelle en face du langage, qui renvoie tout
exercice du genre et du compromis à ce que Verlaine
appelait dédaigneusement « littérature».
Sans doute est-.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- VIE DE BERTRAND DU GUESCLIN. (résumé & analyse de l’oeuvre)
- Bertrand, Jean-Pierre - vie et oeuvre du peintre.
- Tes compagnons d'armes, tombés avec courage au premier rang, ont acheté de leur vie la gloire et le salut de ceux qui bientôt les auront oubliés. Aloysius Bertrand, Gaspard de la nuit
- LA BORDERIE Bertrand de : sa vie et son oeuvre
- POIROT-DELPECH Bertrand : sa vie et son oeuvre