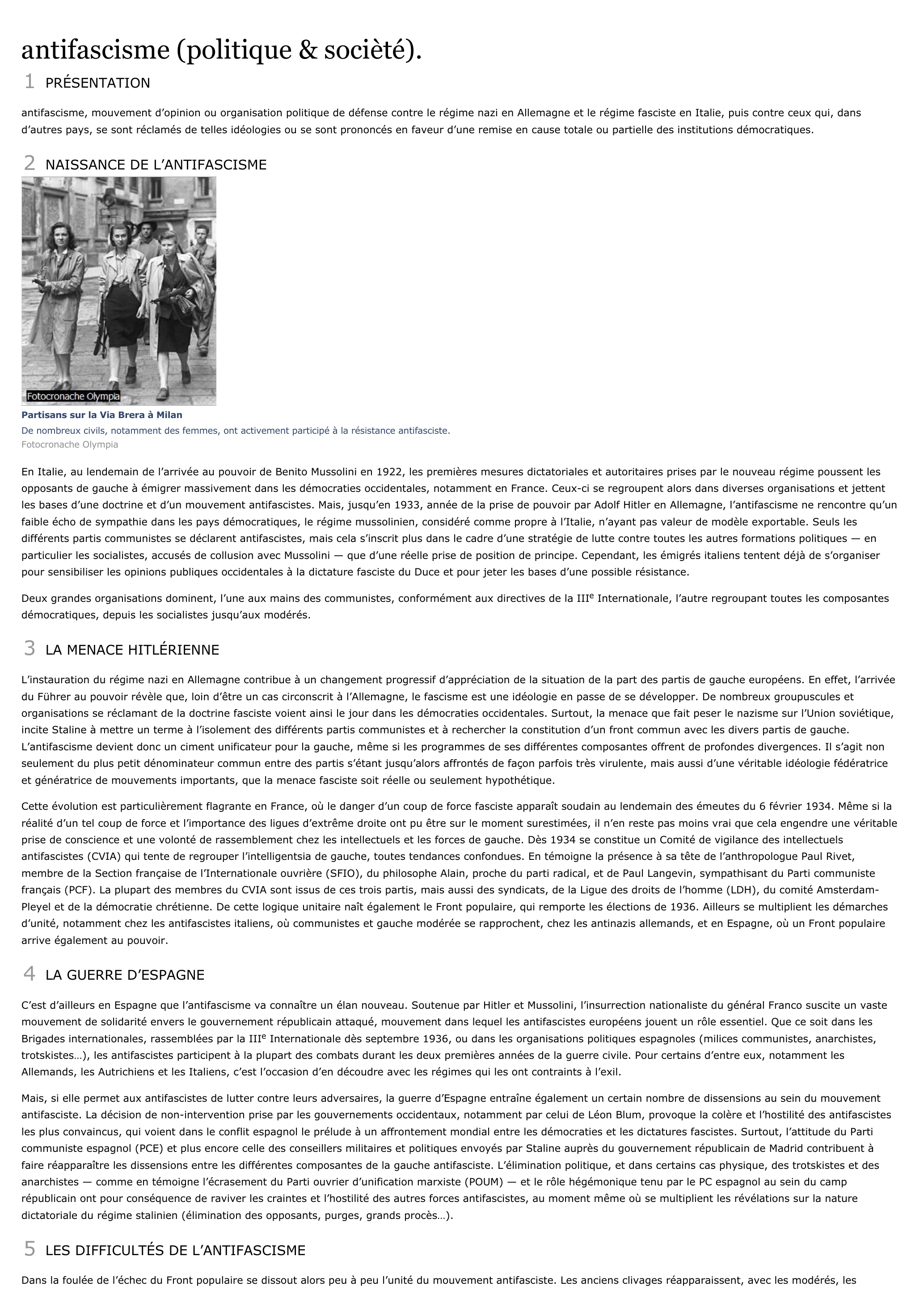Au nom de l'antifascisme
Publié le 07/04/2019
Extrait du document
Au nom de l'antifascisme
Dès le début de la guerre d'Espagne, des volontaires venus de toute l'Europe s'engagent aux côtés des républicains espagnols. Les communistes européens obtiennent du Komintern qu'il procède, à partir d'octobre 1936, au recrutement de Brigades internationales, dont les effectifs atteindront jusqu'à quarante mille personnes. Elles participent à la plupart des grandes batailles comme Guadalajara ou Brunete et parviennent à retarder la prise de Madrid par les partisans de Franco. En septembre 1938, elles se retirent du conflit à la demande du Comité de non-intervention, qui rassemble la plupart des pays d'Europe. Parmi les engagés au sein des Brigades internationales, on trouve de nombreuses figures de la lutte antifasciste et du communisme européen comme le Yougoslave Josip Broz, futur Tito ou l'Allemand Walter Ulbricht.
«
antifascisme (politique & socièté).
1 PRÉSENTATION
antifascisme , mouvement d’opinion ou organisation politique de défense contre le régime nazi en Allemagne et le régime fasciste en Italie, puis contre ceux qui, dans d’autres pays, se sont réclamés de telles idéologies ou se sont prononcés en faveur d’une remise en cause totale ou partielle des institutions démocratiques.
2 NAISSANCE DE L’ANTIFASCISME
Partisans sur la Via Brera à MilanDe nombreux civils, notamment des femmes, ont activement participé à la résistance antifasciste.Fotocronache Olympia
En Italie, au lendemain de l’arrivée au pouvoir de Benito Mussolini en 1922, les premières mesures dictatoriales et autoritaires prises par le nouveau régime poussent lesopposants de gauche à émigrer massivement dans les démocraties occidentales, notamment en France.
Ceux-ci se regroupent alors dans diverses organisations et jettentles bases d’une doctrine et d’un mouvement antifascistes.
Mais, jusqu’en 1933, année de la prise de pouvoir par Adolf Hitler en Allemagne, l’antifascisme ne rencontre qu’unfaible écho de sympathie dans les pays démocratiques, le régime mussolinien, considéré comme propre à l’Italie, n’ayant pas valeur de modèle exportable.
Seuls lesdifférents partis communistes se déclarent antifascistes, mais cela s’inscrit plus dans le cadre d’une stratégie de lutte contre toutes les autres formations politiques — enparticulier les socialistes, accusés de collusion avec Mussolini — que d’une réelle prise de position de principe.
Cependant, les émigrés italiens tentent déjà de s’organiserpour sensibiliser les opinions publiques occidentales à la dictature fasciste du Duce et pour jeter les bases d’une possible résistance.
Deux grandes organisations dominent, l’une aux mains des communistes, conformément aux directives de la III e Internationale, l’autre regroupant toutes les composantes démocratiques, depuis les socialistes jusqu’aux modérés.
3 LA MENACE HITLÉRIENNE
L’instauration du régime nazi en Allemagne contribue à un changement progressif d’appréciation de la situation de la part des partis de gauche européens.
En effet, l’arrivéedu Führer au pouvoir révèle que, loin d’être un cas circonscrit à l’Allemagne, le fascisme est une idéologie en passe de se développer.
De nombreux groupuscules etorganisations se réclamant de la doctrine fasciste voient ainsi le jour dans les démocraties occidentales.
Surtout, la menace que fait peser le nazisme sur l’Union soviétique,incite Staline à mettre un terme à l’isolement des différents partis communistes et à rechercher la constitution d’un front commun avec les divers partis de gauche.L’antifascisme devient donc un ciment unificateur pour la gauche, même si les programmes de ses différentes composantes offrent de profondes divergences.
Il s’agit nonseulement du plus petit dénominateur commun entre des partis s’étant jusqu’alors affrontés de façon parfois très virulente, mais aussi d’une véritable idéologie fédératriceet génératrice de mouvements importants, que la menace fasciste soit réelle ou seulement hypothétique.
Cette évolution est particulièrement flagrante en France, où le danger d’un coup de force fasciste apparaît soudain au lendemain des émeutes du 6 février 1934.
Même si laréalité d’un tel coup de force et l’importance des ligues d’extrême droite ont pu être sur le moment surestimées, il n’en reste pas moins vrai que cela engendre une véritableprise de conscience et une volonté de rassemblement chez les intellectuels et les forces de gauche.
Dès 1934 se constitue un Comité de vigilance des intellectuelsantifascistes (CVIA) qui tente de regrouper l’intelligentsia de gauche, toutes tendances confondues.
En témoigne la présence à sa tête de l’anthropologue Paul Rivet,membre de la Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO), du philosophe Alain, proche du parti radical, et de Paul Langevin, sympathisant du Parti communistefrançais (PCF).
La plupart des membres du CVIA sont issus de ces trois partis, mais aussi des syndicats, de la Ligue des droits de l’homme (LDH), du comité Amsterdam-Pleyel et de la démocratie chrétienne.
De cette logique unitaire naît également le Front populaire, qui remporte les élections de 1936.
Ailleurs se multiplient les démarchesd’unité, notamment chez les antifascistes italiens, où communistes et gauche modérée se rapprochent, chez les antinazis allemands, et en Espagne, où un Front populairearrive également au pouvoir.
4 LA GUERRE D’ESPAGNE
C’est d’ailleurs en Espagne que l’antifascisme va connaître un élan nouveau.
Soutenue par Hitler et Mussolini, l’insurrection nationaliste du général Franco suscite un vastemouvement de solidarité envers le gouvernement républicain attaqué, mouvement dans lequel les antifascistes européens jouent un rôle essentiel.
Que ce soit dans lesBrigades internationales, rassemblées par la III e Internationale dès septembre 1936, ou dans les organisations politiques espagnoles (milices communistes, anarchistes, trotskistes…), les antifascistes participent à la plupart des combats durant les deux premières années de la guerre civile.
Pour certains d’entre eux, notamment lesAllemands, les Autrichiens et les Italiens, c’est l’occasion d’en découdre avec les régimes qui les ont contraints à l’exil.
Mais, si elle permet aux antifascistes de lutter contre leurs adversaires, la guerre d’Espagne entraîne également un certain nombre de dissensions au sein du mouvementantifasciste.
La décision de non-intervention prise par les gouvernements occidentaux, notamment par celui de Léon Blum, provoque la colère et l’hostilité des antifascistesles plus convaincus, qui voient dans le conflit espagnol le prélude à un affrontement mondial entre les démocraties et les dictatures fascistes.
Surtout, l’attitude du Particommuniste espagnol (PCE) et plus encore celle des conseillers militaires et politiques envoyés par Staline auprès du gouvernement républicain de Madrid contribuent àfaire réapparaître les dissensions entre les différentes composantes de la gauche antifasciste.
L’élimination politique, et dans certains cas physique, des trotskistes et desanarchistes — comme en témoigne l’écrasement du Parti ouvrier d’unification marxiste (POUM) — et le rôle hégémonique tenu par le PC espagnol au sein du camprépublicain ont pour conséquence de raviver les craintes et l’hostilité des autres forces antifascistes, au moment même où se multiplient les révélations sur la naturedictatoriale du régime stalinien (élimination des opposants, purges, grands procès…).
5 LES DIFFICULTÉS DE L’ANTIFASCISME
Dans la foulée de l’échec du Front populaire se dissout alors peu à peu l’unité du mouvement antifasciste.
Les anciens clivages réapparaissent, avec les modérés, les.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Au nom de quoi défendre la tolérance ?
- Mathématiques Les triangles Construis un triangle à partir du trait vert et deux à partir du trait jaune Mathématiques Les triangles Relie chaque triangle à son nom.
- Nom : Date : Réussite : Prénom : Numération 1) Place les nombres suivants sur la courbe.
- Retrouve les différents points important de cette lettre le nom et
- Tu places un déte rm inant différent de vant chaque Groupe Nom inal (GN) .