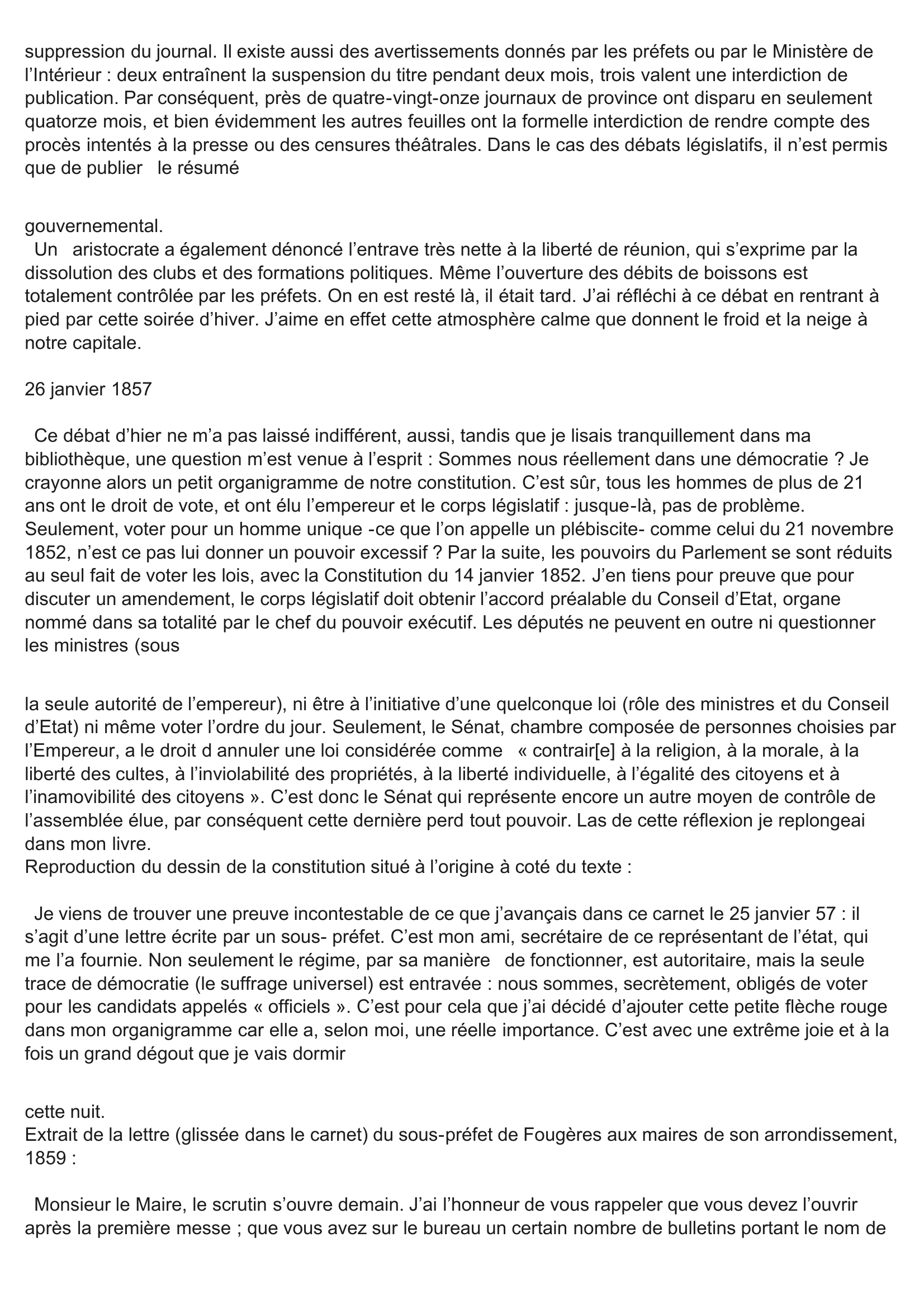TPE : Baudelaire face à la morale bourgeoise de la fin du 19eme siècle
Publié le 21/12/2012
Extrait du document

qui consiste à montrer les vices de l’humanité dans toute leur noirceur afin d’en inspirer de la haine. Il a
pris l’exemple de Molière, qui dans la préface de son Tartuffe explique qu'il utilise dans sa pièce ce même
procédé. Or, il a du mener un véritable combat pour qu'elle soit représentée, combat dont nous nous
étonnons aujourd'hui puisque nous trouvons admirable la manière dont Molière a entreprit de nous
enseigner qu'il ne faut pas confondre hypocrisie et dévotion. L'avocat a également lu un passage d'une
lettre de Balzac qui n'a jamais été publiée dans une de ses oeuvres. Les propos tenus par Balzac dans
sa lettre sont venus une nouvelle fois appuyés ceux de Gustave Chaix d'Ange. De plus, il a ajouté que
décrire le mal ce n'est pas l'approuver et qui son client, n'avait d'ailleurs rien dit en faveur des vices. Il a,
enfin, cité M.Barbey d'Aurevilly, qu'il a présenté comme un critique éminent qui fait parti des plus grands
écrivains de notre époque. Ayant tout dit sur les intentions de Baudelaire et le procédé qu'il avait employé,
l'avocat s'est ensuite chargé de montrer si son client avait dépassé les limites et si on pouvait parler
d'outrage à la morale publique et religieuse. Pour cela, il s'est, tout d'abord, appuyé sur la définition légale
du terme outrage. Ainsi, est arrivé à la conclusion que pour accuser Baudelaire d'outrage, il aurait fallu
que ce dernier ait fait preuve d'un
cynisme grossier, et ait volontairement exagéré sa peinture du mal tout en faisant preuve de brutalité. De
plus, il a fait remarqué que les Fleurs du Mal sont un recueil de poésie dans lequel Baudelaire n'a réuni
des pièces isolées. Elles sont, en effet, dépendantes les unes des autres, liées les unes aux autres et

«
suppression du journal.
Il existe aussi des avertissements donnés par les préfets ou par le Ministère de
l’Intérieur : deux entraînent la suspension du titre pendant deux mois, trois valent une interdiction de
publication.
Par conséquent, près de quatre-vingt-onze journaux de province ont disparu en seulement
quatorze mois, et bien évidemment les autres feuilles ont la formelle interdiction de rendre compte des
procès intentés à la presse ou des censures théâtrales.
Dans le cas des débats législatifs, il n’est permis
que de publier le résumé
gouvernemental.
Un aristocrate a également dénoncé l’entrave très nette à la liberté de réunion, qui s’exprime par la
dissolution des clubs et des formations politiques.
Même l’ouverture des débits de boissons est
totalement contrôlée par les préfets.
On en est resté là, il était tard.
J’ai réfléchi à ce débat en rentrant à
pied par cette soirée d’hiver.
J’aime en effet cette atmosphère calme que donnent le froid et la neige à
notre capitale.
26 janvier 1857
Ce débat d’hier ne m’a pas laissé indifférent, aussi, tandis que je lisais tranquillement dans ma
bibliothèque, une question m’est venue à l’esprit : Sommes nous réellement dans une démocratie ? Je
crayonne alors un petit organigramme de notre constitution.
C’est sûr, tous les hommes de plus de 21
ans ont le droit de vote, et ont élu l’empereur et le corps législatif : jusque -là, pas de problème.
Seulement, voter pour un homme unique -ce que l’on appelle un plébiscite- comme celui du 21 novembre
1852, n’est ce pas lui donner un pouvoir excessif ? Par la suite, les pouvoirs du Parlement se sont réduits
au seul fait de voter les lois, avec la Constitution du 14 janvier 1852.
J’en tiens pour preuve que pour
discuter un amendement, le corps législatif doit obtenir l’accord préalable du Conseil d’Etat, organe
nommé dans sa totalité par le chef du pouvoir exécutif.
Les députés ne peuvent en outre ni questionner
les ministres (sous
la seule autorité de l’empereur), ni être à l’initiative d’une quelconque loi (rôle des ministres et du Conseil
d’Etat) ni même voter l’ordre du jour.
Seulement, le Sénat, chambre composée de personnes choisies par
l’Empereur, a le droit d annuler une loi considérée comme « contrair[e] à la religion, à la morale, à la
liberté des cultes, à l’inviolabilité des propriétés, à la liberté individuelle, à l’égalité des citoyens et à
l’inamovibilité des citoyens ».
C’est donc le Sénat qui représente encore un autre moyen de contrôle de
l’assemblée élue, par conséquent cette dernière perd tout pouvoir.
Las de cette réflexion je replongeai
dans mon livre.
Reproduction du dessin de la constitution situé à l’origine à coté du texte :
Je viens de trouver une preuve incontestable de ce que j’avançais dans ce carnet le 25 janvier 57 : il
s’agit d’une lettre écrite par un sous- préfet.
C’est mon ami, secrétaire de ce représentant de l’état, qui
me l’a fournie.
Non seulement le régime, par sa manière de fonctionner, est autoritaire, mais la seule
trace de démocratie (le suffrage universel) est entravée : nous sommes, secrètement, obligés de voter
pour les candidats appelés « officiels ».
C’est pour cela que j’ai décidé d’ajouter cette petite flèche rouge
dans mon organigramme car elle a, selon moi, une réelle importance.
C’est avec une extrême joie et à la
fois un grand dégout que je vais dormir
cette nuit.
Extrait de la lettre (glissée dans le carnet) du sous-préfet de Fougères aux maires de son arrondissement,
1859 :
Monsieur le Maire, le scrutin s’ouvre demain.
J’ai l’honneur de vous rappeler que vous devez l’ouvrir
après la première messe ; que vous avez sur le bureau un certain nombre de bulletins portant le nom de.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Baudelaire face à la morale bourgeoise de la fin du 19eme siècle
- «Aimez ce que jamais on ne verra deux fois», tel est le conseil que donne Vigny au vers 308 de La Maison du Berger. En face de la morale et de l'art classiques qui privilégient l'éternel par rapport à l'éphémère, l'universel par rapport au singulier, ne vous semble-t-il pas que Vigny définit ainsi une attitude - éthique et esthétique - nouvelle qui, annoncée par Montaigne et la littérature baroque, s'est surtout développée dans la littérature moderne, à partir du romantisme ? Pour répo
- L’Europe à la fin du Moyen-Age (fin du XIIIème – fin XVème siècle)
- Princesse de Clèves: Le personnage face à l’histoire au XIXe Siècle, en quoi la construction du personnage du roman au fil des siècles nous permet-elle de mieux comprendre le monde ?
- ART RELIGIEUX DU XIIe SIÈCLE, — DU XIIIe SIÈCLE , — ET DE LA FIN DU MOYEN AGE EN FRANCE (résumé & analyse)