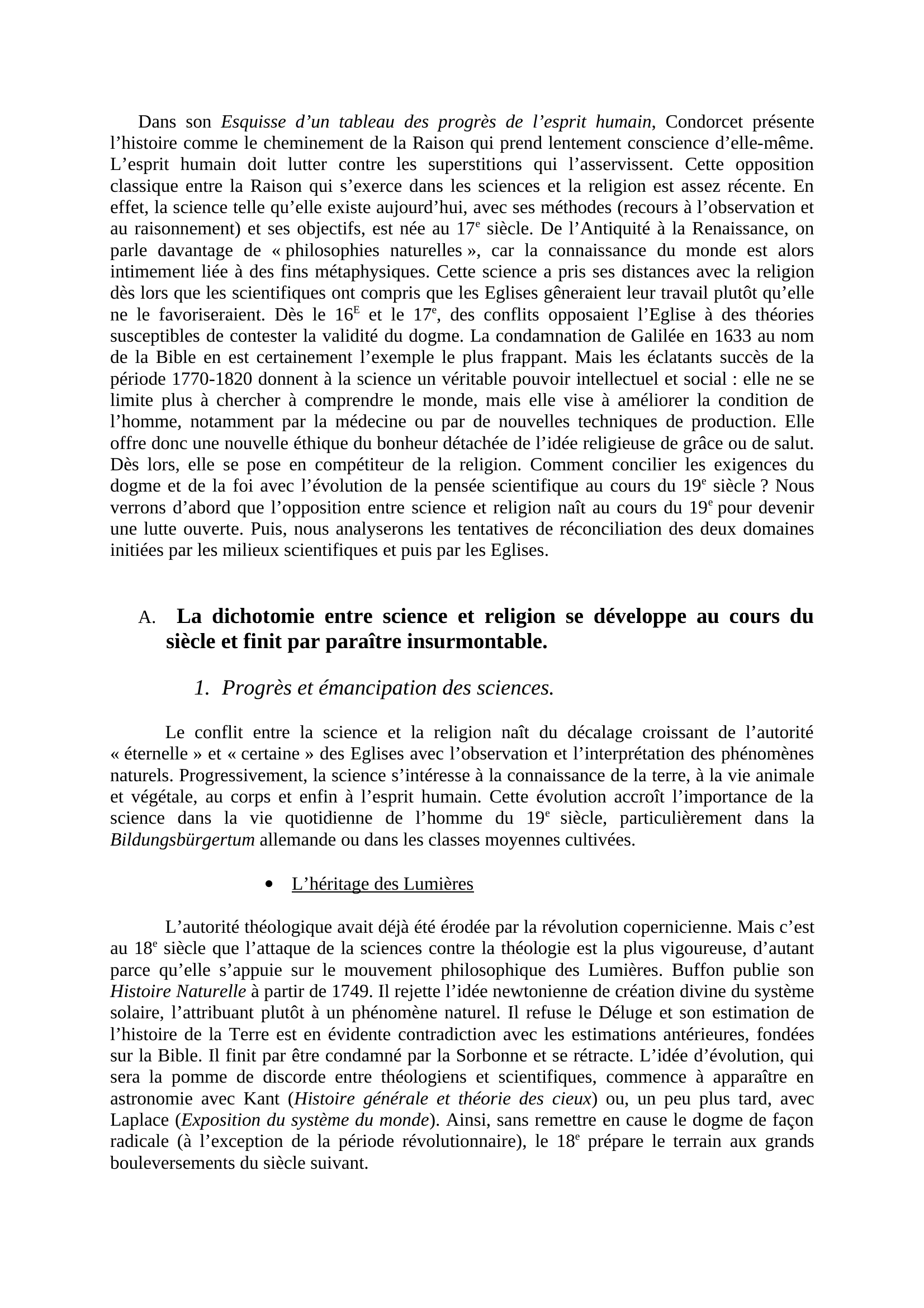Le 19e, siècle de l'affrontement de la science et de la religion ?
Publié le 04/07/2013

Extrait du document

Dissertation d'histoire Conférence de Mr Ferragu Léopold Scharwitzel Le 19e, siècle de l'affrontement de la science et de la religion ? Institut d'Etudes Politiques de Paris Premier cycle, première année Dans son Esquisse d'un tableau des progrès de l'esprit humain, Condorcet présente l'histoire comme le cheminement de la Raison qui prend lentement conscience d'elle-même. L'esprit humain doit lutter contre les superstitions qui l'asservissent. Cette opposition classique entre la Raison qui s'exerce dans les sciences et la religion est assez récente. En effet, la science telle qu'elle existe aujourd'hui, avec ses méthodes (recours à l'observation et au raisonnement) et ses objectifs, est née au 17e siècle. De l'Antiquité à la Renaissance, on parle davantage de « philosophies naturelles «, car la connaissance du monde est alors intimement liée à des fins métaphysiques. Cette science a pris ses distances avec la religion dès lors que les scientifiques ont compris que les Eglises gêneraient leur travail plutôt qu'elle ne le favoriseraient. Dès le 16E et le 17e, des conflits opposaient l'Eglise à des théories susceptibles de contester la validité du dogme. La condamnation de Galilée en 1633 au nom de la Bible en est certainement l'exemple le plus frappant. Mais les éclatants succès de la période 1770-1820 donnent à la science un véritable pouvoir intellectuel et social : elle ne se limite plus à chercher à comprendre le monde, mais elle vise à améliorer la condition de l'homme, notamment par la médecine ou par de nouvelles techniques de production. Elle offre donc une nouvelle éthique du bonheur détachée de l'idée religieuse de grâce ou de salut. Dès lors, elle se pose en compétiteur de la religion. Comment concilier les exigences du dogme et de la foi avec l'évolution de la pensée scientifique au cours du 19e siècle ? Nous verrons d'abord que l'opposition entre science et religion naît au cours du 19e pour devenir une lutte ouverte. Puis, nous analyserons les tentatives de réconciliation des deux domaines initiées par les milieux scientifiques et puis par les Eglises. A. La dichotomie entre science et religion se développe au cours du siècle et finit par paraître insurmontable. 1.Progrès et émancipation des sciences. Le conflit entre la science et la religion naît du décalage croissant de l'autorité « éternelle « et « certaine « des Eglises avec l'observation et l'interprétation des phénomènes naturels. Progressivement, la science s'intéresse à la connaissance de la terre, à la vie animale et végétale, au corps et enfin à l'esprit humain. Cette évolution accroît l'importance de la science dans la vie quotidienne de l'homme du 19e siècle, particulièrement dans la Bildungsbürgertum allemande ou dans les classes moyennes cultivées. L'héritage des Lumières L'autorité théologique avait déjà été érodée par la révolution copernicienne. Mais c'est au 18e siècle que l'attaque de la sciences contre la théologie est la plus vigoureuse, d'autant parce qu'elle s'appuie sur le mouvement philosophique des Lumières. Buffon publie son Histoire Naturelle à partir de 1749. Il rejette l'idée newtonienne de création divine du système solaire, l'attribuant plutôt à un phénomène naturel. Il refuse le Déluge et son estimation de l'histoire de la Terre est en évidente contradiction avec les estimations anté...

«
Dans son Esquisse d’un tableau des progrès de l’esprit humain , Condorcet présente
l’histoire comme le cheminement de la Raison qui prend lentement conscience d’elle-même.
L’esprit humain doit lutter contre les superstitions qui l’asservissent.
Cette opposition
classique entre la Raison qui s’exerce dans les sciences et la religion est assez récente.
En
effet, la science telle qu’elle existe aujourd’hui, avec ses méthodes (recours à l’observation et
au raisonnement) et ses objectifs, est née au 17 e
siècle.
De l’Antiquité à la Renaissance, on
parle davantage de « philosophies naturelles », car la connaissance du monde est alors
intimement liée à des fins métaphysiques.
Cette science a pris ses distances avec la religion
dès lors que les scientifiques ont compris que les Eglises gêneraient leur travail plutôt qu’elle
ne le favoriseraient.
Dès le 16 E
et le 17 e
, des conflits opposaient l’Eglise à des théories
susceptibles de contester la validité du dogme.
La condamnation de Galilée en 1633 au nom
de la Bible en est certainement l’exemple le plus frappant.
Mais les éclatants succès de la
période 1770-1820 donnent à la science un véritable pouvoir intellectuel et social : elle ne se
limite plus à chercher à comprendre le monde, mais elle vise à améliorer la condition de
l’homme, notamment par la médecine ou par de nouvelles techniques de production.
Elle
offre donc une nouvelle éthique du bonheur détachée de l’idée religieuse de grâce ou de salut.
Dès lors, elle se pose en compétiteur de la religion.
Comment concilier les exigences du
dogme et de la foi avec l’évolution de la pensée scientifique au cours du 19 e
siècle ? Nous
verrons d’abord que l’opposition entre science et religion naît au cours du 19 e
pour devenir
une lutte ouverte.
Puis, nous analyserons les tentatives de réconciliation des deux domaines
initiées par les milieux scientifiques et puis par les Eglises.
A.
La dichotomie entre science et religion se développe au cours du
siècle et finit par paraître insurmontable.
1.
Progrès et émancipation des sciences.
Le conflit entre la science et la religion naît du décalage croissant de l’autorité
« éternelle » et « certaine » des Eglises avec l’observation et l’interprétation des phénomènes
naturels.
Progressivement, la science s’intéresse à la connaissance de la terre, à la vie animale
et végétale, au corps et enfin à l’esprit humain.
Cette évolution accroît l’importance de la
science dans la vie quotidienne de l’homme du 19 e
siècle, particulièrement dans la
Bildungsbürgertum allemande ou dans les classes moyennes cultivées.
· L’héritage des Lumières
L’autorité théologique avait déjà été érodée par la révolution copernicienne.
Mais c’est
au 18 e
siècle que l’attaque de la sciences contre la théologie est la plus vigoureuse, d’autant
parce qu’elle s’appuie sur le mouvement philosophique des Lumières.
Buffon publie son
Histoire Naturelle à partir de 1749.
Il rejette l’idée newtonienne de création divine du système
solaire, l’attribuant plutôt à un phénomène naturel.
Il refuse le Déluge et son estimation de
l’histoire de la Terre est en évidente contradiction avec les estimations antérieures, fondées
sur la Bible.
Il finit par être condamné par la Sorbonne et se rétracte.
L’idée d’évolution, qui
sera la pomme de discorde entre théologiens et scientifiques, commence à apparaître en
astronomie avec Kant ( Histoire générale et théorie des cieux ) ou, un peu plus tard, avec
Laplace ( Exposition du système du monde ).
Ainsi, sans remettre en cause le dogme de façon
radicale (à l’exception de la période révolutionnaire), le 18 e
prépare le terrain aux grands
bouleversements du siècle suivant..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- dissertation philo science et religion: Pourquoi le développement scientifique n'a-t-il pas fait disparaître les religions ?
- Que dire de l’industrialisation de l’Europe au milieu du 19e siècle ?
- Russel science et religion
- PROBLÈME DE L’INCROYANCE AU XVIe SIÈCLE - la religion de Rabelais. (résumé)
- Bertrand Russell, Science et religion (résumé et analyse)