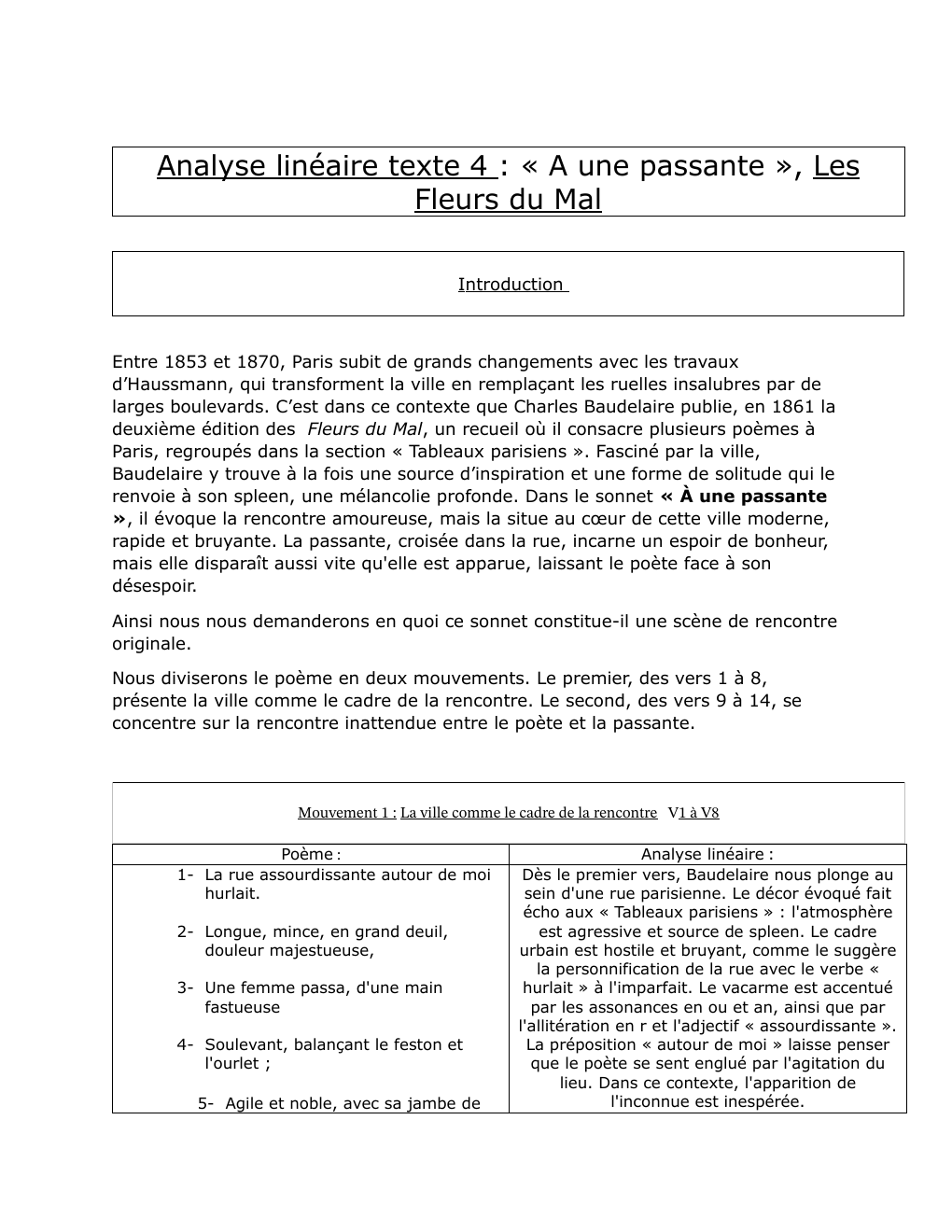Analyse linéaire À une passante
Publié le 12/04/2025
Extrait du document
«
Analyse linéaire texte 4 : « A une passante », Les
Fleurs du Mal
Introduction
Entre 1853 et 1870, Paris subit de grands changements avec les travaux
d’Haussmann, qui transforment la ville en remplaçant les ruelles insalubres par de
larges boulevards.
C’est dans ce contexte que Charles Baudelaire publie, en 1861 la
deuxième édition des Fleurs du Mal, un recueil où il consacre plusieurs poèmes à
Paris, regroupés dans la section « Tableaux parisiens ».
Fasciné par la ville,
Baudelaire y trouve à la fois une source d’inspiration et une forme de solitude qui le
renvoie à son spleen, une mélancolie profonde.
Dans le sonnet « À une passante
», il évoque la rencontre amoureuse, mais la situe au cœur de cette ville moderne,
rapide et bruyante.
La passante, croisée dans la rue, incarne un espoir de bonheur,
mais elle disparaît aussi vite qu'elle est apparue, laissant le poète face à son
désespoir.
Ainsi nous nous demanderons en quoi ce sonnet constitue-il une scène de rencontre
originale.
Nous diviserons le poème en deux mouvements.
Le premier, des vers 1 à 8,
présente la ville comme le cadre de la rencontre.
Le second, des vers 9 à 14, se
concentre sur la rencontre inattendue entre le poète et la passante.
Mouvement 1 : La ville comme le cadre de la rencontre V1 à V8
Poème :
1- La rue assourdissante autour de moi
hurlait.
2- Longue, mince, en grand deuil,
douleur majestueuse,
3- Une femme passa, d'une main
fastueuse
4- Soulevant, balançant le feston et
l'ourlet ;
5- Agile et noble, avec sa jambe de
Analyse linéaire :
Dès le premier vers, Baudelaire nous plonge au
sein d'une rue parisienne.
Le décor évoqué fait
écho aux « Tableaux parisiens » : l'atmosphère
est agressive et source de spleen.
Le cadre
urbain est hostile et bruyant, comme le suggère
la personnification de la rue avec le verbe «
hurlait » à l'imparfait.
Le vacarme est accentué
par les assonances en ou et an, ainsi que par
l'allitération en r et l'adjectif « assourdissante ».
La préposition « autour de moi » laisse penser
que le poète se sent englué par l'agitation du
lieu.
Dans ce contexte, l'apparition de
l'inconnue est inespérée.
statue.
6- Moi, je buvais, crispé comme un
extravagant,
7- Dans son œil, ciel livide où germe
l'ouragan,
8- La douceur qui fascine et le plaisir
qui tue.
Le vers 2 se compose d'une série d'adjectifs et
de noms communs mélioratifs qui créent un
rythme particulier.
La description suggère la
perfection physique : la silhouette est « longue
» et « mince ».
Les codes de la beauté de
l'époque se traduisent par des courbes
généreuses, tandis que la femme, vêtue de noir,
arbore une tenue de deuil.
Le déterminant
indéfini « une femme » désigne un être inconnu
et souligne son unicité.
Le verbe « passa »
indique que cette vision est fugace.
Les
allitérations en l et les gérondifs associés
renforcent l'idée de légèreté et de grâce.
Le
raffinement de la passante se trouve encore
accentué par les adjectifs « majestueuse » et «
fastueuse ».
Au vers 5, l'auteur utilise une métaphore pour
évoquer sa jambe comme une sculpture,
soulignant la beauté....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Analyse linéaire Bac Français A une passante de Baudelaire
- Baudelaire, A un passante, analyse linéaire
- Analyse linéaire du sonnet: A une passante furtive de Charles Baudelaire
- analyse linéaire Les caractères Giton et Phédon
- Analyse linéaire de l'incipit Au Bonheur des dames