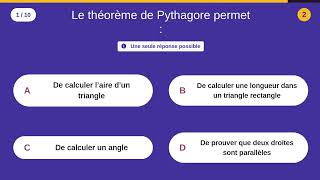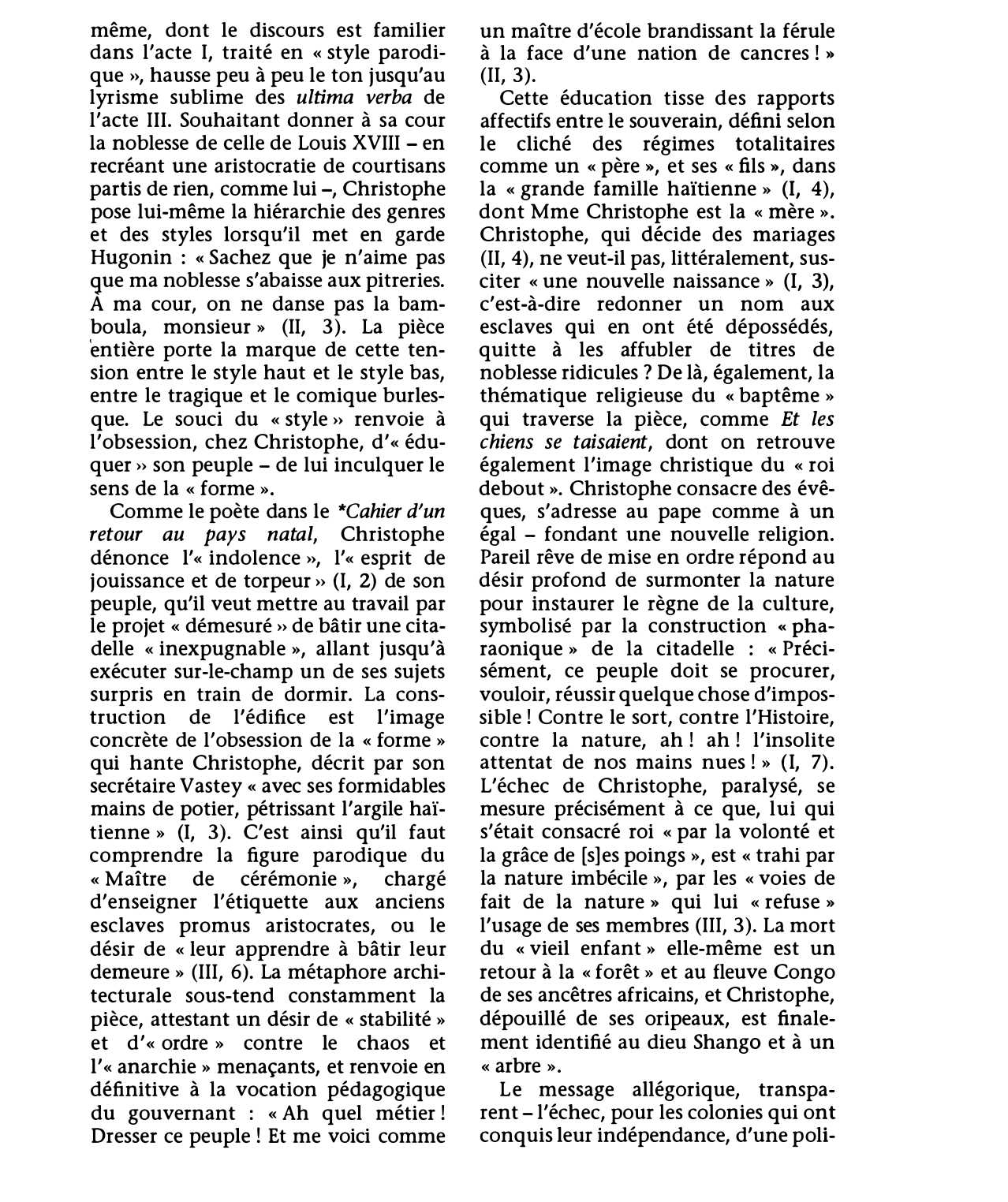Tragédie du roi Christophe (la). Tragédie en trois actes et en prose d'Aimé Césaire (résumé et analyse de l'oeuvre)
Publié le 27/10/2018

Extrait du document
Tragédie du roi Christophe
(la). Tragédie en trois actes et en prose d'Aimé Césaire (né en 1913), publiée à Paris aux Éditions Présence Africaine en 1963, et créée au Festival de Salzbourg en 1964. Quelques scènes en avaient été publiées dans Présence Africaine entre 1961 et 1963, avant l'édition complète ; à la suite de sa création par Jean-Marie Serreau, Césaire, tenant compte du travail avec le metteur en scène et les acteurs, en a remanié le texte pour l'édition définitive de 1970.
Césaire, qui a étudié l'histoire d'Haïti pour son essai Toussaint Louverture (1960), conscient de la mission politique du théâtre, « éveilleur extraordinaire » pour des « peuples où on ne lit pas », a sans doute commencé à écrire sa Tragédie en 1959, après avoir fondé le Parti progressiste martiniquais.
Christophe, ancien esclave cuisinier, nommé président de la République d'Haïti, se fait sacrer roi et entreprend de mettre le pays en ordre en lui imposant le projet grandiose de construire une citadelle, malgré les exhortations à la modération de son épouse, Mme Christophe. En butte à la résistance indolente de ses sujets, de la cour qu'il a recréée à l'image de celle de France, il s'écroule paralysé, et meurt, abandonné par son peuple.
Après le modèle grec, eschyléen -revu et corrigé par Nietzsche - de Et les chiens se taisaient (1946), la Tragédie se réfère à Shakespeare (de même qu'Une tempête en 1969, faisant de Caliban
l'esclave noir du magicien Prospero). L'<< attentat du Destin », la « Fortune envieuse » qui frappe Christophe, comme dans les drames historiques ou dans Macbeth, fauche le héros de la négritude dans ses ambitions politiques. Il n'est plus le rebelle, mais le gouvernant, devenu la victime de sa fortune politique. Comme dans la tragédie shakespearienne et ses procédés de mise en abyme, la pièce se donne pour ce qu'elle est : une représentation, ainsi d'ailleurs que le suggère le titre, qui en qualifie, au second degré, le genre. Le Prologue (dans lequel le « présentateur-commentateur » introduit les personnages, situe l'action), ou l'intermède à la fin de l'acte I participent de cette mise en abyme du spectacle dont la fonction, toute brech-tienne, semble de permettre une distanciation ironique à l'égard des personnages. La Tragédie, en ce sens, démystifie le genre tragique, en même temps qu'elle le recrée.
«
même, dont le discours est fami lier
dans l'acte 1, traité en , hausse peu à peu le ton jusqu'au
ly risme sublime des ultima verba de
l' acte Ill.
Souhaitant donner à sa cour
la noblesse de celle de Louis XVIII -en
recréant une aristocratie de courtisans
partis de rien, comme lui -, Christophe
pose lui-même la hiérarchie des genres
et des styles lorsqu'il met en garde
Hugonin : « Sachez que je n'aime pas
q ue ma nobl esse s'abaisse aux pitreries.
A ma cour, on ne danse pas la bam
boula, monsieur >> (II, 3).
La pièce
e ntière porte la marque de cette ten
sion entre le style haut et le style bas,
entre le tragique et le comique burles
que.
Le souci du « style >> renvoie à
l'o bse ssion, chez Christop he, d'« édu
quer '' son peuple -de lui inculquer le
sens de la « forme ''·
Comme le poèt e dans le *Cahier d'un
retour au pays natal, Christophe
dénonce l'« indolence>>, l'« esprit de
jo uissance et de torpeur >> (1, 2) de son
peuple, qu'il veut mettre au travail par
le projet « démesuré >> de bâtir une cita
delle «inexpugnab le», allant jusq u'à
exécuter sur-le-champ un de ses suj ets
surpris en train de dormir.
La cons
truction de l'édifice est l'image
conc rète de l'obsession de la «forme »
qui hante Christophe, décrit par son
secrétaire Vastey «avec ses formidables
mains de potier, pétrissant l'argile haï
tienne » (1, 3).
C'est ainsi qu'il faut
com pren dre la figure parodique du
«M aître de cérémonie », chargé
d'ens eigner l'étiquette aux anciens
escla ves promus aristocrat es, ou le
désir de « leur apprendre à bâ tir leur
demeure » (III, 6).
La métaphore archi
tecturale sous-tend constamment la
pièce, attestant un désir de « stabilité »
et d'« ordre » contre le chaos et
l'« anarchie » menaçants, et renvoie en
défin itive à la vocation pédagogique
du gouvern ant : « Ah quel métier !
Dresser ce peuple ! Et me voici comme un
maître d'école brandissant la férule
à la face d'une nation de cancres ! »
(II, 3).
Cette éducation tisse des rapports
affectifs entre le souverain, défini selon
le cliché des régimes totalitaires
comme un «père », et ses «fils», dans
la « grande famille haïtienne » (1, 4),
dont Mme Christophe est la «m ère».
Christophe, qui décide des mariages
(Il, 4), ne veut-il pas, littéralement, sus
citer «une nouvelle naissance » (1, 3),
c'e st-à-dire redonner un nom aux
escla ves qui en ont été dépossédés,
quitte à les affub ler de titres de
noblesse ridicules ? De là, également, la
thématique religieuse du « baptême »
qui traverse la pièce, comme Et les
chiens se taisaient, dont on retrouve
également l'image christique du « roi
debout ».
Christophe consacre des évê
ques, s'adresse au pape comme à un
égal -fondant une nouvelle religion.
Pareil rêve de mise en ordre répond au
désir profond de surmonter la nature
pour instaurer le règne de la culture,
sym bolisé par la con struc tion « pha
raonique » de la citadelle : « Préci
séme nt, ce peuple doit se procurer,
vouloir, réussir quelque chose d'impos
sible ! Contre le sort, contre l'Histoire,
contre la nature, ah ! ah ! l'i nsolite
attentat de nos mains nues ! » (1, 7) .
L'échec de Christophe, paralysé, se
mesure précisément à ce que, lui qui
s'é tait cons acré roi «par la volonté et
la grâce de [s]es poings », est « trahi par
la nature imbécile ,, par les «voies de
fait de la nature " qui lui « ref use "
l'usa ge de ses membres (III, 3).
La mort
du « vieil enfant » elle-même est un
retour à la « forêt » et au fleuve Congo
de ses ancêtres africains, et Chr istophe,
dépouillé de ses oripeaux, est finale
ment identifié au dieu Shango et à un
«a rbre ».
Le messa ge allégorique, transpa
rent -l'échec, pour les colonies qui ont
conquis leur indépendance, d'une poli-.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- TRAGÉDIE DU ROI CHRISTOPHE (La) d'Aimé Césaire (résumé & analyse)
- UN CHAPEAU DE PAILLE D'ITALIE. Comédie en cinq actes et en prose d'Eugène Labiche (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- ÉLECTRE. Pièce en deux actes et en prose de Jean Giraudoux (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- POLYEUCTE. « Tragédie chrétienne » en cinq actes et en vers de Pierre Corneille (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- Cahiers d’un retour au pays natal Aimé Césaire (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)