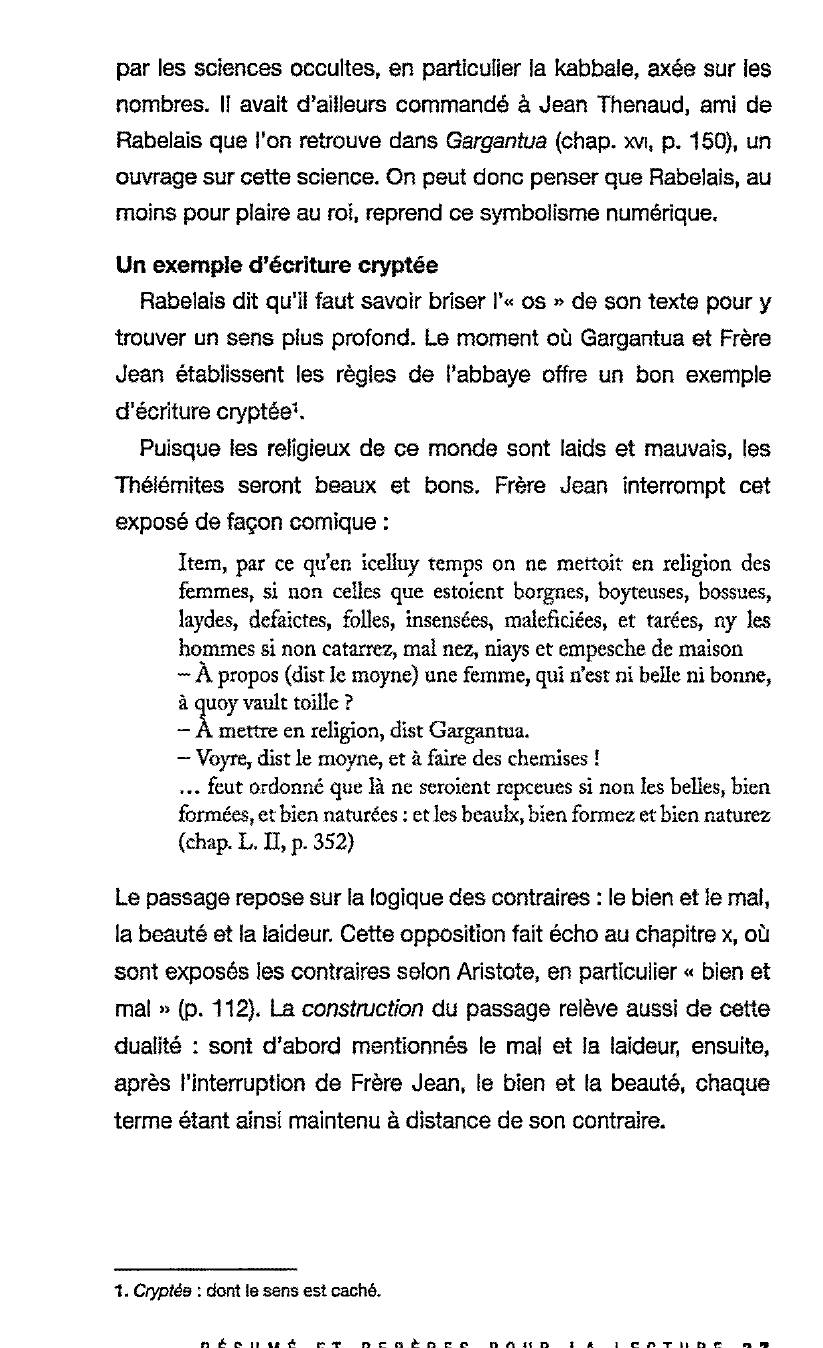QUATRIEME EPISODE: L’ABBAYE DE THÉLÈME
Publié le 14/01/2020
Extrait du document
Cette interruption repose sur un court dialogue de trois répliques, chacune faisant allusion à la notion de fil, de lien. La première contient la notion de toile (il y a un jeu de mots, toile étant prononcé touelle}, donc de tissu, de filage. La seconde comporte le mot religion, auquel les auteurs chrétiens donnaient pour étymologie le latin religio, « relier » (selon l'idée que la religion est un lien à Dieu). La troisième réplique revient au filage avec la chemise, objet fait de toile. Autrement dit, les répliques 1 et 3 exposent la notion de lien sur un plan concret et trivial, la réplique 2 le fait au plan abstrait et sublime.
L’interruption de Frère Jean consiste donc à créer un chiasme1 au sein duquel deux façons opposées de nouer se montrent solidaires. Or le nœud appartient à une symbolique mystique bien connue à l'époque : c’est au moyen d'un « nœud » mental que la conscience peut faire coïncider les contraires et ainsi se rapprocher de Dieu, en qui sont réunies toutes les oppositions. Ici, le nœud opéré par le moine est placé entre deux séries de contraires, comme pour les unifier. Rabelais dissimulerait ainsi l’une des clés de cette abbaye, véritable lien avec le divin.
Une « énigme » trouvée dans les fondations de l’abbaye, de tonalité très sombre, semble évoquer les persécutions subies par les chrétiens évangéliques. Sa lecture provoque un soupir de
«
1
par les sciences occultes, en particulier la kabbale, axée sur les
nombres.
11 avait d'ailleurs commandé à Jean Thenaud, ami de
Rabelais que l'on retrouve dans Gargantua (chap.
XVI, p.
150), un
ouvrage sur cette science.
On peut donc penser que Rabelais, au
moins pour plaire au roi, reprend ce symbolisme numérique.
Un exemple d'écriture cryptée
Rabelais dit qu'il faut savoir briser 1'« os,, de son texte pour y
trouver un sens plus profond.
Le moment où Gargantua et Frère
Jean établissent les règles de l'abbaye offre un bon exemple
d'écriture cryptée 1•
Puisque les religieux de ce monde sont laids et mauvais, les
Thélémites seront beaux et bons.
Frère Jean interrompt cet
exposé de façon comique :
Item, par ce qu'en icelluy temps on ne mettoit en religion des
femmes, si non celles que estoient borgnes, boyteuses, bossues,
laydes, defaictes, folles, insensées, maleficiées, et tarées, ny les
hommes si non catarrez, mal nez, niays et empesche de maison -A propos (dist le moyne) une femme, qui n'est ni belle ni bonne, à quoy vault toille ? -A mettre en religion, dist Gargantua.
-Voyre, dist le moyne, et à faire des chemises !
...
feut ordonné que là ne seroient repceues si non les belles, bien
formées, et bien naturées : et les beaulx, bien formez et bien naturez (chap.
L.
II, p.
352)
Le passage repose sur la logique des contraires : le bien et le mal,
la beauté et la laideur.
Cette opposition fait écho au chapitre x, où
sont exposés les contraires selon Aristote, en particulier " bien et
mal " (p.
112).
La construction du passage relève aussi de cette
dualité : sont d'abord mentionnés le mal et la laideur, ensuite,
après l'interruption de Frère Jean, le bien et la beauté, chaque
terme étant ainsi maintenu à distance de son contraire.
1.
Cryptée : dont le sens est caché.
RÉSUMÉ ET REPÈRES POUR LA LECTURE 27.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- l'idéal de vie humaniste: l'abbaye de thélème
- Abbaye de Thélème Gargantua Rabelais
- RABELAIS: L'éducation de Gargantua. — L'abbaye de Thélème (Gargantua : chapitres XIV, XV, XXI, XXII, XXIII, XXIV, LII, LIII, LIV, LV, LNI, LVII).
- Abbaye (groupe de l'), LITTÉRATURE : ce nom, choisi en souvenir de l'abbaye de Thélème, désigne l'expérience de vie communautaire d'un groupe de poètes au début du XXe siècle.
- En y mêlant de la fantaisie romanesque, Rabelais nous a donné dans l'abbaye de Thélème son idéal de vie. Des gens « libères, bien nés et bien instruits » y font « ce qu'ils veulent ». C'est-à-dire qu'ils lisent, étudient, écrivent en vers et en prose, chantent, se donnent des concerts, jouent et chassent, etc. Vous vous demanderez dans quelle mesure Montaigne se serait accommodé de la Thélème de Rabelais.