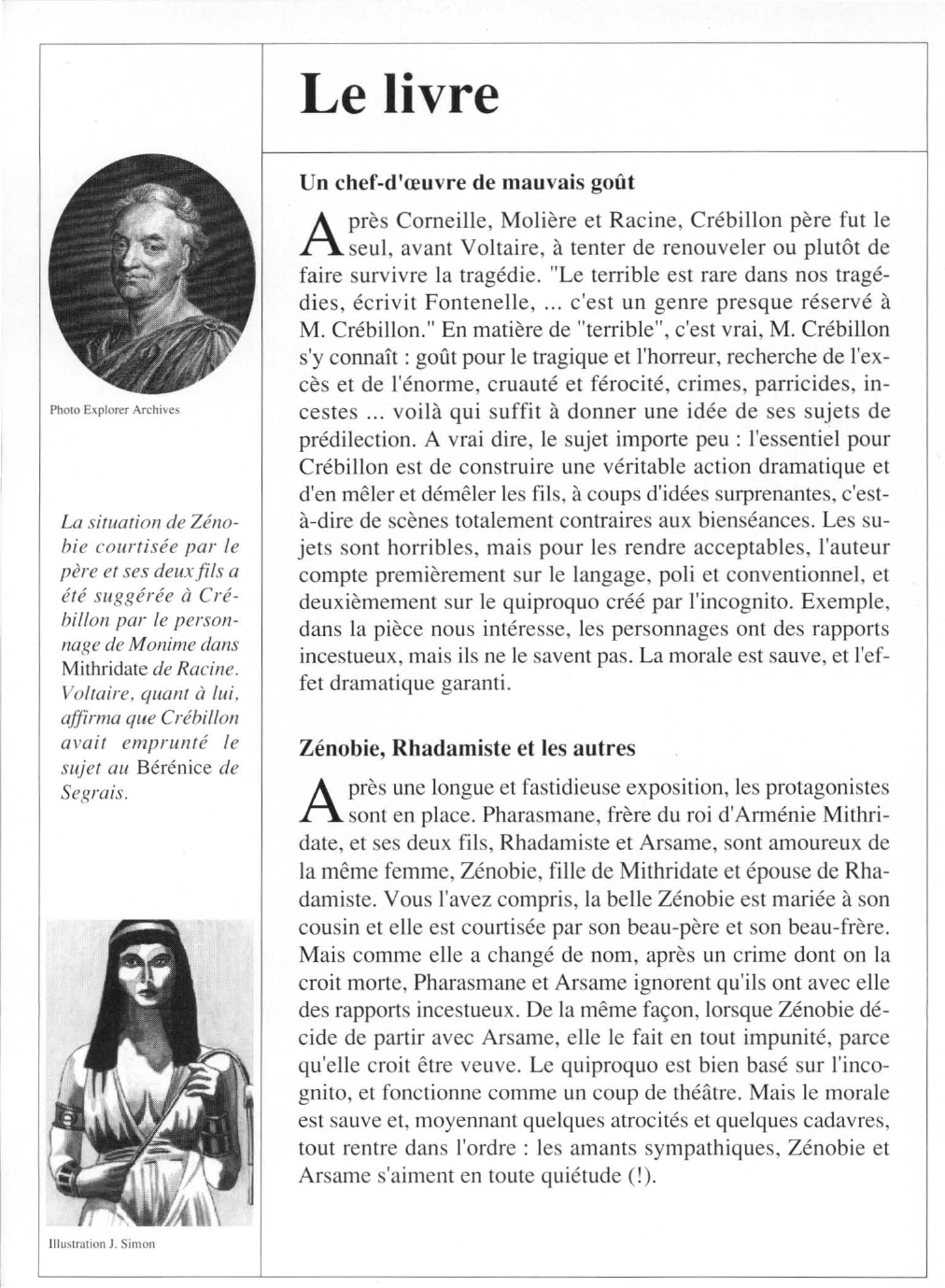Propsper Jolyot de CREBILLON : Rhadamiste et Zénobie
Publié le 05/10/2012
Extrait du document

Grâce à Rhadamiste et Zénobie (1711), Crébillon père (1674-1762) eut son heure de gloire ; il fut même considéré, jusqu'à Voltaire, comme le troisième auteur dramatique français après Corneille et Racine. Rappelons que ces deux immenses tragédiens, comme Molière, étaient tous trois morts entre 1673 et 1677, et qu'ils avaient laissé un grand vide. La tragédie, on le saura plus tard, n'y survivra pas, tant le genre avait atteint des limites au-delà desquelles il ne pouvait plus évoluer. Seul Crébillon, excepté quelques auteurs dont le nom est aujourd'hui oublié, va tenter de renouveler le genre par des scènes de violence et de terreur. Parmi ses autres oeuvres, citons Idoménée (1705), Atrée et Thyeste (1707) et Électre ( 1708)...

«
PhoiO Explorer Archives
La situati on d e Zén o bie courtis ée par le
p ère e t se s deu x fils a
é té s ugg érée à Cré bill on par le p ers on na ge de M onim e dans M ithridate de Racin e .
V olt air e.
quant à lui , affirma que C ré bi llo n
a v ait emprunt é le
s uj et au Bérénice d e
S eg rais.
Illustration J.
Simon
Le livre
Un chef-d'œuvre de mauvai s goût
A
près Co rn eill e, Mo lière e t R acine, Cré bill on p ère f ut le
seul, ava nt Vo ltaire, à te nt er d e re no uve ler ou plut ôt d e
f a ir e s urv iv re la tragé die.
"L e te rribl e es t ra re dan s nos tragé
di es, éc
rivit Font en e ll e, . ..
c'es t un genre pres qu e r ése rvé à
M .
Crébill on." En ma tière de "te rribl e", c'est v ra i, M .
Crébill on
s 'y co nn aît : go ût po ur le trag iqu e et l'h orr eur , rec herc h e de
l'ex
cès et d e
l'én o rm e, cru aut é e t férocit é, crim es, parri c ides, in
ces tes ...
vo
ilà qui su ff it à do nn er un e idée de ses suj ets de
pr édil ec
tion.
A v ra i dir e, le s u jet imp o rte pe u : l'esse ntiel p our
C ré bill on es t d e co nstruir e un e vé rita
ble ac tion dram atiqu e et
d 'e n m êler et d ém êle r l es f
ils, à co up s d' idées surpr enant es, c'es t
à- dir e de scè nes tota le m ent co ntr air es au x
bien séa nces.
Les su
jets so nt ho rribl es, m ais po ur les rendr e acce ptabl es, l'aut eur
co mpt e pr e
mière m ent su r le la n gage, po li et conve ntio nnel, et
d eu xiè m em ent sur le qu ipr oqu o c réé par l'in cog nito.
Exe mpl e,
d an s la
pièce no us int éresse, les perso nn ages ont des ra pp or ts
inces tueux , m ais ils ne le save nt pas.
La m ora le es t sa uve , e t l'ef
fet d ram atiqu e gara nti.
Zé nobie, Rhadamiste et le s au tres
A
pr ès une lo ng ue e t fas tidi euse expos it io n, les protago nistes
so nt en
place.
Pharas man e, frère du ro i d'A rménie Mithri
d ate, et se s de ux f
ils, Rh ada miste e t A rsa me, sont am oure ux de
l a m êm e
femm e, Zén ob ie, fille de M ithri date e t é po u se de Rha
d ami ste .
Vo us
l'avez comp ris, la be lle Zé no bie es t m a riée à so n
co us
in et e lle es t co urti sée par so n b eau-p ère e t so n b ea u-frère.
M ais co mm e elle a c han gé de no m , a près
un crim e dont on l a
c ro it m ort e,
Pharas man e e t Ar same ig no re nt qu ' ils o nt av ec e lle
d es ra pp o
rts inces tueu x.
D e la m êm e faço n, lorsq ue Zén o bie dé
c
ide de partir avec Arsame, e lle le fait e n to ut impunit é, parce
qu 'e
lle c ro it ê tr e ve uve .
L e quipr oqu o es t bien b asé sur l'in co
g nit o, et
fonctio nn e com me un co up de th éâ tre.
M ais le mora le
es t sa uve et, m oye nnan t qu elqu es atr oc
ités et qu elqu es cada vres,
to ut ren tre da ns
l'or dre : les am an ts symp athi ques, Zé no bie e t
A rsa me s'a
iment en to ute q uiétude(!) ..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Rhadamiste et Zénobie de Prosper CREBILLON père (Résumé & Analyse)
- Rhadamiste et Zénobie
- RHADAMISTHE ET ZÉNOBIE.
- ATREE ET THYESTE CREBILLON
- Zénobie.