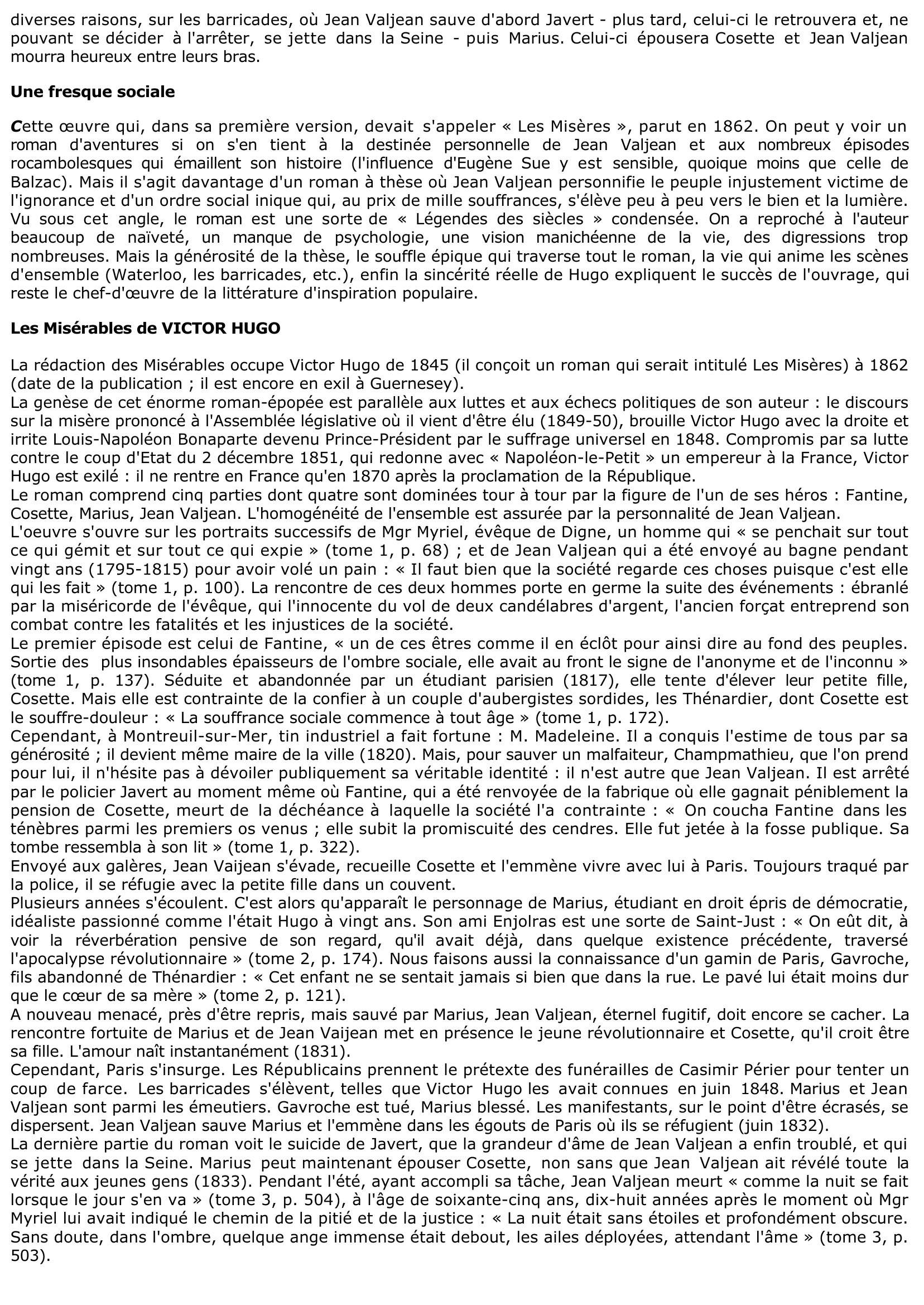MISÉRABLES (les), de Hugo
Publié le 26/01/2019
Extrait du document
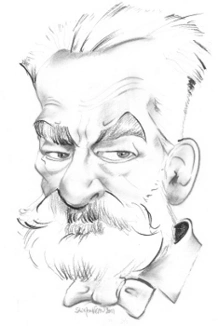
MISÉRABLES (les), roman de Hugo (1862), composé de 1845 au début de
1848, repris et achevé à partir de 1860. Les cinq parties (« Fantine », « Cosette », « Marius », « l'idylle rue Plumet et l'Épopée rue Saint-Denis », « Jean Valjean ») couvrent l'adolescence du siècle (de Waterloo à l'émeute de juin 1832) et de l'auteur (de la puberté à l'union avec Juliette Drouet en 1833). Il réalise une synthèse souveraine entre plusieurs formes romanesques : le mélodrame des bas-fonds, lancé par E. Sue, la fresque balzacienne d'un milieu, d'une ville et d'une aventure singulière, la saga populaire d'un héros mythique, le roman didactique renouvelé du xviiie s. qui fait alterner intrigue et digressions. Dans leur surabondance de sens et d'ambiguïtés, les Misérables parlent de ce trou dans lequel l'histoire est tombée en 1815, dont ni la Révolution, ni le Prince, ni l'insurrection ne surmontent l'escarpement. La rédemption morale, la charité sociale, la conscience universelle échouent devant tous ces accomplissements par avortement : celui de la République dans l'échec d'une insurrection, celui de la virilité généreuse dans l'héroïsme suicidaire d'un Gavroche, celui de la femme dans la féminité détruite ou prostituée, celui de la paternité et de « l'amour proprement dit » dans l'adoption d'une orpheline bâtarde par un forçat évadé, « vieillard vierge ». L'aspect déroutant de ce roman tient aussi à ses deux textes : d'abord celui d'un académicien plutôt bien-pensant, pair de France adultère provisoirement éloigné du pouvoir et qui cherche un autre public ; ensuite celui du grand prophète républicain, de l'exilé irréconciliable avec toute forfaiture, séparé de la société, tête à tête avec Dieu. Et ces deux textes implosent finalement l'un dans l'autre. Conçue et réalisée de part et d'autre de la IIe République, l'œuvre sape tous les régimes, mais aussi les certitudes philosophiques et religieuses de Hugo lui-même. L'exil volontaire l'arrache à la fois à sa première version » — remaniée — et à sa « Préface philosophique » — abandonnée.
Hugo invente un objet nouveau, la misère, qui donne nom à l'innommable et désigne l'unité de ces confins de la société (barrières et égouts), de l'histoire (bataille perdue et barricades) et de l'individu ( « effondrements intérieurs », « tempête sous un crâne »), où les hommes tout à la fois accomplissent et manquent leur appartenance à l'humanité. Hors de portée de tous les discours parce qu'elle est Tailleurs et l'envers de la société qui les tient, la misère exige leur remploi. Le récit des Misérables traverse tous les genres, argot, poème, chanson, prière, plaidoirie, réquisitoire, essai, etc. Ce fracas aux multiples résonances (Malraux, dans ses Antimémoires, note pendant la guerre d'Espagne les « piles des Misérables entre Bakounine et les écrits théoriques de Tolstoï, sur les Ramblas de Barcelone » et écoute Nehru lui dire que le roman de Hugo est l'un des livres étrangers les plus célèbres en Inde) installe le silence pensif et rusé où la polyphonie du roman moderne et des sciences humaines trouve son âge adulte.
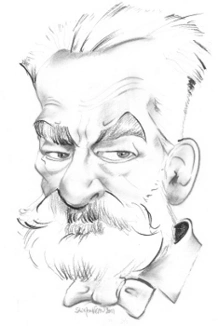
«
diverses raisons, sur les barricades, où Jean Valjean sauve d'abord Javert - plus tard, celui-ci le retrouvera et, nepouvant se décider à l'arrêter, se jette dans la Seine - puis Marius.
Celui-ci épousera Cosette et Jean Valjeanmourra heureux entre leurs bras.
Une fresque sociale
Cette œuvre qui, dans sa première version, devait s'appeler « Les Misères », parut en 1862.
On peut y voir unroman d'aventures si on s'en tient à la destinée personnelle de Jean Valjean et aux nombreux épisodesrocambolesques qui émaillent son histoire (l'influence d'Eugène Sue y est sensible, quoique moins que celle deBalzac).
Mais il s'agit davantage d'un roman à thèse où Jean Valjean personnifie le peuple injustement victime del'ignorance et d'un ordre social inique qui, au prix de mille souffrances, s'élève peu à peu vers le bien et la lumière.Vu sous cet angle, le roman est une sorte de « Légendes des siècles » condensée.
On a reproché à l'auteurbeaucoup de naïveté, un manque de psychologie, une vision manichéenne de la vie, des digressions tropnombreuses.
Mais la générosité de la thèse, le souffle épique qui traverse tout le roman, la vie qui anime les scènesd'ensemble (Waterloo, les barricades, etc.), enfin la sincérité réelle de Hugo expliquent le succès de l'ouvrage, quireste le chef-d'œuvre de la littérature d'inspiration populaire.
Les Misérables de VICTOR HUGO
La rédaction des Misérables occupe Victor Hugo de 1845 (il conçoit un roman qui serait intitulé Les Misères) à 1862(date de la publication ; il est encore en exil à Guernesey).La genèse de cet énorme roman-épopée est parallèle aux luttes et aux échecs politiques de son auteur : le discourssur la misère prononcé à l'Assemblée législative où il vient d'être élu (1849-50), brouille Victor Hugo avec la droite etirrite Louis-Napoléon Bonaparte devenu Prince-Président par le suffrage universel en 1848.
Compromis par sa luttecontre le coup d'Etat du 2 décembre 1851, qui redonne avec « Napoléon-le-Petit » un empereur à la France, VictorHugo est exilé : il ne rentre en France qu'en 1870 après la proclamation de la République.Le roman comprend cinq parties dont quatre sont dominées tour à tour par la figure de l'un de ses héros : Fantine,Cosette, Marius, Jean Valjean.
L'homogénéité de l'ensemble est assurée par la personnalité de Jean Valjean.L'oeuvre s'ouvre sur les portraits successifs de Mgr Myriel, évêque de Digne, un homme qui « se penchait sur toutce qui gémit et sur tout ce qui expie » (tome 1, p.
68) ; et de Jean Valjean qui a été envoyé au bagne pendantvingt ans (1795-1815) pour avoir volé un pain : « Il faut bien que la société regarde ces choses puisque c'est ellequi les fait » (tome 1, p.
100).
La rencontre de ces deux hommes porte en germe la suite des événements : ébranlépar la miséricorde de l'évêque, qui l'innocente du vol de deux candélabres d'argent, l'ancien forçat entreprend soncombat contre les fatalités et les injustices de la société.Le premier épisode est celui de Fantine, « un de ces êtres comme il en éclôt pour ainsi dire au fond des peuples.Sortie des plus insondables épaisseurs de l'ombre sociale, elle avait au front le signe de l'anonyme et de l'inconnu » (tome 1, p.
137).
Séduite et abandonnée par un étudiant parisien (1817), elle tente d'élever leur petite fille,Cosette.
Mais elle est contrainte de la confier à un couple d'aubergistes sordides, les Thénardier, dont Cosette estle souffre-douleur : « La souffrance sociale commence à tout âge » (tome 1, p.
172).Cependant, à Montreuil-sur-Mer, tin industriel a fait fortune : M.
Madeleine.
Il a conquis l'estime de tous par sagénérosité ; il devient même maire de la ville (1820).
Mais, pour sauver un malfaiteur, Champmathieu, que l'on prendpour lui, il n'hésite pas à dévoiler publiquement sa véritable identité : il n'est autre que Jean Valjean.
Il est arrêtépar le policier Javert au moment même où Fantine, qui a été renvoyée de la fabrique où elle gagnait péniblement lapension de Cosette, meurt de la déchéance à laquelle la société l'a contrainte : « On coucha Fantine dans lesténèbres parmi les premiers os venus ; elle subit la promiscuité des cendres.
Elle fut jetée à la fosse publique.
Satombe ressembla à son lit » (tome 1, p.
322).Envoyé aux galères, Jean Vaijean s'évade, recueille Cosette et l'emmène vivre avec lui à Paris.
Toujours traqué parla police, il se réfugie avec la petite fille dans un couvent.Plusieurs années s'écoulent.
C'est alors qu'apparaît le personnage de Marius, étudiant en droit épris de démocratie,idéaliste passionné comme l'était Hugo à vingt ans.
Son ami Enjolras est une sorte de Saint-Just : « On eût dit, àvoir la réverbération pensive de son regard, qu'il avait déjà, dans quelque existence précédente, traversél'apocalypse révolutionnaire » (tome 2, p.
174).
Nous faisons aussi la connaissance d'un gamin de Paris, Gavroche,fils abandonné de Thénardier : « Cet enfant ne se sentait jamais si bien que dans la rue.
Le pavé lui était moins durque le cœur de sa mère » (tome 2, p.
121).A nouveau menacé, près d'être repris, mais sauvé par Marius, Jean Valjean, éternel fugitif, doit encore se cacher.
Larencontre fortuite de Marius et de Jean Vaijean met en présence le jeune révolutionnaire et Cosette, qu'il croit êtresa fille.
L'amour naît instantanément (1831).Cependant, Paris s'insurge.
Les Républicains prennent le prétexte des funérailles de Casimir Périer pour tenter uncoup de farce.
Les barricades s'élèvent, telles que Victor Hugo les avait connues en juin 1848.
Marius et JeanValjean sont parmi les émeutiers.
Gavroche est tué, Marius blessé.
Les manifestants, sur le point d'être écrasés, sedispersent.
Jean Valjean sauve Marius et l'emmène dans les égouts de Paris où ils se réfugient (juin 1832).La dernière partie du roman voit le suicide de Javert, que la grandeur d'âme de Jean Valjean a enfin troublé, et quise jette dans la Seine.
Marius peut maintenant épouser Cosette, non sans que Jean Valjean ait révélé toute lavérité aux jeunes gens (1833).
Pendant l'été, ayant accompli sa tâche, Jean Valjean meurt « comme la nuit se faitlorsque le jour s'en va » (tome 3, p.
504), à l'âge de soixante-cinq ans, dix-huit années après le moment où MgrMyriel lui avait indiqué le chemin de la pitié et de la justice : « La nuit était sans étoiles et profondément obscure.Sans doute, dans l'ombre, quelque ange immense était debout, les ailes déployées, attendant l'âme » (tome 3, p.503)..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Victor Hugo, Les Misérables, 1862, 1ère partie, Livre 7ème, Chapitre 3 : Une tempête sous un crâne de « Il se demanda donc où il en était... » / « Pour la 1ère fois depuis 8 années » à «...c'était en sortir en réalité.»)
- Le personnage de COSETTE de Victor Hugo les Misérables
- MISÉRABLES (Les) de Victor Hugo (résumé)
- Le personnage de Gavroche de Hugo Les Misérables
- Les Misérables (résumé & analyse) Hugo